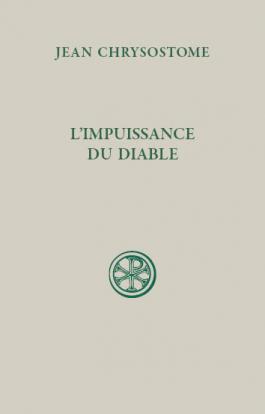-
SC 560
Jean Chrysostome
Homélies sur l'impuissance du diable
octobre 2013Introduction, texte critique, traduction et notes par Adina Peleanu.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.Révision assurée par Guillaume Bady.ISBN : 9782204101691227 pagesIndisponible chez notre éditeurNon, le mal n'est pas naturel, et oui, l'homme est libre, dit Jean « Bouche d'or ».Présentation
Les deux homélies sur L’impuissance du diable, connues jusqu’ici sous le titre latin De diabolo tentatore, ont été prononcées par Jean Chrysostome à Antioche peu après le début de son sacerdoce en 386. Dans ces discours qui sont moins une théodicée qu’un plaidoyer pour la création, Bouche d’or se fait tour à tour l’accusateur et l’avocat du diable — celui-là même dont le nom grec, « diabolos », signifie « calomniateur ».
Car les véritables causes du mal, selon l’Antiochien, sont la négligence morale et le mauvais choix, non la nature : combattant par la même occasion le manichéisme, le prédicateur s’attache à imposer l’idée paradoxale que du mal extérieur peut naître le bien, car le vrai bien, comme le vrai mal, est intérieur. À ce titre le diable est impuissant devant le libre choix humain, son existence n’ayant d’autre but que de l’éprouver. Le pasteur propose dès lors cinq voies de conversion, tandis que l’orateur et exégète multiplie antithèses, images insolites et exemples bibliques culminant dans la figure de Job, qui, contrairement à Adam et Ève, a fait le bon choix.
Adina Peleanu (moniale Antonia, du monastère orthodoxe roumain Protection de la Mère de Dieu, Limours, Essonne), a consacré à ses textes sa thèse de l'École Pratique des Hautes Études.
Le mot des Sources Chrétiennes
Ces deux petites homélies sur L’impuissance du diable remontent aux années antiochiennes de Chrysostome, au début de son ordination comme prêtre. Elles nous engagent à être clairvoyants sur le diable, sans fantasmes ni peurs inutiles, à le mettre à nu pour mieux savoir à qui nous avons affaire. Le diable n’est pas violent, il agit par persuasion et tromperie, non par contrainte. À une question fréquente : Pourquoi Dieu n’a-t-il pas mis une fois pour toutes le diable hors d’état de nuire ?, Chrysostome répond : Supposons deux athlètes qui doivent combattre un adversaire, dont l’un est très entraîné et plein d’ardeur, l’autre négligent et vautré dans la facilité ; si l’on supprime le combat, qui est lésé ? Le bon athlète… Donc si Dieu laisse le diable, c’est pour ne pas priver les bons d’un combat victorieux (hom. I, 2). Les négligents, s’ils sont vaincus, ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes : ce sont eux, non le diable, qui causent à eux-mêmes le mal. Il n’y a qu’à comparer Adam et Job : l’un a succombé au tentateur, l’autre non. Il n’y a aucune fatalité, chacun est ramené à sa responsabilité, comme l’illustrent les paraboles du jugement. En effet, le mal – celui que nous faisons – n’est pas dans la « nature », pas même dans celle du diable, il résulte toujours d’un choix. Le diable fait le mal parce qu’il est jaloux des humains, et il n’est fort, dit Chrysostome, que de notre faiblesse : il n’a que le pouvoir que nous lui laissons prendre sur nous. Leçon d’optimisme et de liberté !
Bernard Meunier
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Les deux courtes homélies sur l’impuissance du diable remontent aux années antiochiennes de Chrysostome, au début de son ordination comme prêtre, comme l’indique la mention de l’évêque Flavien dans la première homélie. Comme pour beaucoup d’homélies chrysostomiennes, aucune datation plus précise ne peut être proposée. Il s’agit vraisemblablement de sermons mystagogiques, prononcés pendant la semaine qui suit les fêtes de Pâque et destinés aux nouveaux baptisés. La première homélie était probablement précédée d’un autre sermon, perdu, sur le même sujet. La seconde a quant à elle été prononcée deux jours après la première. Aucun indice ne permet d’inclure les deux textes dans la série d’homélies Sur l’obscurité des prophéties.
Le texte critique grec du volume est inédit. Il a été établi à partir de soixante-treize manuscrits. La moitié transmet les deux textes en une série, quatre les donnent séparément, et le reste ne donne que l’une de deux. L’édition actuelle retient des manuscrits que peu d’éditeurs antérieurs avaient retenus, et dont les leçons sont confirmées par la version arménienne des sermons.
Les deux homélies de la série engagent à être clairvoyants sur le diable, sans fantasmes ni peurs inutiles, à le mettre à nu pour mieux savoir à qui nous avons affaire. Le diable n’est pas violent, il agit par persuasion et tromperie, non par contrainte, affirme Jean Chrysostome. À une question fréquente, « pourquoi Dieu n’a-t-il pas mis une fois pour toutes le diable hors d’état de nuire? », le prédicateur répond : « Supposons deux athlètes qui doivent combattre un adversaire, dont l’un est très entraîné et plein d’ardeur, l’autre négligent et vautré dans la facilité; si l’on supprime le combat, qui est lésé? Le bon athlète… Donc si Dieu laisse le diable, c’est pour ne pas priver les bons d’un combat victorieux. » (I, 2) Les négligents, s’ils sont vaincus, ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes : ce sont eux, non le diable, qui causent à eux-mêmes le mal. Il n’y a qu’à comparer Adam et Job : l’un a succombé au tentateur, l’autre non. Il n’y a aucune fatalité, chacun est ramené à sa responsabilité, comme l’illustrent les paraboles du jugement. En effet, le mal – celui que nous faisons – n’est pas dans la «nature», pas même dans celle du diable, il résulte toujours d’un choix. Le diable fait le mal parce qu’il est jaloux des humains, et il n’est fort, dit Chrysostome, que de notre faiblesse : il n’a que le pouvoir que nous lui laissons prendre sur nous. Ces homélies délivrent ainsi un message optimiste qui n’enferme pas l’homme dans une fatalité quelconque et lui laisse toute sa liberté. Elles ont également une visée pédagogique: loin de se contenter d’un exposé théologique et doctrinal, elles proposent également des chemins de conversion à l’exemple de Job. Malgré leur titre qui laisse imaginer un exposé purement spéculatif, l’objectif de ces deux sermons est d’abord pastoral : guider les fidèles vers le salut de l’âme.
Extrait(s)
(I, 5, p. 145)
Si je vous ai dit tout cela maintenant, ce n’est pas pour affranchir le diable des accusations qui pèsent sur lui, mais pour vous libérer de votre négligence. De fait, il souhaite fortement, lui, se voir attribuer la responsabilité de nos péchés, afin que, nourris par de telles attentes, et nous livrant à toute sorte de mal, nous augmentions le châtiment qui nous menace, sans obtenir aucun pardon pour avoir rejeté sur lui la responsabilité – comme Ève, qui ne l’a pas obtenu non plus. Mais nous, ne faisons pas cela, et connaissons-nous nous-mêmes, connaissons nos blessures ! C’est ainsi, en effet, que nous pourrons appliquer les remèdes ; car celui qui ne connaît pas sa maladie ne pourra prendre aucun soin de son état. Nous avons commis beaucoup de péchés ; je le sais moi aussi : tous, nous méritons des châtiments ; mais nous ne sommes pas privés de pardon ni exclus d’une conversion : nous sommes encore debout sur l’aire de lutte et nous sommes dans les combats de la conversion.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
12
l. 15
romains
arabes
97
l. 12
pour la deuxième homélie F, J et qui
(pour la deuxième homélie) ; F et J qui
Volumes SC connexes
-
SC 126 bis
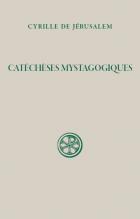
Catéchèses mystagogiques
décembre 1988
Une initiation donnée depuis le Saint-Sépulcre, révélant le sens des mystères.
-
SC 296

Journal de voyage
décembre 1982
La Jérusalem du IVe siècle, vue par la plus fameuse des pèlerines.
-
SC 252

Traité des principes, tome I. Livres I et II
décembre 1978
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 253
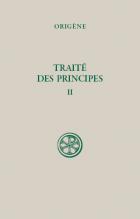
Traité des principes, tome II
décembre 1978
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 268

Traité des principes, tome III
mars 1980
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 269

Traité des principes, tome IV
mars 1980
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 312

Traité des principes, tome V
mai 1984
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
Du même auteur
-
SC 595

Panégyriques des martyrs, tome I
juin 2018
Le spectacle du martyre devient le lieu de la grâce : quand « Bouche d'Or » fait parler des voix qui n'ont plus de bouche.
-
SC 562
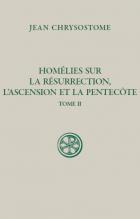
Homélies sur la résurrection, l'Ascension et la Pentecôte. Tome 2
septembre 2014
« Chaque jour est une fête » : un plaidoyer pour une spiritualité du quotidien.
-
SC 561
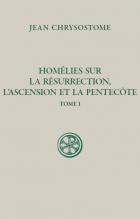
Homélies sur la résurrection, l'Ascension et la Pentecôte. Tome 1
novembre 2013
« Chaque jour est une fête » : un plaidoyer pour une spiritualité du quotidien.
-
SC 433

Sermons sur la Genèse
octobre 1998
L'éminente dignité de l'homme et de la femme dans la création, par Jean Bouche d'or.
-
SC 396
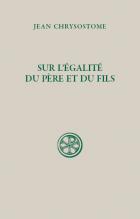
Sur l'égalité du Père et du Fils
janvier 1994
Le credo de Nicée pour les nuls, ou l'éloquence vivante de « Bouche d'or ».
-
SC 366
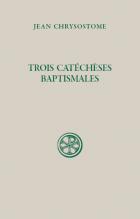
Trois catéchèses baptismales
octobre 1990
Sur le seuil du Royaume des cieux, les futurs baptisés d'Antioche écoutent Jean Bouche d'or.
-
SC 362

Sur Babylas
mars 1990
Plus fort qu'un empereur païen, l'évêque d'Antioche mort en martyr ! Une virulente apologie du christianisme, par Jean Bouche d'or.
-
SC 348

Commentaire sur Job, tome II
novembre 1988
« Être un homme: c'est là un premier éloge ». Job, modèle du chrétien pour Jean Bouche d'or.
-
SC 346

Commentaire sur Job, tome I
juin 1988
« Être un homme: c'est là un premier éloge ». Job, modèle du chrétien pour Jean Bouche d'or.
-
SC 304

Commentaire sur Isaïe
juin 1983
L'esprit et la « liberté de langage » du prophète, vus par Jean Bouche d'or.
-
SC 300
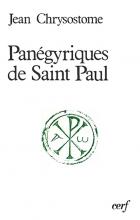
Panégyriques de saint Paul
novembre 1982
« L'imitation de saint Paul », ou la vie chrétienne selon Jean Bouche d'or.
-
SC 277

Homélies sur Ozias
février 1981
« Saint, Saint, Saint ! » Le cri de ravissement sans fin des Séraphins… et des chrétiens.
-
SC 272
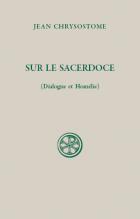
Sur le sacerdoce
janvier 1980
Les fausses confidences et les vrais conseils d'un pasteur qui inspire les prêtres depuis 15 siècles.
-
SC 188

Sur la vaine gloire et l'éducation des enfants
mai 1972
Une méthode moderne pour le caté : inspirée par le païen Pseudo-Plutarque, elle est signée de Jean Chrysostome au 4e siècle !
-
SC 50 bis
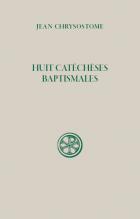
Huit catéchèses baptismales inédites
décembre 1970
À Antioche, cette année-là, les nouveaux baptisés resplendissent plus que le ciel étoilé.
-
SC 28 bis
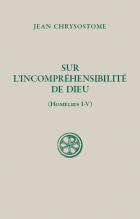
Sur l'incompréhensibilité de Dieu
décembre 1970
Croire tout savoir sur Dieu, quelle folie ! Cinq bijoux d'éloquence, par Jean Bouche d'or.
-
SC 13 bis

Lettres à Olympias
décembre 1968
Entre la diaconesse et l'évêque exilé, l'amitié et la foi résistent à la distance et aux persécutions.
-
SC 138

À une jeune veuve. Sur le mariage unique
juin 1968
Se remarier, ou rester veuve ? La réponse du fils d'une jeune veuve qui a choisi de le rester.
-
SC 125

La Virginité
décembre 1966
Le mariage, c'est bien, la virginité, c'est mieux : Jean Chrysostome s'explique.
-
SC 117

À Théodore
avril 1966
Un moine est parti et veut se marier ? Jean « Bouche d'or » tente de le faire revenir.
-
SC 103

Lettre d'exil
décembre 1964
Il n'est point de pire mal que celui qu'on se fait à soi-même, écrit l'évêque persécuté et bientôt abandonné à la mort.
-
SC 79

Sur la providence de Dieu
décembre 1961
Le scandale du mal, médité par l'évêque persécuté et bientôt abandonné à la mort.