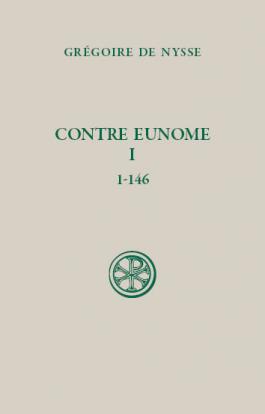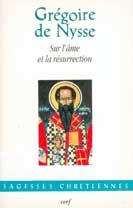-
SC 521
Grégoire de Nysse
Contre Eunome I, tome 1
1-146novembre 2008Texte grec (GNO I, 1) de W. Jaeger. — Introduction, traduction et notes par Raymond Winling.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.Révision assurée par Jean Reynard.ISBN : 9782204087162224 pagesIndisponible chez notre éditeurLe plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.Présentation
Le Contre Eunome de Grégoire de Nysse marque une étape dans les débats trinitaires qui ont dominé les Églises d'Orient dans la seconde moitié du IVe siècle. Dans un premier temps, Basile de Césarée avait rédigé un Contre Eunome pour réfuter l'Apologie du théologien néo-arien Eunome de Cyzique (SC 299 et 305). Ici, dans la deuxième manche qui date des années 380, Grégoire prend la défense de son frère récemment décédé et entreprend une réfutation de l'Apologie de l'Apologie qu'Eunome avait écrite en réponse à l'œuvre de Basile.
Après une longue introduction qui présente les principaux thèmes du Contre Eunome I, ce volume en contient la première partie, d'ordre historique : Grégoire y trace un portrait à charge d'Eunome et de son maître Aèce, et évoque les moments importants de la controverse.Raymond Winling, professeur émérite de la Faculté de Théologie Catholique de Strasbourg, a déjà publié dans la collection le Discours catéchétique de Grégoire de Nysse (SC 453).
Le mot des Sources Chrétiennes
Ce volume, premier d'une série, offre le porche d'une majestueuse cathédrale théologique édifiée par Grégoire de Nysse. L'évêque entre dans la polémique contre Eunome à la suite de son frère aîné Basile, disparu en 379 selon la datation traditionnelle. Grégoire a sans doute publié les deux premiers livres de son Contre Eunome en 381, juste avant le concile de Constantinople dont il sera l'un des acteurs, et le troisième et dernier livre en 383.
C'est de théologie trinitaire qu'il s'agit : Eunome fut le grand théoricien de l'arianisme dur, professant que le Fils est d'une autre substance que le Père et qu'il n'est pas Dieu. Il avait poussé loin la rationalité présente dans l'arianisme, et prétendait construire une théologie par déduction, à partir du fait que Dieu seul est l'inengendré, le sans-origine, ce qui selon Eunome définit son être même, c'est-à-dire sa substance. Le Fils, lui, est engendré par le Père : il ne peut donc qu'avoir un être différent du Père, être d'une substance dissemblable à la sienne. Voilà la thèse centrale d'Eunome et de ces derniers ariens qu'on appelait « anoméens », du mot grec (anomoios) qui signifie « dissemblable ».
Si ce premier volume est le porche de l'œuvre, c'est que nous ne sommes pas tout à fait dans l'édifice : le lecteur ne trouvera ici que le début du livre I du Contre Eunome, soit environ le quart du livre ; le reste devrait paraître au printemps 2009 (sous le n° 524). Dans ce début, Grégoire n'aborde pas encore le fond de la question, mais parle de la personne de son adversaire : son style, sa manière de polémiquer, ses rapports avec son maître Aèce, avec Basile. On ne trouvera donc pas de développements dogmatiques, mais des renseignements historiques, la toile de fond sur laquelle se joue cette dernière manche du débat trinitaire. La théologie viendra avec le prochain volume.Bernard Meunier
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Grégoire est entré dans la polémique contre Eunome à la suite de son frère aîné Basile, disparu en 379 selon la datation traditionnelle. Les deux premiers livres de son Contre Eunome ont sans doute été publiés en 381, juste avant le concile de Constantinople dont il fut l’un des acteurs, et le troisième et dernier livre en 383.
L’évêque de Nysse est l’auteur de trois livres Contre Eunome, dont le troisième fut très rapidement divisé par la tradition en dix livres. À ces ouvrages s’ajoute la Réfutation de la profession de foi d’Eunome. Dès le Ve siècle, l’ordre de transmission des livres fut bouleversé : le second livre du Contre Eunome, jugé plus spéculatif, ne suscita pas le même intérêt que les trois autres et les copistes prirent l’habitude de recopier la Réfutation à la place du quatrième. La Patrologia de Migne suivie par les savants de la fin du XIXe siècle, insista sur la nécessité de revoir l’ordre de publication des livres du traité de Grégoire.
Le texte grec ici édité n’est pas nouveau : il s’agit de celui des GNO (Gregorii Nysseni Opera, I, 1).
Les polémiques contre Eunome portent sur la théologie trinitaire. En effet, ce dernier fut le grand théoricien de l’arianisme dur, professant que le Fils est d’une autre substance que le Père et qu’il n’est pas Dieu. Il avait poussé loin la rationalité présente dans l’arianisme, et prétendait construire une théologie par déduction, à partir du fait que Dieu seul est l’inengendré, le sans-origine, ce qui selon Eunome définit son être même, c’est-à-dire sa substance. Le Fils, lui, est engendré par le Père : il ne peut donc qu’avoir un être différent du Père, être d’une substance dissemblable à la sienne. Voilà la thèse centrale d’Eunome et de ces derniers ariens qu’on appelait « anoméens », du mot grec anomoios qui signifie « dissemblable ». Eunome a-t-il été, comme le prétend Jérôme, un auteur fécond ? Rien ne permet de le savoir. Selon Philostorge, une grande partie de son œuvre a été brûlée. Toujours est-il qu’on connaît davantage sa pensée par le biais des écrits de ses adversaires – comme souvent dans les polémiques anti-hérétiques – que par celui des siens.
Grégoire a reçu l’Apologie de l’Apologie d’Eunome au moment de la mort de Basile, mais n’a eu le texte du traité sous les yeux que pendant dix-sept jours. Il eut cependant le temps de dicter à des secrétaires des fragments de réfutation du premier des deux livres. Dans le début du livre I contenu dans ce volume, soit environ le quart du livre, Grégoire n’aborde pas encore le fond de la question, mais parle de la personne de son adversaire : son style, sa manière de polémiquer, ses rapports avec son maître Aèce, ainsi qu’avec Basile, frère de Grégoire. Le volume offre donc peu de développements dogmatiques, et davantage de renseignements historiques, posant la toile de fond sur laquelle se joue cette dernière manche du débat trinitaire.
Extrait(s)
(Première partie, V, 30, p. 135)
Mais je veux éviter de m’attacher outre mesure aux choses inutiles par le fait même de justifier mon refus ; je veux aussi éviter que ce qui arrive à celui qui lance son cheval pour traverser un bourbier et qui est entièrement couvert de cette fange nauséabonde ne se produise aussi pour mon écrit qui serait souillé si je mentionnais en détail tout ce qui est contenu dans l’écrit d’Eunome. C’est pourquoi, j’estime que, dans la mesure du possible, il convient de sauter par-dessus toute cette fange d’un bond du discours, rapide et plein d’envol , – en effet, le fait de se retirer plus vie des choses désagréables procure un avantage appréciable – et de mener l’exposé rapidement vers la fin de la partie historique, de peur que les paroles de l’aigreur ne se répandent aussi dans mon traité.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 299

Contre Eunome, tome I
octobre 1982
Dieu ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu ? Magistrale réponse du grand Cappadocien.
-
SC 305

Contre Eunome, tome II
octobre 1983
Dieu ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu ? Magistrale réponse du grand Cappadocien.
Du même auteur
-
SC 644
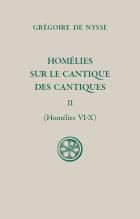
Homélies sur le Cantique des cantiques, tome II. Homélies VI-X
mars 2024
"De commencement en commencement", la pensée d'un progrès infini en Dieu, par le "fondateur de la mystique chrétienne"
-
SC 613
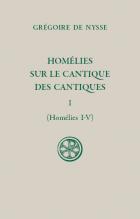
Homélies sur le Cantique des cantiques, tome I. Homélies I-V
janvier 2021
"De commencement en commencement", la pensée d'un progrès infini en Dieu, par le "fondateur de la mystique chrétienne"
-
SC 606

Trois oraisons funèbres et Sur les enfants morts prématurément
octobre 2019
Face à la mort d'un proche, d'un enfant, la promesse de la béatitude réaffirmée par un profond prédicateur et théologien dans les années 380.
-
SC 596
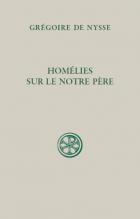
Homélies sur le Notre Père
juin 2018
« Ne faites pas de bla-bla » : la révélation de Dieu dans la prière, par l'un des plus prfonds théologiens du 4e siècle.
-
SC 588

Lettre canonique, Lettre sur la pythonisse et Six homélies pastorales
octobre 2017
Pour les pénitents, les pauvres, les lépreux, contre la fausse prophétie, les usuriers, les fornicateurs : les réponses de ce pasteur de Cappadoce ont traversé les siècles.
-
SC 584
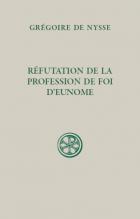
Réfutation de la Profession de foi d'Eunome
septembre 2016
Un condensé de la théologie trinitaire par le génial évêque de Nysse.
-
SC 573

Éloge de Grégoire le Thaumaturge, Éloge de Basile
octobre 2014
Un faiseur de miracles et un frère ? Ce qu'ont fait ces saints, chacun peut le faire, dit le Nyssène.
-
SC 551

Contre Eunome II
octobre 2013
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 524

Contre Eunome I, tome 2
octobre 2010
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 466

Sur les titres des psaumes
avril 2002
Un itinéraire spirituel vers le bonheur, à travers tout le Psautier, par le génial Cappadocien.
-
SC 453

Discours catéchétique
octobre 2000
Une synthèse de la foi, par un génie cappadocien.
-
SC 416

Homélies sur l’Ecclésiaste
juin 1996
Au cœur des vanités et du temps des hommes, le Christ, véritable ecclésiaste, appelle au temps de Dieu.
-
SC 363

Lettres
juin 1990
Un témoignage direct de la vie et la foi d'un génie du 4e siècle, en 28 lettres.
-
SC 178

Vie de sainte Macrine
décembre 1971
Le Socrate chrétien est une femme : c'est la grande sœur de Basile et de Grégoire, et leur premier modèle.
-
SC 119
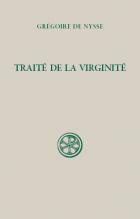
Traité de la Virginité
décembre 1966
Sens et valeur d'une voie privilégiée vers Dieu, vue par un homme marié.
-
SC 1 bis

Vie de Moïse
décembre 1955
De la contemplation des Écritures au progrès de l’homme en Dieu : le « manifeste » de la collection.
-
SC 6

La Création de l'homme
juin 1944
Comment expliquer les contradictions de l'être humain ? Par le plus philosophe des Cappadociens.
-