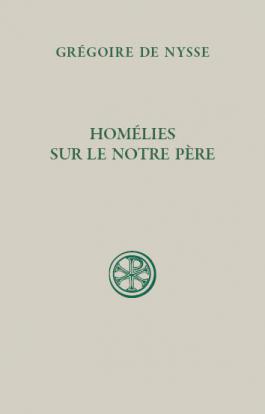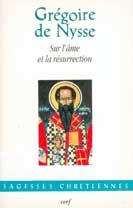-
SC 596
Grégoire de Nysse
Homélies sur le Notre Père
juin 2018Texte, introduction et notes de Christian Boudignon et Matthieu Cassin ; traduction de Josette Seguin (†), Christian Boudignon et Matthieu Cassin.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.Révision assurée par Guillaume Bady – Jean Reynard.ISBN : 9782204129718570 pagesIndisponible chez notre éditeur« Ne faites pas de bla-bla » : la révélation de Dieu dans la prière, par l'un des plus prfonds théologiens du 4e siècle.Présentation
Les Homélies sur le Notre Père de Grégoire de Nysse constituent une œuvre majeure sur la « prière du Seigneur ». Cette série de cinq homélies, qu’il faut situer non au début de la carrière de Grégoire mais dans ses dernières années, a connu une grande postérité, notamment la magnifique « hymne à la prière » de l’Homélie I.
À la fois prédication pastorale et exégèse de chacune des phrases du Notre Père – avec des variantes –, elles mettent en lumière l’adoption filiale des chrétiens et présentent la prière comme une conversation avec Dieu. Elles dénoncent aussi le « blabla » des prières creuses, en prônant un ascétisme allié au souci des plus pauvres. Leur nouveauté est plus marquante encore sur la nature du pain « quotidien », sur la venue de l’Esprit Saint comme règne de Dieu, sur le « Mauvais » comme Tentation personnifiée.
Avec une ample introduction sur les circonstances des Homélies, leur structure, leurs sources, leur exégèse du Notre Père et leur réception, ainsi que sur l’histoire des manuscrits, l’ouvrage offre un nouveau texte critique accompagné d’une traduction richement annotée.Christian Boudignon est maître de conférences en langue et littérature grecques à l’Université d’Aix-Marseille (AMU) et chercheur au Centre Paul-Albert Février (CNRS, TDMAM, UMR 7297). Il a publié l’édition critique de la Mystagogie de Maxime le Confesseur en 2011. Matthieu Cassin est chargé de recherche à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS, Paris). Spécialiste de Grégoire de Nysse, il a notamment publié en 2012 L’écriture de la controverse chez Grégoire de Nysse. Polémique littéraire et exégèse dans le Contre Eunome. Josette Seguin (1938-2006), chargée de cours à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers), a soutenu sa thèse en 2001 sur les présentes Homélies.
Le mot des Sources Chrétiennes
Ne faites pas de bla-bla (Mt 6, 7). Cette parole évangélique, qui, avant que l’on se mette à écrire quoi que ce soit, est propre à susciter une réflexion saine – quoique peut-être pas toujours assez décisive –, emploie un terme assez familier en grec (battologein) qu’essaye de rendre la présente traduction avec une fidélité il est vrai assez peu liturgique.
290 pages d’introduction embrassant : datation, circonstances et visée ; structure ; sources (Origène, mais aussi – surprenant intrus – Lucien de Samosate) ; exégèse ; éloquence ; conception de la prière ; filiation divine et parenté diabolique ; ascèse ; approche sociale ; texte néotestamentaire ; théologie du Saint-Esprit ; réception (Évagre le Pontique et Maxime le Confesseur) ; histoire du texte, versions orientales, tradition indirecte, éditions et traductions modernes, principes d’édition et différence avec le texte des Gregorii Nysseni Opera ; bibliographie ; 280 pages de texte critique, avec triple apparat (biblique, critique, mais aussi apparat des références dans les textes ultérieurs), traduction, notes et annexe : en tout 570 pages – et pas de « bla-bla », car elles sont non seulement substantielles, mais apportent beaucoup de nouveauté au texte, à sa compréhension et à son histoire. Elles sont d’ailleurs loin d’épuiser le sujet : un colloque international de quatre jours sur ces Homélies (voir p. 34) a marqué et complété la parution de ce volume.
Point besoin de « bla-bla » non plus pour dire que ces cinq Homélies sont l’une des œuvres patristiques majeures sur le Notre Père, ni pour célébrer le succès de l’hymne à la prière qu’a composée le Nysséen dans la première. Les quelques exemples qui suivent devraient suffire à montrer combien, malgré leur antiquité, elles font paraître ces formules de prière, qu’on croit bien connaître, sous un jour nouveau. Des formules ? Bien plus : pour Grégoire, une véritable révélation de Dieu, supérieure encore à la théophanie du mont Sinaï (voir l’exorde de l’Homélie II).
Ainsi, que signifie : Que ton règne vienne ? L’orateur exploite dans l’Homélie III une variante dans l’Évangile de Luc (11, 2) : Que ton Esprit Saint vienne sur nous et nous purifie. La variante est oubliée depuis longtemps, mais elle permet au frère de Basile d’en tirer une leçon intemporelle : le « règne », c’est l’Esprit lui-même, dont, à l’égal de celle du Père et du Fils, la divine royauté libère les êtres humains de la tyrannie du diable.
De même, dans l’Homélie IV, ne nous livre pas à la Tentation, mais délivre-nous du Mauvais : comme en contrepoint de la nouvelle traduction liturgique, celle-ci personnalise, avec dues majuscules, et la Tentation, et le Mauvais, à savoir le diable. Voilà qui appelle, pour le moins, un commentaire. Le Cappadocien appartient à un temps où le monde invisible – anges et démons – était perçu comme ayant autant de réalité que le visible. L’impact sur le sens du Notre Père et la spiritualité chrétienne en général est majeur : ce n’est pas seulement un effort éthique dans un monde matériel et contingent qui est en jeu, mais aussi, pour les Pères, un combat spirituel engageant aussi des forces immatérielles et ayant une valeur eschatologique.
Il est dès lors presque étonnant, et à plus d’un titre, de voir, dans l’Homélie IV encore, l’interprétation que Grégoire fait de la demande : Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. D’abord, parce que, tout en condamnant les demandes trop matérielles, il fait droit aux besoins corporels de chaque jour ; ensuite, parce qu’à la différence d’Origène, qui comprenait le mot grec epiousios comme désignant un pain « substantiel », avec tous les développements spirituels et eucharistiques que cela peut entraîner, le Nysséen y voit le pain « quotidien ». D’une certaine façon, le chrétien moderne peut le remercier : c’est en partie grâce à lui – paradoxalement, à l’époque son exégèse sur ce point était originale – qu’il peut non seulement oser demander davantage qu’un aliment pour la partie rationnelle de sa substance, mais employer des mots et des idées « de tous les jours ».
Enfin, il convient de souligner l’assimilation à Dieu, que Grégoire reconnaît à l’œuvre dans le Notre Père. Sans doute, dans l’histoire du christianisme occidental, la déification de l’être humain a-t‑elle été perçue de manière trop conceptuelle, trop ontologique, trop théologisée – oubliant qu’elle est avant tout une question éthique. Laissons sur ce sujet le dernier mot à l’antique pasteur :« Le discours a progressé jusqu’au point le plus élevé de la vertu ; car il dépeint par les mots de la prière comment il veut que soit celui qui s’avance vers Dieu : qu’il paraisse n’être presque plus dans les limites de la nature humaine mais devienne semblable à Dieu lui-même par la vertu, au point de sembler être un autre Dieu, en accomplissant ce qu’il revient à Dieu seul d’accomplir. Car la remise des dettes est propre à Dieu et sa prérogative ; il est dit en effet : Personne 'ne peut remettre les péchés sinon Dieu seul' (cf. Mt 2, 7 ; Lc 5, 21). Donc si quelqu’un imitait par sa propre vie les traits caractéristiques de la nature divine, il devient d’une certaine façon cela dont il a manifesté l’imitation par une ressemblance exacte » (Homélie V, 1, p. 479-481).
(G. Bady, 2018)
Guillaume Bady
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 6

La Création de l'homme
juin 1944
Comment expliquer les contradictions de l'être humain ? Par le plus philosophe des Cappadociens.
-
SC 1 bis

Vie de Moïse
décembre 1955
De la contemplation des Écritures au progrès de l’homme en Dieu : le « manifeste » de la collection.
-
SC 466

Sur les titres des psaumes
avril 2002
Un itinéraire spirituel vers le bonheur, à travers tout le Psautier, par le génial Cappadocien.
-
SC 416

Homélies sur l’Ecclésiaste
juin 1996
Au cœur des vanités et du temps des hommes, le Christ, véritable ecclésiaste, appelle au temps de Dieu.
-
SC 589

Chapitres sur la prière
octobre 2017
153 chapitres, autant de « poissons » spirituels à déguster.
-
SC 428
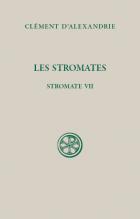
Les Stromates. Stromate VII
novembre 1997
Le portrait du vrai gnostique, ou les prémices de l'ouvrage ultime de Clément sur le Maître divin, au tournant des 2e et 3e siècles.
-
SC 42 bis
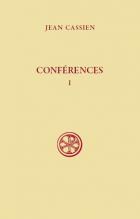
Conférences, tome I
décembre 1966
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 54

Conférences, tome II
décembre 1958
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 64

Conférences, tome III
décembre 1959
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 242
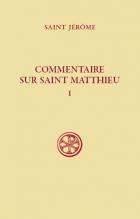
Commentaire sur saint Matthieu, tome I
janvier 1978
Sobre et rapide, un commentaire qui va à l'essentiel, par le plus savant exégète latin.
-
SC 164
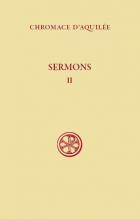
Sermons (18-41), tome II
décembre 1971
L'année liturgique éclairée par un évêque italien au tournant des 4e et 5e siècles.
Du même auteur
-
SC 644
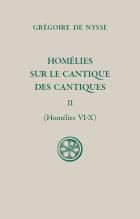
Homélies sur le Cantique des cantiques, tome II. Homélies VI-X
mars 2024
"De commencement en commencement", la pensée d'un progrès infini en Dieu, par le "fondateur de la mystique chrétienne"
-
SC 613
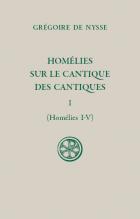
Homélies sur le Cantique des cantiques, tome I. Homélies I-V
janvier 2021
"De commencement en commencement", la pensée d'un progrès infini en Dieu, par le "fondateur de la mystique chrétienne"
-
SC 606

Trois oraisons funèbres et Sur les enfants morts prématurément
octobre 2019
Face à la mort d'un proche, d'un enfant, la promesse de la béatitude réaffirmée par un profond prédicateur et théologien dans les années 380.
-
SC 588

Lettre canonique, Lettre sur la pythonisse et Six homélies pastorales
octobre 2017
Pour les pénitents, les pauvres, les lépreux, contre la fausse prophétie, les usuriers, les fornicateurs : les réponses de ce pasteur de Cappadoce ont traversé les siècles.
-
SC 584
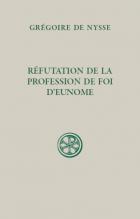
Réfutation de la Profession de foi d'Eunome
septembre 2016
Un condensé de la théologie trinitaire par le génial évêque de Nysse.
-
SC 573

Éloge de Grégoire le Thaumaturge, Éloge de Basile
octobre 2014
Un faiseur de miracles et un frère ? Ce qu'ont fait ces saints, chacun peut le faire, dit le Nyssène.
-
SC 551

Contre Eunome II
octobre 2013
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 524

Contre Eunome I, tome 2
octobre 2010
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 521

Contre Eunome I, tome 1
novembre 2008
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 466

Sur les titres des psaumes
avril 2002
Un itinéraire spirituel vers le bonheur, à travers tout le Psautier, par le génial Cappadocien.
-
SC 453

Discours catéchétique
octobre 2000
Une synthèse de la foi, par un génie cappadocien.
-
SC 416

Homélies sur l’Ecclésiaste
juin 1996
Au cœur des vanités et du temps des hommes, le Christ, véritable ecclésiaste, appelle au temps de Dieu.
-
SC 363

Lettres
juin 1990
Un témoignage direct de la vie et la foi d'un génie du 4e siècle, en 28 lettres.
-
SC 178

Vie de sainte Macrine
décembre 1971
Le Socrate chrétien est une femme : c'est la grande sœur de Basile et de Grégoire, et leur premier modèle.
-
SC 119
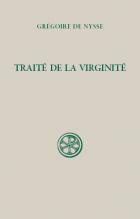
Traité de la Virginité
décembre 1966
Sens et valeur d'une voie privilégiée vers Dieu, vue par un homme marié.
-
SC 1 bis

Vie de Moïse
décembre 1955
De la contemplation des Écritures au progrès de l’homme en Dieu : le « manifeste » de la collection.
-
SC 6

La Création de l'homme
juin 1944
Comment expliquer les contradictions de l'être humain ? Par le plus philosophe des Cappadociens.
-