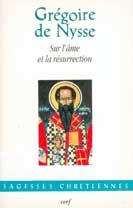-
SC 606
Grégoire de Nysse
Trois oraisons funèbres et Sur les enfants morts prématurément
octobre 2019Texte grec d’Andreas Spira (GNO IX) et Hadwiga Hörner (GNO III.2). Introduction, traduction et notes de Pierre Maraval.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.Révision assurée par Jean Reynard.ISBN : 9782204133562211 pagesFace à la mort d'un proche, d'un enfant, la promesse de la béatitude réaffirmée par un profond prédicateur et théologien dans les années 380.Présentation
Face au thème de la mort, Grégoire de Nysse s’est exprimé aussi bien comme pasteur et prédicateur que comme philosophe et théologien. Certaines occasions étaient solennelles. Les trois oraisons funèbres de ce volume ont en effet été prononcées à Constantinople, en présence de l’empereur Théodose. La première porte sur Mélèce d’Antioche, qui présidait en mai 381 le concile de Constantinople I, la deuxième sur l’impératrice Flacilla et la troisième sur Pulchérie, la fille de l’empereur. Transposant sur le plan de la foi les motifs rhétoriques de louange et les arguments philosophiques de consolation, Grégoire y trouve l’occasion de traiter de politique ecclésiastique et de dresser un portrait modèle de la souveraine chrétienne.
Le traité Sur les enfants morts prématurément approfondit la question du sort des défunts en s’attaquant à un problème fréquemment traité par des auteurs païens : comment justifier l’inégalité des vies humaines, la longue vie des méchants et la mort précoce des enfants ? Grégoire répond, comme les stoïciens, en se référant à la providence et à la finalité universelle, mais son explication en appelle surtout à la capacité de l’âme de comprendre Dieu : cette capacité, qui ne cesse de croître tout au long de la vie, si l’âme regarde vers Dieu et se purifie, doit se poursuivre dans l’éternité, tant pour les adultes que pour les enfants morts prématurément, tous promis à la béatitude.Pierre Maraval est Professeur émérite d’histoire des religions de l’Université Paris IV-Sorbonne. Il a publié des éditions et traductions de nombreux textes anciens (dont les Sources Chrétiennes 178, 296, 363, 477, 493, 505, 506, 573, 588) et plusieurs ouvrages sur l’histoire du christianisme des premiers siècles et de l’Antiquité tardive.
Le mot des Sources Chrétiennes
Comment se consoler de la mort d’un proche ? Et comment comprendre la plus douloureuse de toutes, celle d’un enfant ? La réponse du Nyssène, malgré quelques lamentos à l’effet pathétique attendu, est moins celle d’un homme sensible exprimant l’intime désarroi du cœur que celle d’un brillant évêque de cour et d’un profond théologien : avec les oraisons funèbres de Mélèce, de Flacilla et de Pulchérie, ainsi que le traité Sur les enfants morts prématurément, traduits sur le texte des Gregorii Nysseni Opera, les deux aspects sont associés en un même volume. Après la Vie de Macrine (SC 178), les Éloges de Grégoire le Thaumaturge et de Basile (SC 178), et en attendant le Discours sur les morts et le dialogue avec Macrine Sur l’âme et la résurrection, ils forment un ensemble assez cohérent dans l’œuvre de Grégoire : au croisement de la biographie, de l’encomiastique, du discours de consolation (tel est le genre précis de l’homélie sur Pulchérie et du De mortuis) et du traité philosophique, le thème de la mort est développé sous divers angles et toujours étroitement – et significativement – joint à celui de la vie.
Les trois homélies ont été prononcées à Constantinople, dans des circonstances solennelles. L’Éloge funèbre de Mélèce, l’évêque d’Antioche décédé alors qu’il présidait le concile que nous appelons « Constantinople I », en 381, témoigne implicitement du rôle joué par le Cappadocien en cette date capitale de l’histoire du dogme et de l’Église, non seulement dans la défense de la foi de Nicée – vue notamment par le prisme de son frère Basile, mort en 378 –, mais aussi de son crédit grandissant à la cour de l’empereur Théodose. En présence des membres du concile et de la famille impériale, il alterne lamentation, louange de l’Antiochien et consolation, tout comme il le fera, peut-être en 386, dans l’oraison funèbre de l’impératrice Flacilla, puis dans la consolation sur sa fille Pulchérie, éteinte à 6 ou 7 ans, quelques mois avant elle. L’évêque et théologien fait, à l’occasion, des deux premiers discours des manifestes nicéens, présentant Mélèce – pourtant contesté par beaucoup à l’époque – et l’impératrice comme des modèles d’orthodoxie. Le pasteur y reprend les thèmes classiques de la mort libérant des misères de la vie, en ouvrant de manière plus chrétienne sur celui de la résurrection et de la béatitude éternelle.
Ce dernier thème, le petit traité Sur les enfants morts prématurément, adressé en 381 ou en 385-386 à un certain Hiérios, le reprend et le développe. C’est même un texte de premier ordre, qu’affectionnent souvent les amateurs du Nyssène. À son destinataire lui soumettant une question philosophique traditionnelle – pourquoi le bonheur des méchants et le malheur des innocents, et « que faut-il penser de ceux qui sont enlevés à la vie avant l’heure ? » –, il répond tout d’abord en refusant de voir dans le malheur des innocents une rétribution de leurs actes, puis en soulignant la finalité de toute existence humaine : la contemplation de Dieu. À mort prématurée, béatitude précoce : dans l’au-delà les petits enfants pourront faire infiniment grandir la capacité à jouir de Dieu qu’ils n’ont pu développer ici-bas. Là est l’apport le plus original et lumineux de Grégoire, qui pour le reste, suivant l’héritage stoïcien, fait fond sur la Providence universelle de Dieu : « Il est probable, écrit-il (§ 17, p. 183), que celui qui connaît l’avenir comme le passé empêche que le petit enfant grandisse jusqu’à l’âge mûr pour que le mal à venir qu’il découvre par sa prescience ne se réalise pas. » — « Mais… », aurait-on envie de répondre comme le Zadig de Voltaire (chapitre 20) à l’ange Jesrad qui venait de tuer un jeune homme sous ce prétexte…(G. Bady, 2019)
Guillaume Bady
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 530

Histoire ecclésiastique, Tome II. Livres III-V
avril 2009
De 323 à 428, un siècle d'histoire vu comme une victoire de la foi, par un zélateur de l'Église d'Antioche.
-
SC 477

Histoire ecclésiastique, Livre I
décembre 2003
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 505

Histoire ecclésiastique, Livres IV-VI
novembre 2006
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 495
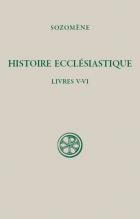
Histoire ecclésiastique, tome III
décembre 2005
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
Du même auteur
-
SC 644
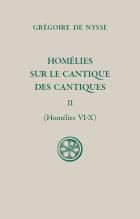
Homélies sur le Cantique des cantiques, tome II. Homélies VI-X
mars 2024
"De commencement en commencement", la pensée d'un progrès infini en Dieu, par le "fondateur de la mystique chrétienne"
-
SC 613
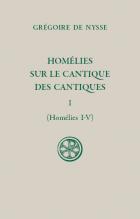
Homélies sur le Cantique des cantiques, tome I. Homélies I-V
janvier 2021
"De commencement en commencement", la pensée d'un progrès infini en Dieu, par le "fondateur de la mystique chrétienne"
-
SC 596
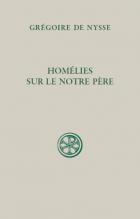
Homélies sur le Notre Père
juin 2018
« Ne faites pas de bla-bla » : la révélation de Dieu dans la prière, par l'un des plus prfonds théologiens du 4e siècle.
-
SC 588

Lettre canonique, Lettre sur la pythonisse et Six homélies pastorales
octobre 2017
Pour les pénitents, les pauvres, les lépreux, contre la fausse prophétie, les usuriers, les fornicateurs : les réponses de ce pasteur de Cappadoce ont traversé les siècles.
-
SC 584
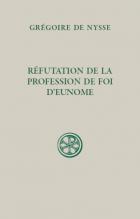
Réfutation de la Profession de foi d'Eunome
septembre 2016
Un condensé de la théologie trinitaire par le génial évêque de Nysse.
-
SC 573

Éloge de Grégoire le Thaumaturge, Éloge de Basile
octobre 2014
Un faiseur de miracles et un frère ? Ce qu'ont fait ces saints, chacun peut le faire, dit le Nyssène.
-
SC 551

Contre Eunome II
octobre 2013
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 524

Contre Eunome I, tome 2
octobre 2010
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 521

Contre Eunome I, tome 1
novembre 2008
Le plus ardu, le plus génial des traités du 4e siècle sur la Trinité.
-
SC 466

Sur les titres des psaumes
avril 2002
Un itinéraire spirituel vers le bonheur, à travers tout le Psautier, par le génial Cappadocien.
-
SC 453

Discours catéchétique
octobre 2000
Une synthèse de la foi, par un génie cappadocien.
-
SC 416

Homélies sur l’Ecclésiaste
juin 1996
Au cœur des vanités et du temps des hommes, le Christ, véritable ecclésiaste, appelle au temps de Dieu.
-
SC 363

Lettres
juin 1990
Un témoignage direct de la vie et la foi d'un génie du 4e siècle, en 28 lettres.
-
SC 178

Vie de sainte Macrine
décembre 1971
Le Socrate chrétien est une femme : c'est la grande sœur de Basile et de Grégoire, et leur premier modèle.
-
SC 119
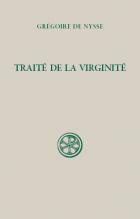
Traité de la Virginité
décembre 1966
Sens et valeur d'une voie privilégiée vers Dieu, vue par un homme marié.
-
SC 1 bis

Vie de Moïse
décembre 1955
De la contemplation des Écritures au progrès de l’homme en Dieu : le « manifeste » de la collection.
-
SC 6

La Création de l'homme
juin 1944
Comment expliquer les contradictions de l'être humain ? Par le plus philosophe des Cappadociens.
-