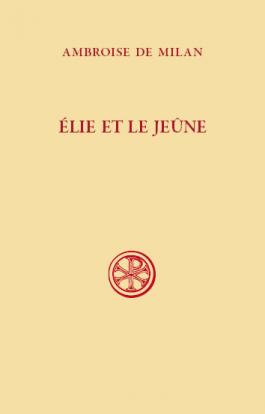-
SC 611
Ambroise de Milan
Élie et le jeûne
décembre 2020Texte, introduction, traduction et notes par Aline Canellis
Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre.Révision assurée par Laurence Mellerin.ISBN : 9782204139786298 pages«On prend conscience de la force de sa fermeté avec le jeûne»: le carême, par Ambroise
Présentation
Au début du carême, sans doute vers 389, l’évêque de Milan prêche sur fond d’une crise économique et sociale dont il est un analyste très perspicace. De sa prédication, il tire ce petit traité en trompe-l’oeil : Élie, mentionné dans la lecture du jour, semble très vite « congédié » par l’orateur au profit d’un sujet plus directement pastoral, le jeûne. Dans ce texte d’architecture soignée, tout en crescendo, Ambroise développe une apologie du jeûne, pour mieux l’opposer à son antithèse, l’ebrietas, dont il brosse un tableau haut en couleurs. Le traité culmine dans une présentation du jeûne comme préparation à la vie céleste, propre à mener les catéchumènes au baptême lors de la fête de Pâques.
Ce texte, ici donné dans une édition critique nouvelle, est un document de grande valeur pour la connaissance des pratiques ascétiques et de l’histoire sociale. Mais il intéressera aussi, par ses qualités littéraires, et notamment ses descriptions de la vie à Milan dans les milieux privilégiés, tout lecteur désireux de goûter la verve d’un écrivain de talent.Aline Canellis, professeur de langue et littérature latines à l’Université de Lyon (UJM - Saint-Étienne), est membre du laboratoire HiSoMA et de l’Académie Ambrosienne de Milan. Elle a édité en 2012 un colloque international consacré à la Correspondance d’Ambroise.
Le mot des Sources Chrétiennes
Ce petit traité d’Ambroise, écrit entre 387 et 390, est une version remaniée de plusieurs homélies prêchées par l’évêque de Milan, mêlant exégèse et pastorale dans un texte ciselé pour l’écriture, tout en restant marqué par l’oralité. Les effets oratoires et procédés rhétoriques abondent : Ambroise s’adresse avec vigueur à son auditoire, par le « nous » collectif ou le « tu » exhortatif, par des questions rhétoriques, des exclamations, des dialogues fictifs. Il fait aussi œuvre de pédagogue, explicitant les passages délicats des Écritures qu’il convoque. Il n’hésite pas à recourir à des anecdotes comiques – les ivrognes sont ainsi comparés aux éléphants qui aspergent les cabaretiers pour exprimer leur mécontentement (§ 65) – ou à des évocations très pittoresques et réalistes. Ainsi, cette description des hommes ivres :
« Ils sont sans voix, changent de couleur, ont des yeux de braise ; ils halètent en respirant par la bouche ; ils ont les narines qui frémissent… Souvent, ils enjambent les ombres comme des fossés. Pour eux la terre bouge : ils la voient soudain monter et descendre, comme si elle tournait. (…) Le bourdonnement dans leurs oreilles, c’est comme le grondement de la mer qui déferle et les rivages qui résonnent sous les déferlantes (§ 59-60). »
Difficile à percevoir, l’architecture de l’ensemble est beaucoup plus travaillée que l’impression de disparate d’une première lecture pourrait le laisser croire : les § 1-40 font l’apologie du jeûne en période de carême ; les § 41-68 fustigent son antithèse, les addictions à la nourriture et à la boisson, et tout spécialement l’ivrognerie, celle des hommes tout comme celle, plus honteuse et licencieuse encore, des femmes ; les § 69-85 critiquent l’intempérance, en particulier la cupidité et la luxure, par contraste avec le jeûne. L’ensemble a une finalité bien affirmée : préparer les catéchumènes à la réception de leur baptême au jour de Pâques, point culminant de l’ascension quadragésimale.
Comme à son habitude, Ambroise place sa réflexion sous l’égide d’un personnage biblique : après Jacob, figure de la vie heureuse (SC 534, paru en 2010), voici Élie, figure du jeûne. Le prophète a jeûné au désert, fait preuve de sobrietas dans son ascèse, et mérité ainsi de dominer les éléments et même la mort, puis de monter au ciel dans un char de feu. Il a de ce fait parcouru toutes les étapes de la vie chrétienne qui attendent les catéchumènes à qui Ambroise s’adresse, depuis le jeûne, prélude à une vie d’ascèse, jusqu’à la résurrection en Christ.
Cependant la geste d’Élie n’occupe qu’une part infime du traité, même si son exemple imprègne l’ensemble. Ambroise recourt en effet à de nombreuses autres figures bibliques pour étayer son propos : Moïse, Élisée, les trois enfants hébreux et Daniel, Jean Baptiste et bien sûr le Christ lui-même, éprouvé au désert par le tentateur pour répondre par le jeûne au péché de gourmandise des premiers parents. Les modèles sont aussi féminins : les mères de Samson et de Samuel ont rendu possible l’existence et les vertus de leurs fils respectifs grâce à leur jeûne ; Judith et Esther ont sauvé leur peuple de la même manière. On voit à l’abondance de ces exemples qu’Ambroise a une conception du jeûne qui déborde la simple notion de privation de nourriture : la sobrietas engage tout l’être. La façon dont il déforme une citation de Mt 26, 41, devenu « Jeûnez et priez pour ne pas entrer en tentation », montre bien qu’il s’agit pour lui d’une forme de veille spirituelle. Bien plus, le jeûne permet de revenir à la plénitude de l’acte créateur de Dieu : en amont du péché, « le tout premier état du monde fut celui du jeûne ». La création de la nourriture, au sixième jour, marque la fin d’un processus de croissance et le début d’une phase de déclin. Mais par la sobrietas, l’homme peut retrouver son état de nature, la grâce de sa création à l’image et ressemblance de Dieu. Alors que les débauchés et les ivrognes se changent en bêtes et s’avilissent, ceux qui jeûnent, comme Jean Baptiste, transforment « la nature de leur corps d’homme », jusqu’à mener « la vie des anges ». La pensée de l’évêque de Milan est ici profondément originale : il va jusqu’à établir un lien causal entre la naissance de l’ébriété, en la personne de Noé – inventeur et victime du vin –, et l’existence de l’esclavage (§ 11). L’ivresse fait perdre à l’homme la juste conscience de sa nature, et donc la mesure de son rapport à Dieu : elle le conduit à s’asservir lui-même à ses désirs charnels, à devenir une créature « superflue », qui a perdu la vertu de tempérance ; mais elle conduit aussi ceux qui observent l’homme ivre à le mépriser et l’asservir à leur tour. L’engrenage qui conduit de l’avilissement intérieur à la violence d’une société inégalitaire est mis en place, le prolongement social de la réflexion théologique d’Ambroise affleure déjà.
Cependant, à côté de cette « ébriété de la faute », il y a aussi une « ébriété de la grâce » (§ 61), celle que donne l’Esprit Saint à l’homme qui a retrouvé, par le jeûne, l’accord avec sa nature originelle. Initialement, la vigne a été créée pour réjouir l’homme, d’une joie corporelle en harmonie avec sa joie spirituelle ; de même, la mer a été créée pour sa subsistance, et non pour le commerce cupide. Le jeûne permet donc un retour à une proximité primitive avec le Dieu créateur, mais ce retour passe bien sûr par la rédemption du Christ : tout le traité d’Ambroise est bâti en crescendo, de l’exorde à la péroraison, de la préparation qu’est le carême jusqu’au baptême et à l’eucharistie de Pâques, pour définir le jeûne comme chemin de toute l’existence humaine, parcours de l’athlète dans le « stade spirituel » (§ 79) jusqu’à la récompense eschatologique. Le jeûne enveloppe l’âme, la met à l’abri du tentateur : il est « la mort de la faute, la fin des péchés » ; il permet à Moïse d’approcher Dieu au Sinaï sans danger et de recevoir la Loi ; « aliment du salut » (§ 22), « racine de la grâce », il fait parvenir l’homme à la sobria ebrietas que donne la coupe eucharistique, lui donne accès à la table mystique, celle où la nourriture des anges est de faire la volonté de Dieu : la « coupe qui enivre par la sobriété des mystères célestes se conquiert par la soif (§ 33) ». Élevant l’homme jusqu’au ciel de la glorification eschatologique, il est « substance et image du ciel ».
Pour traiter son sujet, Ambroise recourt à des sources variées, dont il sait, par un remarquable travail d’assimilation, composer une synthèse toute personnelle : outre les Écritures dont il parsème son texte, qu’il s’agisse de citations explicites ou d’allusions, il utilise abondamment Basile de Césarée, à travers quatre de ses homélies (sur le jeûne, contre les ivrognes, et d’exhortation au saint baptême). Le traité de Tertullien sur le jeûne, mais surtout des sources grecques comme Philon et Origène, sont aussi à l’arrière-plan de sa rédaction. Quant aux auteurs païens, ils sont largement sollicités dans les descriptions hautes en couleur des ripailles de la société milanaise : la préparation du banquet des § 24-25 rappelle aussi bien le Satyricon de Pétrone que les comédies de Plaute ou les Satires de Juvénal :
« Que l’intendant reste tranquille, lui qui, avant l’aube, tambourine à la porte d’autrui et qui, comme si la guerre menaçait, fait lever ceux qui dorment ! Tu le vois dans tous ses états, tu le sens à bout de souffle. C’est que, répond-il, mon maître reçoit ! Il cherche où se vend un vin meilleur, où se prépare une vulve de truie plus ferme, un foie plus tendre, un faisan plus dodu, un poisson plus frais ! »
Au-delà du talent littéraire que son écrit révèle, Ambroise entend brosser un tableau très critique de la société inégalitaire dans laquelle il vit. Tout le traité se déroule sur fond d’une crise économique et sociale génératrice de multiples injustices qu’il dénonce sans relâche, ici comme dans le De Naboth par exemple. L’usure et la cupidité sont mises sur le même plan que l’ébriété : les commerçants qui utilisent la mer à mauvais escient manifestent une recherche de profit tout aussi addictive que la consommation de vin. L’ébriété des ivrognes, lointain reflet, déformé, de la sobre ivresse spirituelle, fait percevoir sur le mode de l’illusion quelque chose d’une société idéale, où tous les hommes seraient égaux, riches de tous leurs désirs assouvis. Sous l’emprise de l’alcool, « le pauvre ne le cède en rien au riche, vu qu’il ignore sa pauvreté » (§ 44). Quant au jeûne lui-même, il plaît à Dieu si, dans la veine évangélique, il n’est pas ostentatoire, mais surtout s’il « coupe » aussi « toutes les attaches de l’injustice » (§ 34).
Signalons enfin que ce volume donne à lire le traité dans une édition critique à nouveaux frais : s’appuyant sur les manuscrits anciens déjà repérés et utilisés par les éditeurs précédents, Karl Schenkl en 1897, Sergio Zincone en 1976 et Francesco Gori en 1985, la présente édition ajoute des sondages effectués dans douze nouveaux manuscrits que ces éditeurs ne connaissaient pas, et intègre les leçons des principales éditions anciennes. Une vingtaine de variantes sont ainsi proposées.Laurence Mellerin
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Élie et le jeûne
Au confluent de l’oralité et de la littérarité, de la pastorale et de l’exégèse, le traité De Helia et ieiunio offre une architecture soignée et révèle une utilisation habile de sources diverses, au service d’une argumentation oratoire et parénétique, toujours étayée par les Écritures.
Composé à une date incertaine entre 387 et 390, le traité a été élaboré à partir d’homélies réellement prononcées en chaire par l’évêque de Milan au début du carême. Le De Helia est écrit sur fond de crise économique et sociale, où les plus démunis connaissaient la misère et la famine. Riche, grand propriétaire terrien, Ambroise comprenait parfaitement le danger des grandes exploitations agricoles qui se développaient dans l’Italie septentrionale aux dépens des petits fermiers, et les conséquences désastreuses de l’auaritia. Le traité aborde en une structure tripartite les thèmes du jeûne en période de carême, des vices que sont l’addiction à la nourriture et à la boisson liées à la débauche, et, pour finir, de l’intempérance en général, illustrée en particulier par la cupidité.
La réflexion sur le jeûne recourra à plusieurs figures bibliques : Élie et Jean, Moïse, Élisée et Daniel. À Élie, Élisée, Jean et Daniel, Ambroise associe la qualité qu’est la sobrietas et son contre-exemple, l’ebrietas. Rappelant l’intempérance des juifs qui les empêcha de gagner la Terre promise (sauf Caleb et Josué), il fustige cette intempérance qui privera les chrétiens du Royaume des cieux, s’ils ne respectent pas la règle de foi et de conduite préconisée par Dieu, en particulier le jeûne quadragésimal. Or, le modèle par excellence de cette temperantia est précisément Élie, symbole de la « vie angélique », qui a jeûné au désert, fait preuve de sobriété et mérité de monter au ciel sur un char de feu, préfigurant toutes les étapes de la vie chrétienne, qui sont, pour le catéchumène, le parcours initiatique avec notamment le jeûne quadragésimal, et les trois sacrements qu’il reçoit : baptême, confirmation et eucharistie, dont témoignent les écrits catéchétiques d’Ambroise ; et, pour le baptisé, après l’étape du baptême, la vie consacrée au Christ et la résurrection, « couronne » glorieuse obtenue le jour du Jugement au prix d’efforts constants.
Le De Helia s’inspire essentiellement de sources grecques, en l’occurrence de plusieurs homélies de Basile, l’évêque de Césarée en Cappadoce avec lequel l’évêque de Milan avait des contacts épistolaires. Il se situe également dans la tradition de Tertullien, Origène et Jérôme.
Extrait(s)
75. « Donc, puisque nous avons un Seigneur si miséricordieux qu’il fait remise de l’erreur, même grave, détournons-nous des vices, ne nous écartons-pas de la Loi, exécutons les préceptes du Seigneur, comme des serviteurs, avec soin et sincérité ! Quel rapport entre nous et les impuretés et impudicités ? Quel rapport avec les œuvres du diable ? Vous avez entendu aujourd’hui, dans la lecture qui a été faite, ce qu’a dit Légion (cf. Lc 8, 30) : Quel rapport entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu ( Lc 8, 28) ? Et toi, si d’aventure tu vois lutter contre toi les tentations du diable, dis : « Quel rapport entre moi et toi, Bélial (Cf. 2 Co 6, 15) ? Moi, je suis le serviteur du Christ ; c’est par son sang que j’ai été racheté ; c’est à lui que je me suis soumis tout entier. Quel rapport entre moi et toi ? Tes œuvres, je ne les connais en rien ; de toi, je ne recherche rien ; de toi, je ne possède rien ; de toi, je ne désire rien ! » Combien plus encore faut-il que nous soyons séparés du diable puisque lui-même s’éloigne du Christ ! Et si nous avons été si peu que ce soit sous sa dépendance, nous ne le sommes plus. Nous avons trouvé refuge auprès du Médecin (Cf. Lc 5, 31-32). Il a soigné nos blessures passées et, s’il reste quelques maux, il ne manquera pas de remède. Même si nous avons commis quelque offense, il ne s’en souviendra pas, lui qui a pardonné une fois pour toutes. Même si nous avons fait de graves fautes, nous avons trouvé un grand médecin, nous avons reçu la grande médecine de sa grâce ; en effet la médecine fait disparaître les grands péchés (Qo 10, 4). » (p. 259-261)
Errata
Page Localisation Texte concerné Correction Remarques 141 app. script, l. 4 et n. 2 fuisset / ébriété2 fuisseta / ébriétéa2
ajouter dans l’apparat scripturaire : a. Cf. Gn 9, 26
ajouter au début de la note 2 : Cf. Ep. 7, 6. 9 (CSEL 82.1, p. 45-47), où Ambroise lie plus explicitement ce raisonnement au texte biblique.et décaler en conséquence les lettres d’apparat scripturaire du paragraphe, et reporter dans l’index scripturaire. 283 2e par., l. 4 mais parce que, jouissant mais que, jouissant
Du même auteur
-
SC 630

Sur la mort de Valentinien II
octobre 2022
Un jeune empereur mort au seuil du baptême: assasinat ou suicide? Un défi pour Ambroise
-
SC 629
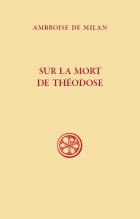
Sur la mort de Théodose
octobre 2022
Milan, 395. Le prince des orateurs chrétiens s'adresse à deux orphelins, princes héritiers de l'empire romain
-
SC 576

La fuite du siècle
octobre 2015
Une fuite ? Plutôt un voyage du mal vers le bien, selon la méditation de l'évêque de Milan.
-
SC 534
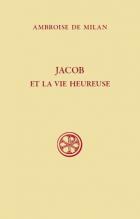
Jacob et la vie heureuse
juillet 2010
Petit manuel de sagesse chrétienne, à travers l'histoire du patriarche.
-
SC 239
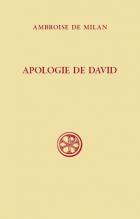
Apologie de David
septembre 1977
David, un modèle pour l'empereur Théodose, et pour les chrétiens de tous les temps.
-
SC 179
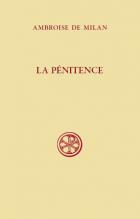
La Pénitence
décembre 1971
L'Église a-t-elle le droit d'imposer une pénitence publique ? Entre miséricorde et autorité, la réponse de l'évêque de Milan.
-
SC 25 bis
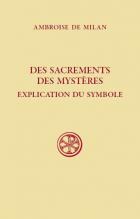
Des sacrements. Des mystères. Explication du symbole
décembre 1961
La clé de la liturgie et de la foi, par l'homme qui a baptisé Augustin en 387.
-
SC 52
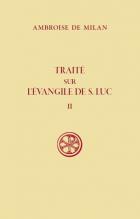
Traité sur l'Évangile de S. Luc, tome II
décembre 1958
Après Origène, le commentaire de Luc.
-
SC 45
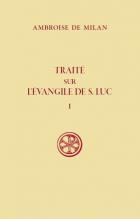
Traité sur l'Évangile de S. Luc, tome I
décembre 1956
Après Origène, le commentaire de Luc.