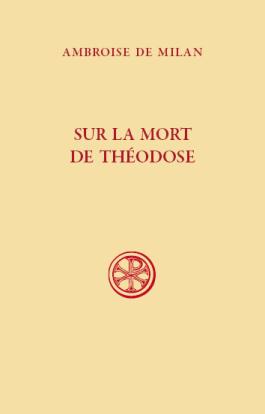-
SC 629
Ambroise de Milan
Sur la mort de Théodose
octobre 2022Texte latin de Victoria Zimmerl-Panagl (CSEL 106) — Introduction, traduction et notes par Yves-Marie Duval et Benoît Gain.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre et de la Fondation Saint-Irénée.Révision assurée par Isabelle Brunetière.ISBN : 9782204147514329 pagesMilan, 395. Le prince des orateurs chrétiens s'adresse à deux orphelins, princes héritiers de l'empire romain
Présentation
Le 17 janvier 395, Théodose Ier (le Grand), seul empereur régnant, meurt subitement à Milan, à l’âge de cinquante ans à peine. Au mois de septembre précédent, à la bataille du Frigidus (la rivière Froide, en Slovénie actuelle), il a triomphé de l’usurpateur Eugène, artisan d’une « réaction païenne ». À cette date, longtemps tenue pour une charnière entre l’Antiquité et le Moyen Âge, le pouvoir impérial n’est pas pleinement assuré, d’autant que Théodose laisse deux fils, âgés seulement de dix-sept et dix ans : Arcadius et Honorius.
Lors des funérailles célébrées quarante jours plus tard, Ambroise de Milan, qui s’était entretenu peu avant avec l’empereur, se montre pleinement conscient de la gravité de la situation politique. Il invite tout d’abord les deux fils, Arcadius et Honorius, à continuer l’œuvre de leur père ; puis, faisant l’éloge des vertus chrétiennes, il prône la clémence et place, dans la bouche de Théodose, les paroles du Psaume 114, développant ensuite l’éloge de l’empereur défunt et concluant sur les retrouvailles célestes.
Cette oraison funèbre présente la particularité de contenir aussi un long développement narratif : la découverte à Jérusalem par Hélène, mère de Constantin, de la Croix et des clous de la Passion, puis leur présence sur le diadème, rappelant aux deux fils leurs devoirs – des recommandations dignes d’un « miroir des princes », dont la postérité se souviendra.Yves-Marie Duval († 2007), professeur à l’Université de Paris-X Nanterre, spécialiste de Jérôme et d’Ambroise, n’ayant pu achever cette édition, c’est Benoît Gain, l’un de ses disciples et amis, professeur de langue et littérature latines à l’Université de Grenoble Alpes, qui a complété et mis à jour le dossier.
Le mot des Sources Chrétiennes
Un discours impérial chez les chrétiens ? Vantant les mérites d’un souverain terrestre, Eusèbe de Césarée avait célébré Constantin ; Ambroise de Milan illustre à son tour le basilikos logos avec l’oraison funèbre de celui qui, en faisant prévaloir la foi de Nicée après des décennies de crise religieuse, ecclésiale et politique, est l’autre modèle antique du « roi très-chrétien » : Théodose Ier (le Grand), décédé à Milan le 17 janvier 395. Quarante jours plus tard, l’évêque renouvelle le genre sans trop se préoccuper des règles. Dans ce moment politiquement si critique, faisant fi du contraste des registres, il tente ainsi de faire passer un message politique et social, sans qu’on sache si c’est en faveur des pauvres… ou des riches (§ 5, p. 155) :
Le départ d’un prince si grand, qui avait déjà tout remis à ses fils – empire, puissance, titre d’Auguste – n’a rien eu de plus glorieux, rien, dis-je, ne lui fut réservé de plus beau dans la mort que le fait que voici : la suppression de la taxe sur l’annone, qui avait été promise, ayant pris du retard – retard cruel pour tant de gens ! (…) Quoi de plus digne pour un empereur qu’une loi comme testament !
Par sa clémence, Théodose dépasse ainsi « le plus grand des philosophes » et réalise rien moins que l’idéal platonicien du philosophe-roi. Mais c’est David qui, implicitement, s’impose plutôt, en tant que roi-psalmiste. Le psaume 114 ayant été récité pendant la liturgie funéraire, Ambroise met dans la bouche de l’empereur le premier verset : « J’ai aimé », répété et longuement interprété en guise de bilan moral – deux mots que le prédicateur reprend aussi à son compte pour exprimer ses sentiments vis-à-vis du défunt (§ 33). S’ensuit un tableau triomphal, où Théodose devient vraiment roi en retrouvant au ciel le seul vrai Roi, le Christ (§ 40). Il retrouve aussi, entre autres, Constantin et Hélène, la mère de celui-ci. Dans ce qui est parfois qualifié de digression, voire d’addition postérieure, aux § 41-51, le Milanais nous livre après Eusèbe le plus important récit de l’Invention de la Croix par la mère de Constantin, en 325 ou 326. C’est l’occasion pour lui de souligner l’importance des clous de la Passion : utilisés comme frein de cheval, ils symbolisent la maîtrise des passions et la mesure dans l’exercice du pouvoir ; sertis dans le diadème impérial, ils transpercent les péchés et servent de « gouverne » au monde – Ambroise joue ici sur le double sens du mot en latin, clauus désignant aussi un gouvernail. Un message directement adressé à Honorius, l’un des deux fils de Théodose (l’autre, Arcadius, est absent), dans ce qui a été retenu par la postérité comme un véritable « miroir des princes ».
À sa façon, ce volume est aussi un hommage posthume à un « empereur » des études patristiques latines, Yves-Marie Duval, dont Benoît Gain a ici tiré le meilleur des travaux conservés. Le lecteur bénéficie aussi de la nouvelle édition du texte latin par V. Zimmerl-Panagl, ici reprise du CSEL. Pour ne rien gâcher, le livre est d’un prix assez modique (comme le volume suivant) qui serait somme toute conforme aux souhaits impériaux et ambrosiens, grâce notamment au Centre national du livre, dont le soutien régulier – mais à des conditions de plus en plus restrictives, excluant notamment texte et traduction, même en cas d’editio princeps, comme parties « non originales » – est capital pour nombre de nos volumes.Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Sur la mort de Théodose
Empereur d’Orient depuis le 19 janvier 379, Théodose meurt à Milan dans la nuit du 17 janvier 395. Peu après sa victoire à la bataille de la rivière Froide, qui marque la fin du paganisme officiel en Occident, Théodose avait fait venir de Constantinople à Milan son deuxième fils, Honorius, un garçon de dix ans à peine, dont il voulait faire l’empereur d’Occident, et avait laissé à Constantinople son aîné, Arcadius, pour diriger l’Orient. Mais comme, depuis Constantin, les empereurs régnant sur l’Orient étaient inhumés dans le mausolée impérial, l’église des Saints-Apôtres, à Constantinople, Ambroise prononce cette oraison funèbre non pas au lendemain de la mort de Théodose, mais quarante jours après, au moment où le corps va être transporté à Constantinople. Dans le cas de cette oraison funèbre de l’empereur, Ambroise avait probablement rédigé intégralement son discours, ne laissant rien à l’improvisation afin de ne pas courir le risque de froisser les membres de la famille impériale.
De Théodose Ambroise souligne en particulier la miséricorde ; il rappellera ainsi quelques actes de clémence de l’empereur. Il ne retrace pas la carrière de l’empereur, mais seulement quelques touches bien choisies : il s’étend sur sa clémence et sa justice (iustitia), ou plus exactement sa foi (fides) et son humilité. Il veut montrer que Théodose a bien mis en œuvre les préceptes de l’Écriture concernant l’homme miséricordieux et le bon roi. Mais les maximes des Sages de la Bible – Salomon, David – ne sont pas très éloignées de la réflexion philosophique profane sur les vertus du bon prince. En particulier, Théodose l’emporte sur les maximes « du plus grand des philosophes » (Platon) en ne cédant pas à la colère, comme le lui recommandait l’Écriture. Le Ps 114 est commenté en détail et est appliqué à la personne de Théodose, puis par Ambroise à sa propre personne, avec le topos de la libération des soucis du monde. Théodose a « aimé », selon les premiers mots du psaume, et il a « aimé le Seigneur son Dieu », selon le premier commandement de la Loi ; il partage donc la « compagnie des saints », c’est-à-dire qu’il est à jamais dans le pays des vivants évoqué par les derniers mots du psaume : pas ici de vision de Dieu face à face, mais l’entrée dans une nouvelle Cité. Une importante digression (§ 41-50), mais pas nécessairement une addition postérieure, dans l’éloge funèbre est le récit de la découverte de la Croix et des clous par Hélène. Le but principal de l’orateur est de donner à Honorius une leçon de gouvernement, en évoquant l’envoi à son fils par Hélène des deux clous de la croix du Christ qui doivent inspirer sa conduite personnelle et son empire. D’un bout à l’autre, il s’agit bien d’exalter la conduite de l’empereur, mais de telle façon qu’elle devienne un exemple pour son fils, invité pour finir à faire passer ses devoirs avant ses sentiments.
Extrait(s)
22. J’ai aimé (Ps 114, 1), dit Théodose. Aussi ai-je accompli par amour la volonté du Seigneur, et je l’ai invoqué non pas quelquefois, mais tous les jours de ma vie. Car, invoquer Dieu certains jours, et non pas tous les jours, c’est faire preuve de dédain, et non pas d’espérance ; c’est témoigner sa reconnaissance en retour pour l’usage des avantages qui ont afflué vers vous, et non pas par affection et par dévotion. C’est pourquoi Paul déclare : Remerciez en toute circonstance (1 Th 5, 18). Quand se trouve-t-il, en effet, que tu aies quelque chose sans que tu ne le doives à Dieu ? ou bien, quand te trouves-tu sans bienfait venant de Dieu, toi qui, chaque jour, jouis de la vie grâce au Seigneur ? Qu’as-tu en effet que tu n’aies pas reçu ? (1 Co 4, 7) Donc, puisque tu reçois sans cesse, invoque sans cesse et, puisque ce que tu as vient du Seigneur, apprends à te considérer sans cesse comme son débiteur. Je préfère cependant que tu t’acquittes de ta dette par amour plutôt que par contrainte. (§ 22, p. 181)
Errata
Page Localisation Texte concerné Correction Remarques
Du même auteur
-
SC 630

Sur la mort de Valentinien II
octobre 2022
Un jeune empereur mort au seuil du baptême: assasinat ou suicide? Un défi pour Ambroise
-
SC 611
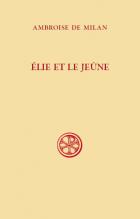
Élie et le jeûne
décembre 2020
«On prend conscience de la force de sa fermeté avec le jeûne»: le carême, par Ambroise
-
SC 576

La fuite du siècle
octobre 2015
Une fuite ? Plutôt un voyage du mal vers le bien, selon la méditation de l'évêque de Milan.
-
SC 534
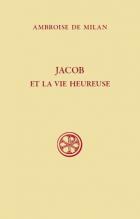
Jacob et la vie heureuse
juillet 2010
Petit manuel de sagesse chrétienne, à travers l'histoire du patriarche.
-
SC 239
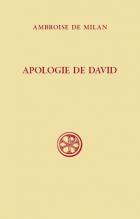
Apologie de David
septembre 1977
David, un modèle pour l'empereur Théodose, et pour les chrétiens de tous les temps.
-
SC 179
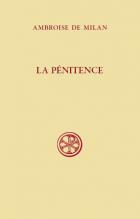
La Pénitence
décembre 1971
L'Église a-t-elle le droit d'imposer une pénitence publique ? Entre miséricorde et autorité, la réponse de l'évêque de Milan.
-
SC 25 bis
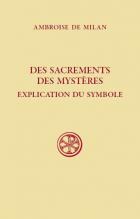
Des sacrements. Des mystères. Explication du symbole
décembre 1961
La clé de la liturgie et de la foi, par l'homme qui a baptisé Augustin en 387.
-
SC 52
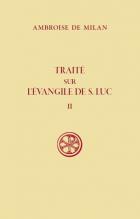
Traité sur l'Évangile de S. Luc, tome II
décembre 1958
Après Origène, le commentaire de Luc.
-
SC 45
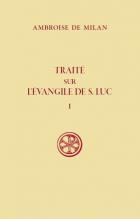
Traité sur l'Évangile de S. Luc, tome I
décembre 1956
Après Origène, le commentaire de Luc.