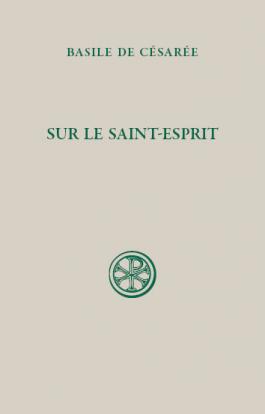-
SC 17 bis
Basile de Césarée
Sur le Saint-Esprit
décembre 1968Introduction, texte, traduction et notes par Benoît Pruche, o.p.
Deuxième édition revue et augmentée (remplace le n° 17 paru en 1947)ISBN : 9782204071192561 pagesIndisponible chez notre éditeur« Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire » : un credo inspiré de Basile.Présentation
Pour avoir employé, à côté de la doxologie traditionnelle « Gloire au Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit », la doxologie « Gloire au Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit », Basile s'était vu accuser d'utiliser deux formules contradictoires. En réalité, la seconde privait à la fois les ariens et les pneumatomaques de l'argument qu'ils tiraient des prépositions utilisées dans la doxologie traditionnelle pour établir l'infériorité du Fils et de l'Esprit par rapport au Père. À l'origine de l'ouvrage, il y aurait donc, de la part de Basile, un désir de justification. Amphiloque d'Iconium, qui l'a interrogé sur la signification de ces particules grammaticales, lui en fournit le prétexte. Toutefois, l'enseignement sur le Saint-Esprit délivré par Basile, en 375, pour répondre à son attente, est de toute évidence le fruit d'une longue maturation.
Toute sa démonstration vise à établir l'homotimie – l'égalité d'honneur –, de l'Esprit avec le Père et avec le Fils, à partir de l'Écriture et de la Tradition. L'examen attentif des particules dans chaque formule étudiée, à commencer par la formule baptismale, confirme cette homotimie du Fils avec le Père, et de l'Esprit avec le Père et le Fils. Utiliser avec dans la doxologie, pour glorifier l'Esprit, est donc parfaitement légitime.
Jamais pourtant, la divinité ou la consubstantialité de l'Esprit ne sont ouvertement affirmées par Basile. Ce silence, à première vue surprenant, au regard de toute la démonstration, est sans doute « politique ». L'introduction par Basile du terme homoousios – il l'évite ici, même pour le Fils – aurait risqué d'accroître encore les divisions dans l'Église, s'il l'avait appliqué au Saint-Esprit. Son traité n'en a pas moins influencé profondément la réflexion théologique postérieure, en Orient comme en Occident. Entre les conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381), il marque une étape décisive dans l'élaboration de la théologie du Saint-Esprit.Benoît Pruche, o.p., a longtemps enseigné aux Facultés Dominicaines d'Ottawa et de Montréal.
Le mot des Sources Chrétiennes
La réimpression du traité de Basile de Césarée, Sur le Saint-Esprit (SC 17 bis), dans la seconde édition (1968) qu'en avait donnée le P. Benoît Pruche, permet, elle aussi, de remettre en circulation un volume depuis longtemps épuisé.
Il s'agit là d'un texte particulièrement important du point de l'élaboration du dogme trinitaire. Qu'il soit de nouveau disponible réjouira sans aucun doute autant les théologiens que les historiens de la crise arienne et de ses prolongements. À la suite des hérétiques ariens, qui s'acharnaient surtout à nier la divinité du Fils et son égalité avec le Père – le Fils n'était pour eux qu'un Dieu inférieur et un être créé, même s'il était la première des créatures –, les adversaires de la divinité de l'Esprit Saint, les « pneumatomaques », établissaient, eux aussi, un hiérarchie entre les trois personnes de la Trinité. Comme le Fils, l'Esprit était tenu par eux pour inférieur au Père, il avait lui aussi rang de créature, il n'était qu'un « serviteur », semblable en quelque sorte aux anges.
Avec ce traité, achevé en 375, Basile poursuit d'une certaine manière le combat engagé, dix ans plus tôt, contre l'évêque Eunome, un théoricien particulièrement redoutable et habile d'un arianisme radical (voir Basile de Césarée, Contre Eunome, SC 299 et 305). L'occasion du traité serait double. Basile se serait vu reprocher, un jour, par certains de ses auditeurs, d'avoir utilisé tour à tour, pour conclure la prière, la doxologie usuelle « Gloire au Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit », et une doxologie, à leurs yeux, étrange et contradictoire « Gloire au Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit ». Il lui fallait donc se justifier. D'autre part, il se devait aussi de répondre à une demande de l'évêque Amphiloque d'Iconium, un cousin de Grégoire de Nazianze, qui l'avait interrogé sur la signification théologique de ces mêmes particules grammaticales. Il semble bien qu'Amphiloque ait seulement fourni à Basile un prétexte, et que l'enseignement sur le Saint-Esprit, délivré dans ce traité, soit en réalité le fruit d'une longue maturation.
La doxologie incriminée par les ariens et les pneumatomaques les privait, en effet, de l'argument qu'ils prétendaient tirer de l'emploi des prépositions « par et dans », présentes dans la doxologie la plus usuelle, pour établir l'infériorité du Fils et de l'Esprit par rapport au Père et souligner ainsi leur différence de nature. Toute la démonstration de Basile vise donc à établir l'homotimie – l'égalité d'honneur –, de l'Esprit avec le Père et avec le Fils, à partir de l'Écriture et de la Tradition. L'examen attentif des particules et des prépositions dans chacune des formules étudiées, et en particulier dans la formule baptismale, confirme dans tous les cas la reconnaissance de l'homotimie du Fils avec le Père, et de l'Esprit avec le Père et le Fils. La doxologie incriminée – l'emploi de « avec » – est donc parfaitement légitime, n'en déplaise aux pneumatomaques. De chapitre en chapitre, on mesure ainsi l'importance que revêtent ces particules du point de vue de la théologie trinitaire.
Déclarer l'homotimie du Saint-Esprit, c'est l'affirmer consubstantiel au Père et au Fils. C'est bien la conclusion qui s'impose à la lecture du traité, le but auquel tend toute la démonstration. Or, à aucun moment, la divinité ou la consubstantialité de l'Esprit ne sont ouvertement affirmées par Basile. Ce silence, à première vue surprenant, est sans doute « politique » : l'introduction du terme homoousios, que Basile s'abstient même ici d'utiliser en parlant du Fils, aurait risqué de déchirer davantage encore l'Église, s'il avait été appliqué au Saint-Esprit. En dépit de ce silence, le traité de Basile a largement influencé la réflexion théologique postérieure, en Orient comme en Occident, et marque, entre les conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381), une étape décisive sur la voie de la définition de la consubstantialité du Saint-Esprit.Jean-Noël Guinot
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Basile écrit son traité autour de 375 à la demande de son ami Amphiloque, évêque d’Iconium. Ses adversaires lui reprochaient d’employer un langage nouveau à propos du Saint Esprit (dans la doxologie : « Gloire au Père avec le Fils, avec l’Esprit », au lieu du traditionnel : « Gloire au Père, par le Fils, dans l’Esprit »). Basile examine de près l’usage de l’église et celui de l’écriture en matière de particules, pour conclure à la légitimité de sa propre pratique. Il explique en outre, sans le dire ouvertement, que l’Esprit est Dieu comme le Père et le Fils et peut être co-glorifié avec eux. Le traité a été rédigé en quelques mois et ajoute à la fin des citations de quelques Pères, mettant explicitement en œuvre, à peu près pour la première fois, l’argument patristique comme autorité en théologie. L’œuvre de Basile, dont l’influence fut grande, contribuera à affirmer la divinité du Saint Esprit au concile de Constantinople (381) quelques années après sa mort.
L’œuvre a été transmise en grec par plus de 30 manuscrits dont le plus ancien est du 10e siècle. Une version syriaque se trouve déjà dans deux témoins du 5e et du 6e siècle. L’authenticité basilienne du traité ne fait pas de doute malgré les soupçons d’Érasme. Il est cité, sous le nom de Basile, dès l’époque du concile d’Éphèse par Cyrille d’Alexandrie et Théodoret de Cyr, puis vers la fin du 5e siècle par Philoxène de Mabboug et au début du 6e siècle par Sévère d’Antioche.
Contenu
Préambule : il n’y a pas de détails en théologie. Les hérétiques (eunomiens) argumentent à partir des particules, selon leur technique, alors que l’écriture n’a pas une pratique aussi formelle et pointilleuse : elle peut employer la même particule à propos de personnes divines différentes. Exemples (surtout Psaumes et Nouveau Testament). Il est donc légitime d’avoir une certaine liberté dans les mots qu’on emploie. Défense du mot « avec » dans la doxologie. Explication du sens de « par » employé pour le Fils : cela ne fait pas de lui un inférieur.
Ce que dit l’écriture sur l’Esprit. La formule baptismale de Mt 28, 19 coordonne bien l’Esprit avec le Père et le Fils. L’action de l’Esprit est essentielle au baptême. Réfutation de faux parallèles bibliques qui minimiseraient la portée de cette formule : « baptisé en », « croire en ». Rôles de l’eau et de l’Esprit. L’Esprit, en tout inséparable des deux autres personnes. Que signifie « subnumérer ». L’énumération des hypostases ne nuit pas à l’unité et à l’égalité. L’Esprit et la divinité. L’Esprit est libre parce qu’il n’est pas une créature. L’Esprit est Seigneur selon les écritures, et il échappe à la vision humaine comme les deux autres.
En louant Dieu on glorifie son Esprit, et on montre qu’il n’est pas du côté du créé mais de Dieu. Dans, et, avec : l’usage de l’écriture. La particule dans convient à l’Esprit, mais n’est pas meilleure que avec. Si l’écriture n’emploie pas avec, cela ne lui ôte pas sa légitimité : même nous, nous sommes dits avec le Christ ! Le mot se trouve chez certains auteurs : florilège patristique. Raisons qu’a eues Basile de parler : l’état des églises.
Extrait(s)
Sur le Saint Esprit 10, 24.26 (SC 17bis, p.333.337)
Le Seigneur, en transmettant le baptême de salut, a clairement prescrit aux disciples de baptiser tous les peuples au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit (Mt 28, 19), sans juger déshonorant de se trouver dans la communion de l’Esprit. (…) Après avoir acquis la science de ce salut effectué par le Père et le Fils et le Saint Esprit, nous irions lâcher la forme de l’enseignement reçu ? Il y aurait bien lieu de grandement gémir si par hasard nous nous trouvions maintenant plus éloignés de notre salut qu’au moment où nous avons cru, si nous reniions maintenant ce que nous avons reçu alors. C’est un égal dommage, ou de partir sans baptême, ou d’en avoir reçu un qui manque d’un seul point venu de la tradition. Quant à la profession de foi que nous avons déposée lors de notre première entrée, lorsque, nous écartant des idoles, nous sommes venus au Dieu vivant, celui qui ne la garde pas en toute occasion et ne s’y attache point durant toute sa vie comme à une solide sauvegarde, celui-là se rend étranger aux promesses de Dieu en contredisant l’écrit signé de sa propre main, qu’il a remis en confession de la foi. Car si le baptême est pour moi principe de vie et si le premier des jours est celui de la régénération, il est clair que la parole la plus précieuse sera aussi celle-là qui fut prononcée quand j’ai reçu la grâce de l’adoption filiale.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
233
l. 17
des rapport
des rapports
536
col. 2, l. 11
12, 5
12, 6
537
col. 1.15 ab imo
3, 17
3, 27
545
col. 1, l. 8
Ajouter ἀδελφότης 16, 3.
560
l. 28
matières
manières
Du même auteur
-
SC 357

Sur le baptême
novembre 1989
Y a-t-il des conditions préalables au baptême, ou comment s'y préparer ?
-
SC 305

Contre Eunome, tome II
octobre 1983
Dieu ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu ? Magistrale réponse du grand Cappadocien.
-
SC 299

Contre Eunome, tome I
octobre 1982
Dieu ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu ? Magistrale réponse du grand Cappadocien.
-
SC 160

Sur l’origine de l’homme
décembre 1970
L'homme, cette merveille… Une profonde méditation, en deux homélies.
-
SC 26 bis

Homélies sur l'Hexaéméron
décembre 1968
Contempler la création, y trouver Dieu et rendre grâce.