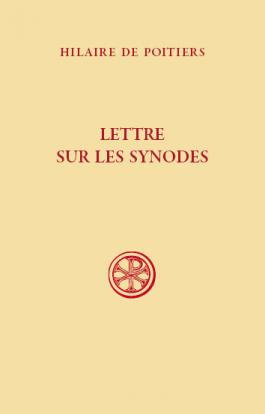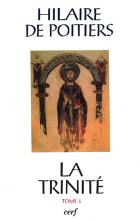-
SC 621
Hilaire de Poitiers
Lettre sur les synodes
janvier 2022Texte critique, introduction et notes par Michael Durst. — Traduction par André Rocher (†)
Révision assurée par Dominique Bertrand – Bernard Meunier.ISBN : 9782204145367484 pages"Consusbstantiel au Père": qu'est-ce que ça veut dire? Hilaire dévoile le "making-of" du credo.
Présentation
Nous sommes à l’hiver 358-359. Hilaire, évêque de Poitiers, exilé en Orient pour sa résistance à l’arianisme, reçoit une demande des évêques occidentaux un peu perdus dans la multitude des synodes et des confessions de foi qui se sont succédé depuis quelques années. Il leur adresse en retour ce mémoire, en forme de lettre ouverte, où il fournit la documentation demandée (les principales confessions de foi émanées des synodes), avec ses explications et ses jugements, tantôt sévères et tantôt bienveillants.
En confessant le Fils « consubstantiel » au Père, après le concile de Nicée en 325, que veut-on dire ? Les sensibilités et opinions qui se croisent mettent en jeu la foi et l’union des Églises. Hilaire le sait, et connaît les risques de malentendus, et même de schisme, provoqués par le passage du grec au latin. Il s’efforce, dans ces pages souvent lumineuses et parfois subtiles, d’expliquer aux pasteurs latins les débats grecs et leurs enjeux, précisant pourquoi il faut accepter telle expression de la foi et refuser telle autre, et se défendant lui-même au besoin. Sa documentation précise et son acuité de jugement font de sa Lettre sur les synodes, ici offerte avec un nouveau texte critique et la première traduction française, une source précieuse pour les historiens et les théologiens.Michael Durst, prêtre du diocèse de Cologne, a consacré sa thèse d’habilitation (Bonn, 1994) à cette œuvre d’Hilaire. Professeur ordinaire d’Histoire de l’Église et de patrologie à la Theologische Hochschule de Coire (Suisse), il est spécialiste d’Hilaire et de l’histoire ancienne du diocèse de Coire.
André Rocher (†), prêtre du diocèse de Poitiers, avait consacré sa thèse de doctorat au Contre Constance d’Hilaire, qu’il a publié dans la collection (SC 334).Le mot des Sources Chrétiennes
Hilaire écrit cette longue lettre-traité en 358-359, depuis son exil d’Orient, en réponse à une demande de ses compatriotes, les évêques gaulois, qui souhaitaient connaître les différentes formules de foi rédigées en Orient par les différents synodes qui s’y réunissaient presque chaque année et mieux comprendre ce que les Pères du concile de Nicée, en 325, entendaient lorsqu’ils disaient le Fils « de même nature » ou « consubstantiel » (homoousios) au Père. Hilaire leur envoie donc la documentation demandée : c’est la Lettre sur les synodes, qui, en 92 chapitres, se présente dans sa première partie, adressée aux évêques d’Occident, comme un dossier de credos orientaux traduits en latin, expliqués et remis dans leurs contextes respectifs pour en faire comprendre l’intention : 2e formule de Sirmium en 357, décrets des synodes d’Ancyre et de Sirmium en 358, 2e formule d’Antioche au synode des Encénies en 341, la formule du synode oriental de Sardique en 343, 1re formule de Sirmium en 351 ; la seconde partie, adressée aux évêques d’Orient, prend pour base une traduction latine de la profession de foi de Nicée.
Hilaire à son tour expose sa foi en justifiant l’homoousios au sens d’homoiousios, « de substance semblable ». Il maintient une différence entre le Père et le Fils : « Nous ne mettons pas le Fils au même niveau ou au même rang que le Père, mais nous le comprenons comme placé en-dessous » (ch. 50, p. 315) ; « Le Père est plus grand en ce qu’il est père, le Fils n’est pas plus petit en ce qu’il est fils » (ch. 64, p. 345). Des déclarations que certains pourraient juger subordinatianistes ; « mais, précise Hilaire, la soumission de sa piété filiale [celle du Fils] ne constitue pas un amoindrissement de son essence » (ch. 51, p. 319). Et il consacre tout un développement pour montrer que la « ressemblance » (similitudo) signifie « égalité » (ch. 73-75, p. 363-369). Pour lui, l’Incarnation maintient l’égalité, tout en glorifiant dans le Verbe la « chair », à savoir l’humanité, comme responsable du salut : « Quand le Verbe est fait chair (Jn 1, 14), il n’a pas perdu par la chair le fait qu’il était Verbe et n’a pas été transformé en chair de sorte qu’il cessât d’être Verbe, mais le Verbe a été fait chair bien plutôt pour que la chair commençât d’être ce qu’est le Verbe. Autrement, d’où viendraient à la chair la force dans les actions, la gloire sur la montagne, la connaissance des cœurs humains dans les pensées, l’assurance dans la Passion, la vie dans la mort ? » (ch. 48, p. 307-309). Le nicéisme de l’évêque exilé est donc hors de cause ; le Gaulois est d’ailleurs connu comme le premier à mettre le chiffre symbolique des 318 pères de Nicée en rapport avec le « nombre saint » des serviteurs d’Abraham en Gn 14, 14 (ch. 86, p. 403). Esprit libre, il se montre à la fois bienveillant pour ceux qui essaient de préserver la communion sur des bases claires, et tranchant pour ceux qui œuvrent contre la foi de Nicée, à ses yeux seule capable, à long terme, de ramener la paix.
Cela dit, les méprises sur le sens des formules, qui avaient conduit jusqu’à des schismes, étaient de toute manière si faciles qu’Hilaire lui-même a dû défendre sa propre interprétation. Sa Lettre ayant été critiquée par « frère Lucifer », évêque de Cagliari, et un diacre romain nommé lui aussi Hilaire, il apporta, dès avant 362, des précisions sur 15 passages de sa Lettre : ce sont les Apologetica responsa, ou « réponses justificatives ».
À travers toutes ces explications, c’est toute une herméneutique de la théologie dogmatique que l’évêque de Poitiers déploie, avec de multiples avertissements sur ses limites : alors que « la parole de Dieu est en exil avec nos corps » (ch. 8, p. 193), écrit-il, « on livre à l’arbitraire pouvoir des hommes les décrets de la doctrine du Seigneur » (ch. 4, p. 185-187), « sans parler de la difficulté de comprendre ce que disent les autres » (ch. 5, p. 187), si bien que « dans la majeure partie des dix provinces d’Asie où je réside, on ne sait vraiment plus rien de Dieu » (ch. 63, p. 339) – une ignorance parfois volontaire, et même forcée : « En soutenant que la naissance [du Fils] était inconnaissable, on nous ordonna par ignorance décrétée d’ignorer qu’il vînt de Dieu, comme si on pouvait ordonner et décréter, soit de savoir ce qu’on ignore, soit d’ignorer ce qu’on sait » (ch. 10, p. 197). Ces limites historiques aggravent celles, plus fondamentales, du langage humain : « Dieu, dans son infinité et son immensité, n’a pu être compris et manifesté par les brèves expressions de la parole humaine. En effet, le plus souvent la brièveté du langage égare auditeurs et enseignants et cette parole ramassée, ou bien ne peut faire comprendre ce qu’elle recherche, ou bien même altère ce qui, faute d’une élucidation rationnelle, est indiqué plutôt qu’expliqué » (ch. 62, p. 337). Le mot « substance », qu’Hilaire emploie lui-même une fois comme un quasi-synonyme de « personne » (ch. 50, p. 313), n’est pas non plus idéal : « ce terme porte en lui en même temps une conscience de la foi et une tromperie à l’affût » (ch. 67, p. 349) ; de ce fait, « on peut parler avec piété de la substance une, on peut avec piété la taire. Tu as la naissance, tu as la ressemblance. Pourquoi gardons-nous des soupçons faux sur le mot, alors que nous ne divergeons pas dans l’intelligence de la chose ? » (ch. 71, p. 359). Les Écritures, enfin, ne sont pas exemptes de difficultés. Faut-il pour autant, se demande l’exégète, supprimer d’elles tout ce qu’on ne comprend pas (ch. 85, p. 395-401) ? « Que périssent tous ces évangiles divins et vénérés qui sauvent l’humanité, pour qu’ils ne se combattent pas entre eux parce qu’on se fait une idée opposée de ce qu’ils disent ! » (p. 399). La Bible doit être interprétée comme un tout : « Je n’entendrai : Le Christ a souffert (1 P 2, 21) qu’à condition d’entendre : Maintenant c’est l’heure où le Fils de l’homme va être glorifié (Jn 12, 23). Je n’entendrai : ‘Il est mort’ qu’à condition d’entendre : ‘Il est ressuscité’. Ne tirons des divins mystères rien d’isolé qui pourrait entraîner le doute chez les auditeurs et fournir un prétexte aux blasphémateurs » (ch. 70, p. 357). L’herméneute, souvent armé d’assez de certitude pour ne pas juger nécessaire de s’expliquer sur certains points, mais généralement conscient de ses limites – « J’ai exposé, confesse-t-il, autant que la pratique du langage humain le souffrait » (ch. 64, p. 345) –, en appelle en fin de compte à la foi ecclésiale : « Est-ce catholique ? Est-ce hérétique ? à vous de le confirmer par le verdict de votre foi » (ch. 7, p. 191).
Texte engagé, écrit à chaud, au moment des événements, et en même temps très réflexif, c’est donc là un précieux document sur une période particulièrement embrouillée. Œuvre à la fois théologique et historique, il offre comme une photographie de l’état des débats d’Orient, au plus fort de la crise arienne, vus par un « envoyé spécial » d’Occident exilé là-bas. Le point de vue, unique et particulièrement éclairant, préfigure les points de vue qui l’emporteront au moment du concile de Constantinople (381). En attendant les Fragments historiques du même auteur, ce 14e volume d’Hilaire de Poitiers dans la collection est complémentaire de la Lettre sur les synodes d’Athanase d’Alexandrie, écrite dans la même période (au maximum 2 ans plus tard) et en partie dans la même optique, la défense du concile de Nicée : n’appelle-t-on pas Hilaire « l’Athanase de l’Occident » ? Cette œuvre latine apporte donc le complément occidental à l’œuvre grecque, et complète également le dossier de textes historiques (les 4 Histoires ecclésiastiques de Socrate, Sozomène, Théodoret et Philostorge) qui sont nos principales sources sur l’histoire religieuse du IVe siècle.
Le lecteur bénéficie dans ce volume du texte latin et de l’apparat critique de Michael Durst, retravaillés à partir de sa thèse d’habilitation, en allemand, soutenue à Bonn en 1993 ; de ce travail colossal ont aussi été tirées l’introduction et l’annotation, dans une version réduite, adaptée au format de la collection. Quant à la traduction française, la première pour cette œuvre, elle rend compte du latin difficile d’Hilaire qui explique comme il peut des notions grecques à des esprits latins. La traduction de la Lettre est celle d’André Rocher (†), prêtre du diocèse de Poitiers, auteur déjà dans la collection du Contre Constance d’Hilaire (SC 334) ; celle des Apologetica Responsa est de la main de Dominique Bertrand, qui a révisé l’ensemble avec la collaboration de Bernard Meunier ; ce dernier a pris le relais pour la phase finale et l’élaboration des index.
G. Bady et B. Meunier
Guillaume Bady
Errata
Page Localisation Texte concerné Correction Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 56 bis
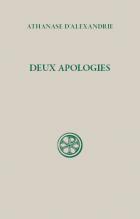
Deux apologies
décembre 1987
Accusé à tort et pourchassé, Athanase se réfugie dans le désert et se justifie.
-
SC 563
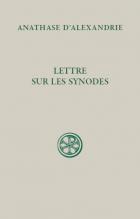
Lettres sur les synodes
août 2013
Le Fils, « de même nature que le Père » : la bataille pour un credo, au beau milieu du 4e siècle.
-
SC 598
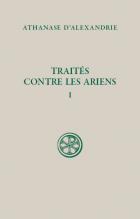
Traités contre les ariens, tome I
octobre 2019
La divinité du Fils, défendue pied à pied, verset par verset, par le grand zélateur de la foi nicéenne, vers le milieu du 4e siècle
-
SC 599
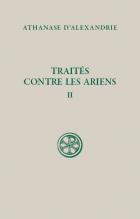
Traités contre les ariens, tome II. II-III
octobre 2019
La divinité du Fils, défendue pied à pied, verset par verset, par le grand zélateur de la foi nicéenne, vers le milieu du 4e siècle
-
SC 564

Histoire ecclésiastique
décembre 2013
L'histoire vue par les vaincus, ou le 4e siècle raconté par un arien, qui sait aussi se faire guide touristique !
-
SC 477

Histoire ecclésiastique, Livre I
décembre 2003
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 493

Histoire ecclésiastique, Livres II-III
juin 2005
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 418
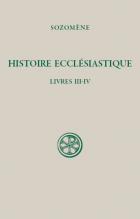
Histoire ecclésiastique, tome II
novembre 1996
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 495
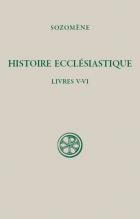
Histoire ecclésiastique, tome III
décembre 2005
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 501

Histoire ecclésiastique, tome I. Livres I-II
mai 2006
De 323 à 428, un siècle d'histoire vu comme une victoire de la foi, par un zélateur de l'Église d'Antioche.
Du même auteur
-
SC 625

Commentaires sur les Psaumes, tome V (Psaumes 119-126)
avril 2022
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 605

Commentaires sur les Psaumes, tome IV (Psaumes 67-69 et 91)
décembre 2020
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 603

Commentaires sur les Psaumes. Tome III (Psaumes 62-66)
juin 2019
Le sens des Psaumes 62 à 66 ouvert par Hilaire vers 360 avec une clé divine : le Christ lui-même.
-
SC 565
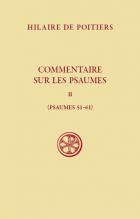
Commentaires sur les Psaumes, tome II (Psaumes 51-61)
juillet 2014
Des cris de souffrance ? Les Psaumes 51 à 61 sont, pour Hilaire, dans la bouche du Ressuscité.
-
SC 515

Commentaires sur les Psaumes, tome I (Psaumes 1-14)
juin 2008
« Heureux l'homme » : un voie spirituelle éclairée au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 462
La Trinité, tome III
octobre 2001
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 448
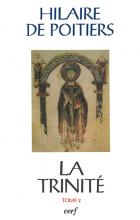
La Trinité, tome II
avril 2000
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 443
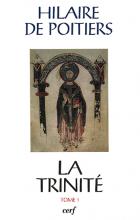
La Trinité, tome I
juin 1999
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 347

Commentaire sur le Psaume 118, tome II
novembre 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 344

Commentaire sur le Psaume 118, tome I
mai 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 334
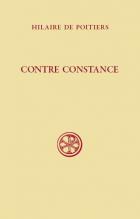
Contre Constance
février 1987
Un empereur veut imposer à l'Église une foi hérétique ? Une charge au vitriol par un évêque persécuté.
-
SC 258
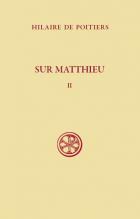
Sur Matthieu, tome II
mai 1979
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 254
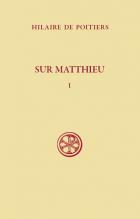
Sur Matthieu, tome I
décembre 1978
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 19 bis
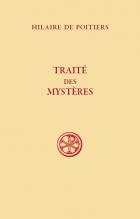
Traité des mystères
décembre 1967
Une clé de lecture de l’Ancien Testament, miroir de figures annonçant le Christ.