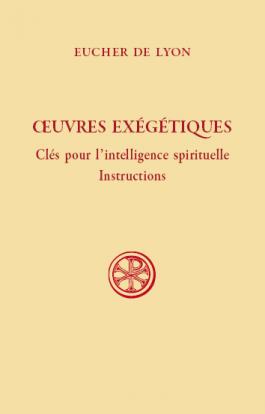-
SC 618
Eucher de Lyon
Œuvres exégétiques
Clés pour l’intelligence spirituelle. Instructionsoctobre 2021Texte latin de C. Mandolfo (CCSL 66). — Introduction, traduction et notes par Martine Dulaey.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre.Révision assurée par Isabelle Brunetière.ISBN : 9782204143158646 pages« Des semences pour la compréhension de presque toutes les Écritures », par un évêque s'adressant à ses deux grands enfants
Présentation
Avec Eucher, un grand auteur de l’Antiquité chrétienne fait son entrée dans la collection Sources Chrétiennes. Futur évêque de Lyon, il est moine à Lérins quand, vers 430-434, il rédige ces deux oeuvres pour la formation exégétique et théologique de ses fils, Salonius et Veranus, élevés sur l’île et futurs évêques eux aussi.
Le premier écrit, intitulé Clés pour l’intelligence spirituelle, est, en 10 chapitres et pas moins de 458 entrées, un dictionnaire des symboles bibliques qui vise à faciliter une lecture spirituelle de l’Écriture ; Eucher y traite d’une grande variété de sujets : Dieu ou le Christ, le monde d’en haut, la terre, les êtres vivants, certaines réalités ou certains mots, Jérusalem, les nombres…
Le second écrit, intitulé Instructions, répond en deux livres à diverses questions sur la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse (livre I), et fournit nombre d’explications (livre II, en 15 chapitres et 396 entrées) : sens de termes hébreux ou grecs, noms de lieux et noms propres, vêtements sacerdotaux, poids et mesures, calendrier et fêtes bibliques, etc.
Puisant aux sources de Jérôme et d’Augustin, et de bien d’autres, les deux oeuvres ont servi de manuels à de nombreuses générations de moines et nourri la symbolique européenne au-delà même du Moyen Âge. Ils sont utiles encore aujourd’hui à tous ceux qui s’intéressent à la Bible, à l’Antiquité tardive et au Moyen Âge, Eucher étant souvent un précieux chaînon – jusqu’à présent manquant – dans la transmission d’un savoir biblique.
Martine Dulaey, professeur des Universités, directeur d’études émérite à l’École Pratique des Hautes Études, section des Sciences Religieuses, et membre honoraire du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM, UMR 8584, CNRS), codirige, avec A.-I. Bouton-Touboulic, la Bibliothèque Augustinienne, publiée par l’Institut d’Études Augustiniennes. Elle compte de très nombreuses publications, dont déjà, dans la collection, Victorin de Poetovio, Sur l’Apocalypse, et autres écrits (SC 423, 1997).
Le mot des Sources Chrétiennes
Avec Eucher, un grand nom de l’Antiquité chrétienne fait enfin son entrée dans la collection Sources Chrétiennes, où il était attendu depuis longtemps et où deux autres volumes de lui (Œuvres ascétiques et Passion des martyrs d’Agaune) sont prévus. Figure importante aussi bien du monde monastique qu’ecclésial, comme saint il a reçu un culte qui s’est propagé en particulier dans toute la vallée rhodanienne. Les deux ouvrages réunis dans ce volume ont contribué à cette postérité, car ils ont été utilisés comme manuels bibliques et recopiés pendant des siècles, alimentant ainsi la symbolique chrétienne au Moyen Âge et au-delà.
Eucher les a composés à Lérins vers 431-434, mais les a diffusées dans les années suivantes depuis Lyon, après qu’il en est devenu évêque. Dans cette même ville, les Sources Chrétiennes prolongent donc ce geste inaugural, près de 1600 ans plus tard. Éditrice de Victorin de Poetovio dans notre collection (SC 423), experte en symboles chrétiens et, bien sûr, spécialiste d’Augustin – l’une des sources majeures d’Eucher, avec Jérôme –, Martine Dulaey a repris le texte latin à l’édition de C. Mandolfo dans le Corpus Christianorum, avec quelques changements mineurs. Efficacement introduite et annotée par ses soins, sa traduction, la première qui existe en français, dévoile des textes qui, même s’ils ne sont pas tout à fait pour des débutants – leurs destinataires sont ses deux fils, Salonius et Veranus (ou Véran), futurs évêques – s’avèrent beaucoup plus lisibles que bien d’autres chefs-d’œuvre patristiques, et susceptibles de répondre à bien des questions de lecteurs contemporains sur la Bible. De fait, l’évêque de Lyon les a fait circuler parce qu’ils ne visent pas seulement les moines, mais l’ensemble des chrétiens, tous appelés à lire les Écritures.
Adressées à Veranus, les Clés pour l’intelligence spirituelle (Formulae spiritalis intellegentiae) figurent dans le volume, comme dans les manuscrits, avant les Instructions, mais ont été composées peu après. C’est, en 10 chapitres et pas moins de 458 entrées, un petit dictionnaire destiné à favoriser « l’intelligence spirituelle» de l’Écriture et de ses symboles, « en voyant successivement, pour chaque vocable, la valeur symbolique qu’il reçoit ordinairement quand on le rencontre dans la trame du texte divin » (préface, p. 101) : ce qui concerne Dieu ou le Christ, le monde d’en haut, la terre, les êtres vivants, certaines réalités ou certains mots, Jérusalem, les nombres... « Toute l’Écriture, tant Ancien que Nouveau Testament, doit être prise en un sens allégorique », assure l’auteur (préf., p. 93), qui cristallise en une formule scolaire une riche « tradition », selon laquelle « le corps de l’Écriture sacrée est dans la lettre, son âme dans le sens moral, dit tropologique, son esprit dans une compréhension supérieure qu’on appelle anagogique. Cette triple règle concernant les Écritures correspond à notre foi en la Trinité » (préf., p. 97). Selon cette règle, il décode les termes en faisant de tout l’univers une création spirituelle. Voici quelques exemples :« Cieux : les apôtres ou les saints, pour la raison que le Seigneur habite en eux ; dans le psaume : Les cieux racontent la gloire de Dieu (Ps 18,2). [...] Nuages : les prophètes ou les saints, parce qu’ils dispensent la pluie de la parole du Seigneur ; en Isaïe : Je donnerai ordre à mes nuages pour qu’ils ne pleuvent pas d’en haut (Is 5,6) » (Clés, II, 1.2, p. 111) ; « Lune : Église, du fait qu’elle resplendit dans la nuit de ce monde » (II, 9, p. 113); « Monts : le Seigneur, l’Église, les apôtres ou les saints, en raison de l’élévation de leurs vertus ? [...] Collines : les saints, mais de moindre mérite. [...] Vallée : ceux que la contrition du cœur a rendus humbles. [...] Plaines : les saints ou les divines Écritures, du fait qu’ils fournissent aux âmes une pâture » (III, 5.6.7.11, p. 123-125).
Cieux, nuages, lune, monts, collines, vallées et plaines... Dans cette géographie transfigurée, tout raconte vraiment la gloire de Dieu aux yeux de l’exégète. Les couleurs mêmes passent par un nouveau prisme :
« Roses : les martyrs, à cause de la couleur rouge du sang. [...] Violettes : les confesseurs, à cause de la ressemblance avec leurs corps rendus bleuâtres » (III, 37.38, p. 133).
Son anthropologie reste, quant à elle, conforme à la tripartition évoquée : il identifie l’« être humain » (homo) à l’intellect, lieu de l’image et de la ressemblance divine, ou, « en mauvaise part », à la chair ou au diable. L’assimilation de l’humain à l’« homme » (uir) est presque immédiate, puisque celui-ci est pour lui « l’esprit ou l’intellect », ou encore, d’après certains passages bibliques, le diable; la « femme » (mulier), en conséquence, est « l’âme ou la chair de l’homme » (anima siue caro humana), affirme-t-il en répétant la citation d’1 Co 11,3 : La tête de la femme, c’est l’homme (V, 1-3, p. 171). La femme disparaît-elle du monde allégorique, ou bien faut-il croire que là aussi, la tête ne serait rien sans le corps ?
Dans un genre plus bigarré, le très riche bestiaire d’Eucher n’a pas grand-chose à envier aux « animaux fantastiques » :
« Autruche : l’hérétique ou le philosophe, parce que, tout en ayant ce qu’on peut appeler les pennes de la sagesse, il ne vole pas » (IV, 8, p. 147) ; « Éléphant : le très gros pécheur » (IV, 28, p. 155) ; « Unicorne : fils d’un homme au pouvoir extraordinaire ou de saints qui s’attachent à l’unique Verbe de Dieu. En un autre sens : [...] les orgueilleux ou ceux qui n’ont qu’un seul Testament » (IV, 35, p. 157) ; « Âne : le corps humain » (IV, 46, p. 161).
Les bons vivants retiendront peut-être que la graisse est « surabondance de la grâce divine », mais aussi, « en mauvaise part, épaisseur du mal » (VI, 19, p. 187), que le ventre désigne « la capacité de la raison » (VI, 15, p. 187) – mais qu’ils n’aillent pas y voir, comme on aime à le dire aujourd’hui, un « deuxième cerveau » ! Les amateurs de vin goûteront certainement au sens littéral cette définition :
« Outres : le récipient qu’est le corps humain ; dans l’Évangile : Le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves (Lc 5,38)» (VII, 27, p. 203).
Leurs ardeurs changeront de nature s’ils se rappellent, peu avant, cet autre axiome :
« Vin pur : jugement sincère ou vérité authentique, ou encore ferveur de la foi » (VII, 17, p. 199).
Dans ce registre, les habitués des mâchons lyonnais seront sans doute peinés de lire :
« Cochonnaille : les péchés; dans le psaume (16,4) : Ils se sont gorgés de cochonnaille (VII, 14, p. 195).
Et il vaudra mieux ne pas dire aux adeptes du ballon rond qu’au chapitre X, consacré aux nombres, le « onze », entre le décalogue et les Douze apôtres, est tout bonnement ignoré.
Qui veut comprendre les Écritures avec Eucher doit donc consentir à certains efforts, en sachant qu’ils sont d’abord ceux de l’auteur, comme il l’écrit au sujet du mot « meule » :
« Les deux Testaments peuvent aussi être désignés par les deux pierres de la meule, au moyen desquelles le froment du Livre ancien est transformé en la farine de l’Évangile, moyennant le travail de ceux qui l’expliquent » (VII, 29, p. 203).
Comme une seconde pierre de la meule, les Instructions forment avec les Clés un ensemble bienvenu. Dans le premier des deux livres, Eucher répond à Salonius :
« Tu me demandes souvent la solution de nombreuses difficultés qui dans les livres divins requièrent une explication [...] : par exemple, ce que signifie alleluia, diapsalma, amen, ce qu’est une tiare, un ephod, un sicle et autres termes qui nécessitent une explication, du fait qu’ils sont fréquents dans les livres sacrés ou très utilisés dans l’Église » (Instr., préface, p. 261).
Sur des passages tirés d’une trentaine de livres bibliques, de la Genèse à l’Apocalypse, des dizaines de questions trouvent leur réponse. Certaines sont classiques : « Quels sont les passages des Écritures qui attestent la Trinité ? » (Instr., I,1,1, p. 265). D’autres sont intemporelles : « Puisque Dieu a créé toutes choses bonnes et qu’il n’est rien qui n’ait été créé par lui, d’où vient le mal ? » (I,1,11, p. 273). Certaines, plus épineuses, comme celle-ci : « Quelle responsabilité ont les juifs s’ils étaient dans l’impossibilité de croire ? », poussent Eucher à préciser sa position, entre Cassien et Augustin, et à ne pas voir là « une prédestination de Dieu, mais une prescience » (I,9,3, p. 323-325). D’autres sont énigmatiques, comme la formule de Mc 4,25 (à celui qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a), qui a pour lui un sens théologal : « Si quelqu’un a la foi sans avoir la charité, il sera privé même de la foi qu’il paraissait avoir » (I,17,1, p. 395).
Le « moine » de Lérins ajoute de lui-même un second livre, qui en 15 chapitres et 396 entrées recourt à l’étymologie pour expliquer, comme la préface le promettait, une foule de termes : noms hébreux (inspirés des Nomina hebraica de Jérôme, dont ils donnent un avant-goût), peuples, lieux, fleuves et eaux, mois, fêtes, idoles, vêtements, oiseaux ou êtres ailés, bêtes ou animaux rampants, poids, mesures, mots grecs, vocables divers... Dans ce livre, qui est donc avec les Clés un second dictionnaire, les définitions se limitent souvent à de simples traductions ou équivalences. Dans quelques cas, il exprime une certaine distance avec ses sources :
« Ève : vie ou calamité ; je m’étonne qu’il y ait chez les Hébreux des traductions de ce nom aussi différentes ; à moins peut-être que la raison en soit que cette même femme a apporté à l’homme à la fois la vie en le mettant au monde et la calamité par la transgression ; ou que la femme est vie pour les uns et calamité pour les autres » (II,1,10, p. 473).
Gageons que cet homme marié et fier de ses enfants faisait partie des uns – et laissons le mot de la conclusion (p. 561) à celui qui était aussi un père spirituel :
« Tu as là un opuscule, mon très cher fils, qui renferme en quelque sorte des semences pour la compréhension de presque tout l’ensemble des Écritures ; ces deux volumes que j’ai rédigés pour ta formation sur des sujets variés qu’il est indispensable de connaître ne sont pas, je crois, une petite instruction. »
Guillaume Bady
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Clés pour l’intelligence spirituelle
Les Clés pour l’intelligence spirituelle et les Instructions d’Eucher sont des dictionnaires de termes bibliques pour lesquels une ou plusieurs interprétations exégétiques sont données dans de courtes notices, illustrées par une ou plusieurs citations scripturaires. Futur évêque de Lyon, Eucher a rédigé ces œuvres vers 430-434, alors qu’il était moine sur l’île de Lérins, et elles étaient destinées à la formation théologique de ses fils, Salonius et Veranus, futurs évêques eux aussi.
Le premier écrit, Clés pour l’intelligence spirituelle, présente les symboles bibliques, afin de permettre une lecture spirituelle de l’Écriture.
Instructions
Les Clés pour l’intelligence spirituelle et les Instructions d’Eucher sont des dictionnaires de termes bibliques pour lesquels une ou plusieurs interprétations exégétiques sont données dans de courtes notices, illustrées par une ou plusieurs citations scripturaires. Futur évêque de Lyon, Eucher a rédigé ces œuvres vers 430-434, alors qu’il était moine sur l’île de Lérins, et elles étaient destinées à la formation théologique de ses fils, Salonius et Veranus, futurs évêques eux aussi.
Le premier écrit, Clés pour l’intelligence spirituelle, présente les symboles bibliques, afin de permettre une lecture spirituelle de l’Écriture.
Le second écrit, probablement antérieur par sa rédaction, répond à des questions portant sur des points d’exégèse littérale, d’interprétation symbolique et de théologie biblique. Il comporte en outre un bref lexique des noms hébreux de l’Ancien Testament. La source d’Eucher pour son onomasticon est le Liber interpretationis Hebraicorum nominum de Jérôme, inspiré d’Eusèbe. Pour les explications théologiques, Eucher a recours à Augustin.
Les Formulae, étant un précis des interprétations patristiques, requièrent une connaissance suffisante de la Bible et une bonne culture exégétique. L’opuscule peut servir d’aide-mémoire au lecteur qui sait déjà beaucoup, et lui faciliter l’utilisation des connaissances acquises en exégèse et en théologie, mais il ne saurait constituer une initiation pour l’ignorant. Il est conçu pour un public dont l’auteur attend qu’il partage largement sa culture biblique et patristique. Il a également pour horizon la vie monastique, avec la visée d’enseigner, grâce à l’apprentissage du sens figuré, à guider la prière méditée du Psautier ; car, sans exégèse symbolique, il n’est pas d’appropriation personnelle possible des Psaumes, ni d’écoute fructueuse des textes de la liturgie.
Eucher s’interrroge sur cette obscurité dans ce qui se présente comme une révélation. Il considère que le sens profond des Écritures est nécessairement mystérieux et caché, parce qu’elles sont parole de Dieu et parole sur un Dieu qui est transcendant et échappe aux prises de l’homme ; le mystère qui voile la divinité enveloppe également l’Écriture. Simples au premier abord et accessible à tous, mettant à la portée de tous des choses faciles, mais contenant en leur intime de grandes choses, les livres bibliques ont des profondeurs auxquelles seule l’étude peut mener.
Si les notices sont en général très brèves, trois thèmes reçoivent un traitement plus ample : celui de l’ambivalence des symboles (les images étant polysémiques, plusieurs images peuvent renvoyer à une réalité unique et, inversement, une seule image a souvent des significations multiples), celui de l’unité des deux Testaments, et celui des anthropomorphismes du style biblique.
Extrait(s)
8. Soleil : le Seigneur Jésus Christ, parce qu’il illumine la terre ; en Salomon : Ainsi, le soleil de justice n’a pas lui pour nous. (Sg 5, 6)
9. Lune : Église, du fait qu’elle resplendit dans la nuit de ce monde ; dans le psaume : Il fit la lune pour marquer les temps. (Ps 103, 19)
10. Étoiles : les saints ou ceux qui sont savants ; en Daniel : Ceux qui sont savants brilleront comme les étoiles (Dn 12, 3) ; parfois aussi les anges.
11. Nuées : voile des mystères de Dieu ; dans le prophète : Les nuées sont la poussière de ses pas (Na 1, 3 12).
12. Ténèbre : ce qui recouvre les secrets divins ; dans le psaume : Et la ténèbre est sous ses pieds (Ps 17, 10).
13. Abîme : profondeur des Écritures ; dans le psaume : L’abîme appelle l’abîme (Ps 41, 8).
14. Rosée : la parole du Seigneur, du fait qu’elle humecte la terre que sont les hommes ; dans le psaume : Comme une rosée de l’Hermon qui descend sur le mont Sion (Ps 132, 3).
(Clés pour l’intelligence spirituelle, §§ 8-14, p. 113)
Errata
Page Localisation Texte concerné Correction Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 235
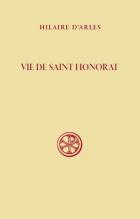
Vie de saint Honorat
avril 2006
Le fondateur de Lérins, devenu évêque d'Arles en 426-427 : saint Honorat, raconté par son disciple et un successeur.
-
SC 344

Commentaire sur le Psaume 118, tome I
mai 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 347

Commentaire sur le Psaume 118, tome II
novembre 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 515

Commentaires sur les Psaumes, tome I (Psaumes 1-14)
juin 2008
« Heureux l'homme » : un voie spirituelle éclairée au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 565
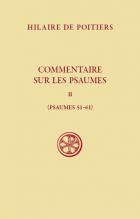
Commentaires sur les Psaumes, tome II (Psaumes 51-61)
juillet 2014
Des cris de souffrance ? Les Psaumes 51 à 61 sont, pour Hilaire, dans la bouche du Ressuscité.
-
SC 603

Commentaires sur les Psaumes. Tome III (Psaumes 62-66)
juin 2019
Le sens des Psaumes 62 à 66 ouvert par Hilaire vers 360 avec une clé divine : le Christ lui-même.
-
SC 605

Commentaires sur les Psaumes, tome IV (Psaumes 67-69 et 91)
décembre 2020
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 42 bis
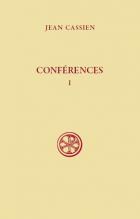
Conférences, tome I
décembre 1966
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 54

Conférences, tome II
décembre 1958
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 64

Conférences, tome III
décembre 1959
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 592
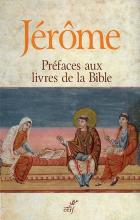
Préfaces aux livres de la Bible
décembre 2017
Chaque livre de la Bible introduit par l’auteur et éditeur de la Vulgate latine.
-
SC 176

Œuvres, tome I
décembre 1971
Au 5e siècle, une critique acerbe des travers du temps : avarice, tiédeur, impiété… – et un appel à la conversion.
-
SC 220
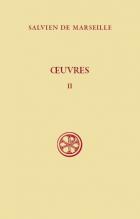
Œuvres, tome II
septembre 1976
Au 5e siècle, une critique acerbe des travers du temps : avarice, tiédeur, impiété… – et un appel à la conversion.