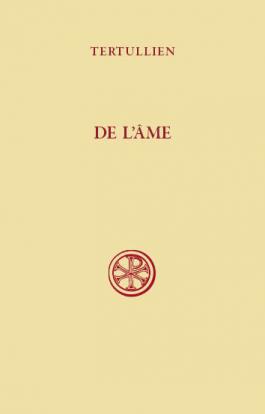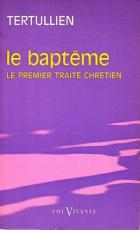-
SC 601
Tertullien
De l'âme
novembre 2019Introduction, texte latin, apparats et notes par Jerónimo Leal. Traduction par Paul Mattei.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre.Révision assurée par Guillaume Bady – Yasmine Ech Chael.ISBN : 9782204130004484 pagesL'âme, les rêves, le sexe, l'embryon, la mort : Tertullien lance le débat chez les chrétiens (vers 210).Présentation
Composé vers 210-211, le traité De l’âme de Tertullien est l’œuvre fondatrice d’un genre littéraire dans la littérature chrétienne. Se démarquant de Platon et se référant au stoïcisme, le polémiste latin s’y oppose aux tenants (gnostiques) de la préexistence et de la transmigration de l’âme. Parmi bien d’autres traits originaux, il défend notamment sa « corporéité » – il crée aussi tout un vocabulaire nouveau – qui font de l’œuvre un écrit sans précédent. Nourri des traditions médicales de son temps, il s’intéresse également à l’animation et au développement de l’embryon, au sexe de l’âme, au rapport de celle-ci avec le corps, et aux rêves. Théologien, il s’interroge sur la mort et sur le destin de l’âme après la mort.
Entre philosophie, médecine, « psychologie », théologie et littérature, le traité du Carthaginois, ici introduit et traduit d’après un nouveau texte critique, est un ouvrage de référence pour les écrivains chrétiens ultérieurs comme pour la réflexion contemporaine.Jerónimo Leal, spécialiste de Tertullien, est professeur titulaire de patrologie et directeur du Département d’histoire de l’Église à l’Université Santa Croce, à Rome, et professeur invité à l’Institutum patristicum Augustinianum.
Paul Mattei, professeur émérite à l’Université Lumière-Lyon 2 et professeur invité à l’Institutum patristicum Augustinianum, à Rome, est spécialiste de la littérature latine ancienne – en particulier de Tertullien, dont il a édité Le mariage unique et, en collaboration, Le voile des vierges (SC 343 et 424).Le mot des Sources Chrétiennes
Le traité De l’âme, divisé en 58 chapitres, définit l’âme comme « née du souffle de Dieu, immortelle, corporelle, ayant une forme, simple par sa substance, ayant du sentiment par elle-même, douée de développements variés, libre de sa volonté, sujette à l’accident, changeante selon les tempéraments, rationnelle, souveraine, divinatrice, issue d’une seule » (ch. 22, 2, p. 273). Cette définition, en léger décalage par rapport à celle de Platon, intervient au terme de la première partie, systématique, de l’ouvrage (limites de la posture des philosophes ; qualités, organes et fonctions de l’âme), la seconde, diachronique, portant sur l’origine et le développement de l’âme, sur son destin à travers le péché, la mort et jusqu’aux fins dernières. Une attention particulière est prêtée à la réfutation de la doctrine platonicienne de la réminiscence, à la métempsychose et à la « métensomatose », mais aussi aux rêves, à l’origine du sexe de l’âme, à l’animation et au développement de l’embryon – des sujets qui rejoignent bien des préoccupations actuelles.
De fait, « ce curieux traité où, selon H. Rondet, convergent toutes sortes d’idées venues de la révélation judéo-chrétienne, de la philosophie stoïcienne et de la science du temps » est celui qui a attiré le plus l’attention des historiens de la philosophie et de la médecine. Malgré des différences notables avec d’autres œuvres du même genre, ce traité se situe dans la vaste tradition « psychologique » en ses deux disciplines, philosophique ou médicale – l’influence majeure qui se fait sentir sur Tertullien étant le médecin Soranos d’Éphèse (II e s. apr. J. C.).
Avec ce traité, composé dans sa période montaniste vers 210-211 et se signalant par un recours aux Écritures et à la « règle de foi », Tertullien inaugure le genre « psychologique » chrétien qui a fait florès après lui (citons notamment le De anima et resurrectione de Grégoire de Nysse, le De anima et eius origine d’Augustin d’Hippone, le De anima de Cassiodore, paru récemment : SC 585). En réalité il s’agit moins d’un traité philosophique que d’une œuvre polémique et d’une réfutation de certaines doctrines hérétiques, dans la ligne antignostique du Contre Hermogène. Tout en s’en prenant aux thèses de la préexistence et de la transmigration de l’âme, le Carthaginois met en avant – position aussi paradoxale que surprenante – sa « corporéité » : non au sens d’une matérialité de l’âme, comme chez Hermogène, mais parce que, pour lui comme pour les stoïciens, le mot corpus peut être synonyme de substance ; il y a donc un « corps de l’âme » comme il y a un « corps de chair ».
Le texte, ici nouvellement établi, réserve à cet égard bien des surprises. Ainsi la formule selon laquelle « le principe dominant [de l’âme] est gardé dans le trésor du corps (thesauro corporis) » (ch. 15, 4, p. 224, ligne 11). Le « trésor du corps » : quel contraste avec le corps-tombeau ou le corps-prison de l’âme chez Platon ! Plutôt que d’y voir une simple variante, on se demande si, dans une page où il aborde les « secrets du cœur », Tertullien ne joue pas sur l’expression évangélique « trésor du cœur » (thesauro cordis, Lc 6, 45), en même temps que sur le double sens du mot « cœur » dans la Bible, où il est à la fois l’organe anatomique et le lieu psychique de la mémoire, pour montrer l’insertion corporelle de ce principe spirituel.
Selon P. de Labriolle, « ce qui rend l’interprétation de ce traité particulièrement délicate, c’est la langue dont use Tertullien – langue d’une vigueur, d’un relief souvent admirables, mais où abondent les mots nouveaux, les expressions inédites ». On trouve, de fait, dans ce traité plus de cinquante mots dont il est l’unique attestation (hapax legomena) : fin connaisseur du grec et écrivain original, le Carthaginois y enrichit la langue latine non seulement dans le champ théologique, mais aussi philosophique.
Dans ces conditions, et alors que la dernière version française remonte à 1841, on comprend aussi l’intérêt et l’enjeu de la nouvelle traduction en termes de fidélité, de lisibilité et d’apport à la compréhension de cette œuvre inaugurale – qui forme le 23e volume de Tertullien dans Sources Chrétiennes.
Guillaume Bady
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 379

Supplique au sujet des chrétiens et Sur la Résurrection des morts
mai 1992
En 176 ou 177, un philosophe platonicien devenu chrétien défend la foi devant deux empereurs.
-
SC 507
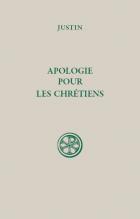
Apologie pour les chrétiens
décembre 2006
Un appel à la « semence du Verbe » présent en tout homme, de la part d’un philosophe et d’un martyr.
-
SC 100.1

Contre les hérésies, Livre IV. Tome I
décembre 1965
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 100.2

Contre les hérésies, Livre IV. Tome II
décembre 1965
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 152

Contre les hérésies, Livre V. Tome I
décembre 1969
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 153

Contre les hérésies, Livre V. Tome II
décembre 1969
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 210
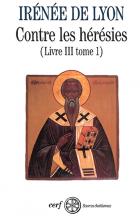
Contre les hérésies, Livre III. Tome I
décembre 1974
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 211
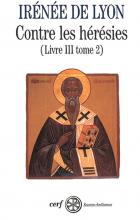
Contre les hérésies, Livre III. Tome II
décembre 1974
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 263

Contre les hérésies, Livre I. Tome I
janvier 1979
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 264

Contre les hérésies, Livre I. Tome II
janvier 1979
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 293

Contre les hérésies, Livre II. Tome I
mai 1982
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 294

Contre les hérésies, Livre II. Tome II
mai 1982
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.
-
SC 6

La Création de l'homme
juin 1944
Comment expliquer les contradictions de l'être humain ? Par le plus philosophe des Cappadociens.
-
SC 178

Vie de sainte Macrine
décembre 1971
Le Socrate chrétien est une femme : c'est la grande sœur de Basile et de Grégoire, et leur premier modèle.
-
SC 585

De l'âme
décembre 2017
« Comprendre qui je suis, afin de pouvoir parvenir à ce que je ne suis pas » : vers 540, le fondateur du Vivarium fait se rejoindre foi et philosophie.
Du même auteur
-
SC 638
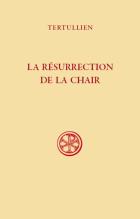
La résurrection de la chair
novembre 2023
«La chair, pivot du salut» : renversant plaidoyer du Carthaginois
-
SC 513
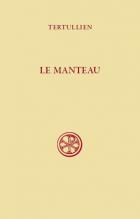
Le Manteau
septembre 2007
Pourquoi porter le manteau du philosophe plutôt que la toge romaine ? Un signe personnel très fort pour le Carthaginois.
-
SC 483
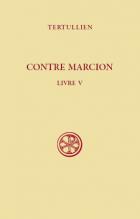
Contre Marcion, tome V
juillet 2004
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 456
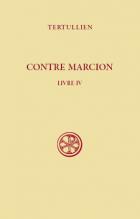
Contre Marcion, tome IV
février 2001
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 439

Contre Hermogène
mars 1999
La matière est-elle éternelle ? Et d'où vient le mal ? Tertullien tord le cou aux idées fausses.
-
SC 424
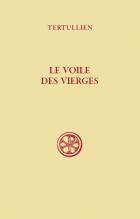
Le Voile des vierges
septembre 1997
Voilées, les femmes chrétiennes, pendant la liturgie ? Le Carthaginois devenu schismatique expose son avis.
-
SC 399
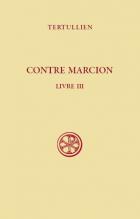
Contre Marcion, tome III
juin 1994
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 395

La Pudicité, tome II
décembre 1993
L'Église peut-elle remettre les péchés ? Le Carthaginois, devenu schismatique, en doute.
-
SC 394

La Pudicité, tome I
décembre 1993
L'Église peut-elle remettre les péchés ? Le Carthaginois, devenu schismatique, en doute.
-
SC 368
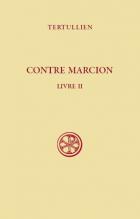
Contre Marcion, tome II
mars 1991
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 365
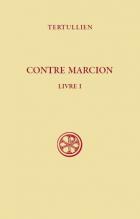
Contre Marcion, tome I
décembre 1990
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 343

Le Mariage unique
juin 1988
Doit-on ou peut-on se remarier ? Le Carthaginois répond, selon la mentalité de son temps.
-
SC 332
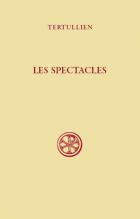
Les Spectacles
octobre 1986
Violence, pornographie, inepties : pour le Carthaginois, les spectacles sont incompatibles avec la vie chrétienne.
-
SC 319
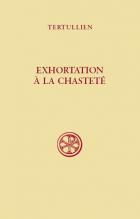
Exhortation à la chasteté
juin 1985
Chasteté et continence : dans un débat pastoral incessant, la position rigoriste du Carthaginois.
-
SC 316
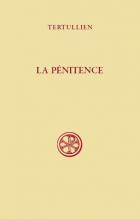
La Pénitence
novembre 1984
Quelle pénitence, avant et après le baptême ? L'éclairage du théologien carthaginois.
-
SC 310
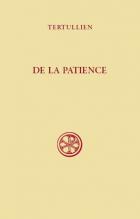
De la patience
février 1984
La patience, un trait proprement divin : la réflexion du grand théologien carthaginois.
-
SC 281
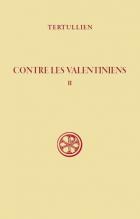
Contre les Valentiniens, tome II
janvier 1981
Des révélations secrètes sur Dieu ? Exposé et réfutation de la « gnose » par le pugnace Carthaginois.
-
SC 280

Contre les Valentiniens, tome I
janvier 1981
Des révélations secrètes sur Dieu ? Exposé et réfutation de la « gnose » par le pugnace Carthaginois.
-
SC 273

À son épouse
janvier 1980
« Deux en une seule chair » : la lettre d’un chrétien d’Afrique à sa femme, et un idéal du mariage.
-
SC 217
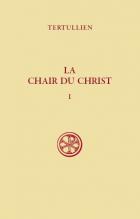
La chair du Christ, tome II
septembre 1976
Pas vraiment incarné, le Christ ? Magistrale réponse du théologien carthaginois.
-
SC 216
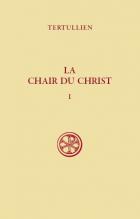
La chair du Christ, tome I
décembre 1975
Pas vraiment incarné, le Christ ? Magistrale réponse du théologien carthaginois.
-
SC 173
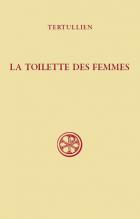
La Toilette des femmes
décembre 1971
La coquetterie a-t-elle sa place dans l'Église ? Une harangue du Carthaginois.
-
SC 46
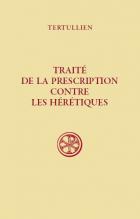
Traité de la prescription contre les hérétiques
juin 1957
Qui a le droit de citer les Écritures ? L'avis du premier théologien latin.
-
SC 35
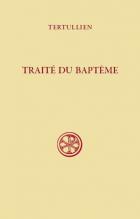
Traité du baptême
décembre 1952
Pas nécessaire, le baptême ? Magistrale réponse du théologien carthaginois.
-