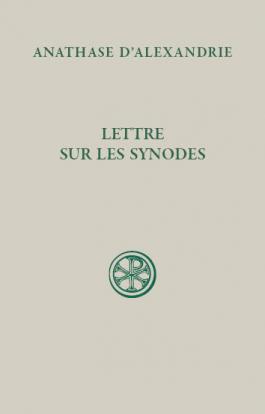-
SC 563
Athanase d'Alexandrie
Lettres sur les synodes
août 2013Texte critique par H.G. Opitz (Athanasius Werke II,1). Synodale d'Ancyre. Basile d'Ancyre, Traité sur la foi — Introduction, texte, traduction, notes et index par Annick Martin, professeur émérite à l'Université de Rennes 2 et Xavier Morales, o.c.s.o.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.Révision assurée par Catherine Syre.ISBN : 9782204101356409 pagesLe Fils, « de même nature que le Père » : la bataille pour un credo, au beau milieu du 4e siècle.Présentation
La Lettre sur les synodes de Rimini et de Séleucie d’Isaurie d’Athanase, évêque de la grande métropole d’Alexandrie (328-373), est un témoignage essentiel pour l’histoire de l’Église de 325 à 360, plongée dans l’instabilité par la réception difficile du concile de Nicée (325) et par les interventions du pouvoir politique. Elle contient un compte rendu engagé des deux synodes de 359 qui consacrent la victoire d’un arianisme modéré avec la faveur de l’empereur Constance, et s’enrichit d’une collection de documents ariens et de nombreuses formules de foi rédigées durant cette période. Athanase y défend la foi de Nicée, tout en pratiquant une ouverture à l’adresse d’un groupe d’évêques qu’on appellera « homéousiens », qu’il veut convaincre de se rallier à Nicée devant le danger néo-arien.
À la Lettre d’Athanase, dont le texte grec a été révisé, sont ajoutés deux documents issus du courant homéousien, transmis par Épiphane de Salamine. Tous ces textes sont traduits en français pour la première fois.
Annick Martin, professeur d’histoire émérite à l’Université de Rennes 2, est l’auteur d’une étude sur Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au IVe siècle (328-373). Elle a collaboré à l’édition de l’Histoire « acéphale » d’Athanase et de l’Histoire ecclésiastique de Théodoret de Cyr.
Xavier Morales, moine à l’abbaye cistercienne Notre-Dame d’Acey, a consacré sa thèse de doctorat à La théologie trinitaire d’Athanase d’Alexandrie.Le mot des Sources Chrétiennes
Plus connu et cité sous son nom latin de De synodis, ce texte d’Athanase est important pour la connaissance de l’histoire de la crise arienne au milieu du IVe siècle. Les « synodes » dont il est question sont les deux conciles symétriques qui viennent de se dérouler en 359, celui de Rimini en Occident et de Séleucie en Orient, dominés un peu artificiellement par le parti homéen qui, sans être arien, refusait de parler d’égalité ou l’identité de substance entre le Fils et le Père, et qui profite de la faveur de l’empereur Constance pour s’imposer alors qu’il ne disposait pas d’une vraie majorité. Athanase dénonce toutes ces manœuvres et défend la foi de Nicée disant le Fils consubstantiel au Père. Son traité est accompagné dans ce volume de deux autres pièces moins connues du dossier : la Lettre synodale émanant du concile « homéousien » d’Ancyre en 358, et un Traité de Basile d’Ancyre, chef de file de ce mouvement homéousien, qui commente quelques mois plus tard le premier document. Le mouvement homéousien tendra bientôt à fédérer le front antiarien d’Orient sur des bases un peu plus larges que celles de la stricte obédience au consubstantiel de Nicée, en confessant que le Fils est « d’une substance semblable » au Père (la « même substance » de Nicée faisait craindre à beaucoup que l’on confonde le Fils et le Père dans une même personne ou subsistance, c’est pourquoi cette nouvelle formulation, tout en honorant la foi de Nicée, semblait plus acceptable).
La lecture de cet ensemble de textes est exigeante ; la traduction se veut proche du grec pour mieux faire sentir la subtilité des débats sur les mots. Introductions et notes apportent de nombreux éclairages (auteurs, intention des textes, contexte d’écriture etc.) et donnent au lecteur tous les éléments pour comprendre les enjeux et les péripéties de cette période, parmi les plus agitées et les plus complexes de l’histoire de la crise arienne, et qui représente un tournant décisif dans l’évolution des choses. Athanase, polémiste et théologien, y donne toute sa mesure ; au-delà des discussions sur des formules trinitaires ambiguës et des credos qui se succèdent, il réfléchit en même temps sur ce qui distingue un vrai d’un faux concile, et sur ce qui fait qu’un énoncé de foi est conforme ou non à la tradition de l’Église.(B. Meunier, 2013)
Bernard Meunier
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 56 bis
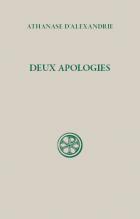
Deux apologies
décembre 1987
Accusé à tort et pourchassé, Athanase se réfugie dans le désert et se justifie.
-
SC 18 bis
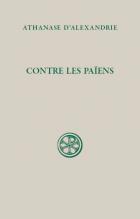
Contre les païens
décembre 1977
Les mythes ? Des histoires sans morale. Un plaidoyer pour le monothéisme, dans l'Égypte du 4e siècle.
-
SC 317

Anonyme
Histoire « acéphale » et Index syriaque des Lettres festales d'Athanase d'Alexandrie
février 1985
L'histoire dramatique d'Athanase, recordman du nombre d'exils, de 328 à 373.
-
SC 199

Sur l'incarnation du Verbe
décembre 1973
Pourquoi Dieu est-il devenu homme ? Pour remédier au péché, certes, mais surtout, pour que l'homme devienne Dieu.
-
SC 400

Vie d'Antoine
octobre 2004
L’acte de naissance de la vie monastique et la source de toutes les aspirations au désert.
Du même auteur
-
SC 622

Tome aux Antiochiens. Lettres à Rufinien, à Jovien et aux Africains
janvier 2022
Les mots de la foi peuvent-ils différer si la foi est la même? Une petite mise en scène, par le grand Athanase
-
SC 599
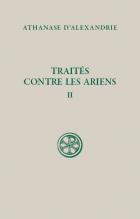
Traités contre les ariens, tome II. II-III
octobre 2019
La divinité du Fils, défendue pied à pied, verset par verset, par le grand zélateur de la foi nicéenne, vers le milieu du 4e siècle
-
SC 598
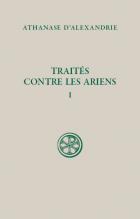
Traités contre les ariens, tome I
octobre 2019
La divinité du Fils, défendue pied à pied, verset par verset, par le grand zélateur de la foi nicéenne, vers le milieu du 4e siècle
-
SC 400

Vie d'Antoine
octobre 2004
L’acte de naissance de la vie monastique et la source de toutes les aspirations au désert.
-
SC 56 bis
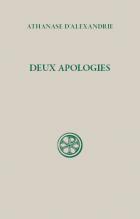
Deux apologies
décembre 1987
Accusé à tort et pourchassé, Athanase se réfugie dans le désert et se justifie.
-
SC 18 bis
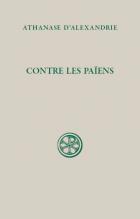
Contre les païens
décembre 1977
Les mythes ? Des histoires sans morale. Un plaidoyer pour le monothéisme, dans l'Égypte du 4e siècle.
-
SC 199

Sur l'incarnation du Verbe
décembre 1973
Pourquoi Dieu est-il devenu homme ? Pour remédier au péché, certes, mais surtout, pour que l'homme devienne Dieu.
-
SC 15
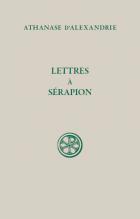
Lettres à Sérapion
juin 1947
L'Esprit Saint : du vent ? Athanase monte au créneau !