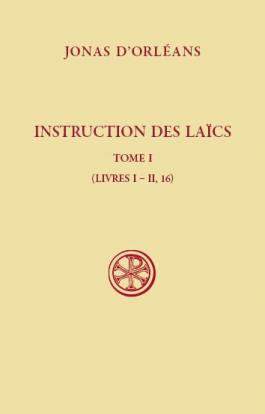-
SC 549
Jonas d'Orléans
Instruction des laïcs. Tome I
Livres I – II, 16décembre 2012Introduction, texte, traduction et notes par Odile Dubreucq. — Préface de Michel Rouche.
Révision assurée par Blandine Sauvlet.ISBN : 9782204099851467 pagesVivre dans le monde, en laïc : un défi relevé dès le 9e siècle, par un proche de Charlemagne.Présentation
Au IXe siècle, la vie monastique semble à tous être le modèle de vie chrétienne par excellence. Un haut dignitaire laïc, le comte d’Orléans Matfrid, demande à l’évêque Jonas comment il peut plaire à Dieu dans sa vie d’homme laïc marié. Jonas répond par cette longue réflexion : nous avons là l’un des premiers traités du Moyen Âge à l’usage des laïcs, qui s’inspire de la tradition des traités antiques d’éducation, tout en s’adaptant au contexte nouveau de la société carolingienne. Il valorise le statut du laïc, qu’il appelle à la vie spirituelle, à la pratique des sacrements... et au mariage, dont il a plaisir à dire la valeur.
Les manuscrits nous ont transmis deux versions du traité, car Jonas a retravaillé son œuvre. La présente édition, pour la première fois, permet au lecteur de lire le texte dans sa version définitive, tout en mettant en évidence les modifications apportées au cours de la réécriture, ainsi que les nombreuses sources patristiques utilisées. Ces deux volumes (SC 549 et 550) offrent donc à la fois un texte novateur et important au grand public, et un outil de travail aux spécialistes.
Odile Dubreucq, professeur certifiée d’Histoire, a consacré sa thèse de doctorat d’état à cette œuvre de Jonas d’Orléans, soutenue à la Sorbonne en 2007.
Le mot des Sources Chrétiennes
On attendait une édition critique nouvelle de ce traité, l’un des rares, à l’époque carolingienne, qui s’adresse à des laïcs vivant dans le monde (primitivement, l’écrit était dédié à Matfrid, comte d’Orléans, qui en était le commanditaire), et qui leur suggère comment y vivre en chrétiens au lieu de les inviter simplement, comme on le faisait couramment, à entrer dans la vie monastique. Jonas ayant donné de son vivant une nouvelle édition de son traité, les deux états sont édités ici, avec une typographie qui permet de voir ce qui a changé d’une édition à l’autre.
On pourrait voir avant tout dans ce traité un centon patristique : comme beaucoup d’auteurs carolingiens, Jonas puise abondamment chez ses prédécesseurs antiques – jusqu’à Bède le Vénérable, en passant par Grégoire le Grand et Isidore de Séville. Mais il s’adapte à une société nouvelle. Les appels à la responsabilité des chrétiens laïcs sont nombreux : le seigneur (ou ce qui deviendra le seigneur féodal) se voit attribuer, par rapport à sa maisonnée, une fonction pastorale de soin des âmes, un peu comme les patriarches du Premier Testament. Des travers sont vivement dénoncés, notamment chez ceux qui vivent à part de la communauté chrétienne à cause de leur rang : ils se font édifier des chapelles privées pour éviter de se rendre à l’église du village, et prennent le chapelain desservant pour leur domestique.
Le livre 1 insiste sur le devoir de fraternité : solidarité dans le bien, prière, sanctification, recherche du seul bien commun… Certains historiens ont dénoncé dans ce traité une pure utopie ! Le livre 2 est consacré à la morale sexuelle et dit du bien du mariage, à une époque où les moines monopolisaient le modèle de la vie chrétienne. L’auteur insiste sur la responsabilité éducative qui s’ensuit, d’élever des petits chrétiens… De fait, la procréation est pour l’auteur, à la suite des Pères qu’il cite, la seule justification de la sexualité. Le livre poursuit avec divers aspects concrets de la vie de laïc dans le monde : pratique des sacrements, respect du clergé, œuvres de charité, etc. Le livre 3 aborde plus largement la morale chrétienne : vertus et vices, dispositions intérieures, jugement dernier…Bernard Meunier
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Ce traité est l’un des rares, à l’époque carolingienne, qui s’adresse à des laïcs vivant dans le monde – primitivement, l’écrit était dédié à Matfrid, comte d’Orléans, qui en était le commanditaire – , et qui leur suggère comment y vivre en chrétiens au lieu de les inviter simplement, comme on le faisait couramment, à entrer dans la vie monastique. Jonas ayant donné de son vivant une nouvelle édition de son traité, les deux états sont édités ici, dans une nouvelle édition critique, avec une typographie qui permet de voir ce qui a changé d’une édition à l’autre.
Cette œuvre s’inscrit dans le contexte d’un basculement radical de la culture depuis la fin de l’Antiquité : alors que, jusqu’à la fin de l’Empire romain, l’idéal du fonctionnaire d’Empire lettré persistait, la culture est devenue l’apanage des clercs, les laïcs cultivés finissant souvent par embrasser l’état clérical, ce que fit lui-même. Ce traité, même s’il n’inversa pas la situation, répond donc à l’interrogation de ceux qui se demandent comme (ré)évangéliser les laïcs. Le nom du traité, composé avant 828, n’est pas de l’évêque d’Orléans lui-même. Les manuscrits se chargent de lui en attribuer un, sans toutefois se mettre d’accord. Nous en connaissons neuf, dont deux datent de la première moitié du IXe siècle et sont donc contemporains de la rédaction du texte. L’ensemble des manuscrits donne une double recension du texte, avec des différences notables. En reprenant toute la tradition manuscrite, O. Dubreucq propose dans ces deux volumes une nouvelle édition critique du traité qui rompt avec les principes d’édition ayant jusque là prévalu.
--
Jonas puise abondamment chez ses prédécesseurs antiques, mais il s’adapte à une société nouvelle. Les appels à la responsabilité des chrétiens laïcs sont nombreux : le seigneur (ou ce qui deviendra le seigneur féodal) se voit attribuer, par rapport à sa maisonnée, une fonction pastorale de soin des âmes. Des travers sont vivement dénoncés, notamment chez ceux qui vivent à part de la communauté chrétienne à cause de leur rang : ils se font édifier des chapelles privées pour éviter de se rendre à l’église du village, et prennent le chapelain desservant pour leur domestique.
Le tome I comporte le livre I et une partie du livre II (II, 1 – II, 16). Le livre I replace l’homme dans l’histoire du salut. Il rappelle la chute originelle et insiste sur le devoir de fraternité: solidarité dans le bien, prière, sanctification, recherche du seul bien commun… Il montre dans quel état se trouvait la créature après le péché d’Adam : c’était un être malade, incapable de se mouvoir et de se relever, abandonné et blessé au bord du chemin. Jonas rappelle l’action généreuse du Christ, qui a joué le rôle du bon samaritain et a racheté les hommes par son sacrifice gratuit. Jonas aborde cette question sous un angle très pastoral, en incitant fortement les chrétiens à recevoir ces différents signes sensibles de l’Église que sont les sacrements, en particulier la confirmation qui, de son temps, semble n’avoir été conférée qu’à un âge tardif (I, 7-8). La pénitence prédomine et oriente toute la vie chrétienne, considérée comme une purification permanente (I, 9-10 ; 14-16). Jonas envisage diverses de ses modalités. Les petits péchés peuvent être directement confessés à Dieu ou rachetés par la pratique traditionnelle de la prière, de l’aumône et du jeûne. Ils peuvent aussi être confi és à d’autres laïcs, ce que font quotidiennement les moines. Les péchésgraves doivent obligatoirement être avoués à un prêtre qui fixe la pénitence appropriée. Il semble que la pénitence puisse se faire secrètement en cas de péché occulte. En revanche, une faute publique doit être expiée publiquement.
Le deuxième livre du traité, qui constitue le cœur de l’ouvrage, examine les aspects plus spécifiques de la vie laïque. Le mariage est traité en seize chapitres qui forment un tout cohérent (II, 1-16). Jonas ne s’attache pas aux conditions de sa célébration mais défend vigoureusement des points fondamentaux : l’indissolubilité du couple, l’interdiction de renvoyer l’épouse légitime et de divorcer (II, 4.11.12). Dans le cadre du couple légitime, l’évêque définit également les conditions ou les périodes dans lesquelles peut s’épanouir la sexualité. Cependant le propos de Jonas ne se limite pas à des prohibitions. Il incite les époux à s’aimer, certes chastement et avec retenue, mais véritablement, à une époque où les témoignages d’amour conjugal restent relativement rares (II, 5). Il discerne ensuite en quoi les personnes mariées exercent un véritable ministère dans l’Église : un homme marié dirige comme un berger sa famille et sa maisonnée selon les préceptes énoncés par le Christ. Il a un rôle particulier dans la petite cellule humaine qui lui est confiée (II, 16).
Extrait(s)
(II, 16, p. 451)
Que les gens mariés sachent qu’ils doivent exercer dans leurs maisons le ministère des pasteurs. Chez les hommes comme chez les femmes, on trouve des gens qui cherchent des bénéfices pour l’âme de ceux qui leur sont soumis plutôt que des profits temporels. Mais on rencontre inversement des puissants et des dames nobles qui, avec avarice, n’exigent d’eux qu’un profit terrestre ; ils passent sous silence ou dédaignent complètement le salut de leur âme, dans la pensée qu’ils n’encourent aucun danger pour les fautes de leurs domestiques et qu’ils n’en auront aucun compte à rendre à Dieu. Il est cependant à craindre que l’on puisse d’une certaine façon leur appliquer cette parole du prophète, où on lit : Vous vous nourrissiez de lait, vous étiez vêtus de laine, vous tuiez ce qui était gras. Mais vous ne faisiez pas paître mon troupeau et autres choses que le sermon prophétique expose au sujet des pasteurs. Si, comme le dit le bienheureux Grégoire, « les membres sont inutilement forts quand la tête est malade », il est inévitable, lorsque les membres sont faibles, que la tête soit malade ou pas loin de l’être. Les passages qui vont suivre montrent bien quel soin et quelle attention il faut porter à la maison que l’on a sous sa direction.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
159
l. 8
conclu
conclus
Volumes SC connexes
-
SC 533

Deux commentaires sur le Livre de Ruth
décembre 2009
L'aïeule du Christ, vue au 9e siècle par deux élèves d'Alcuin, amateurs d'allégories.
-
SC 225 bis
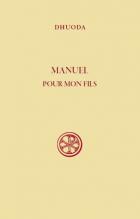
Manuel pour mon fils
septembre 1997
Une femme écrit à son fils : une sorte de testament spirituel, et un document rare, au milieu du 9e siècle.
-
SC 151
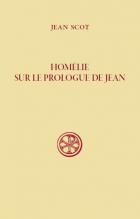
Homélie sur le Prologue de Jean
septembre 1969
Toute une théologie en quelques versets, par un Irlandais à la cour de Charles le Chauve (9e s.).
-
SC 180

Commentaire sur l'Évangile de Jean
décembre 1972
Le plus divin des évangiles, par un Irlandais à la cour de Charles le Chauve (9e s.).
Du même auteur
-
SC 550
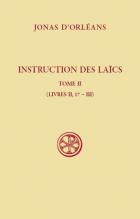
Instruction des laïcs. Tome II
septembre 2013
Vivre dans le monde, en laïc : un défi relevé dès le 9e siècle, par un proche de Charlemagne.
-
SC 407

Le Métier de roi
avril 1995
La royauté, une mission religieuse : au 9e siècle, les conseils d'un évêque au roi Pépin Ier.