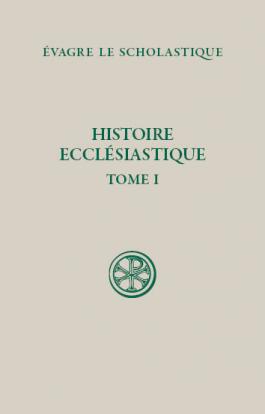-
SC 542
Évagre le Scholastique
Histoire ecclésiastique, Livres I-III
octobre 2011Texte grec de l'édition J. Bidez - L. Parmentier — Introduction par Guy Sabbah — Annotation par Laurent Angliviel de la Beaumelle et Guy Sabbah. — Traduction par (†) A.-J. Festugière, o.p., Bernard Grillet et Guy Sabbah.
Révision assurée par Jean Reynard.ISBN : 9782204097017582 pagesÉphèse, Chalcédoine, conciles et « Brigandage », pestes, séismes et incendies : de 431 à 518, une histoire haute en couleur.Présentation
Évagre, le dernier des historiens ecclésiastiques (fin VIe s.), entend poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs auxquels il rend hommage. Les trois premiers livres de son Histoire portent principalement sur les trois conciles christologiques, conséquence de la « querelle nestorienne », Éphèse I (431), Éphèse II (449) et Chalcédoine (451).
Les dissentiments théologiques entre Nestorius de Constantinople et Cyrille d'Alexandrie mettent inlassablement aux prises leurs successeurs qui en font des enjeux de pouvoir. Ces querelles divisent l'Orient gouverné par des empereurs obligés d'intervenir à coup d'encycliques et de contre-encycliques, voire par la force. Les moines sont le bras armé des évêques et des patriarches rivaux, tandis que les meilleurs d'entre eux, les stylites, s'élèvent en une admirable ascèse spirituelle.
Cette Histoire abonde en documents de première main, actes conciliaires, lettres des empereurs et des évêques. Elle constitue une source de premier ordre, encore proche des faits rapportés, due à la plume d'un « scholastikos » cultivé, rompu aux affaires, homme de confiance de l'évêque Grégoire d'Antioche. Elle assume à la fois la nouveauté de l'historiographie chrétienne et la tradition de l'historiographie classique.A.-J. Festugière, o.p. (1898-1982) est l'auteur de nombreuses traductions de textes grecs patristiques et historiques.
B. Grillet (1920-2020) a enseigné le grec, et G. Sabbah le latin, à l'Université Lumière Lyon 2.
L. Angliviel de la Beaumelle (1936-2019) a enseigné l'histoire ancienne à l'Université de Picardie.
Ensemble ils ont aussi publié l'Histoire ecclésiastique de Sozomène dans la collection.Le mot des Sources Chrétiennes
Après la publication des trois grands continuateurs d’Eusèbe au Ve siècle, Socrate, Sozomène et Théodoret, la collection entreprend, en deux volumes, une nouvelle Histoire ecclésiastique, plus tardive puisqu’elle a été rédigée à la fin du VIe siècle, celle d’Évagre, dit le Scholastique (c’est-à-dire qu’il était juriste de métier, comme ses prédécesseurs Socrate et Sozomène). Cette histoire est très précieuse, puisqu’elle prend la suite des trois autres et commence avec le concile d’Éphèse (431) et traverse ensuite près de deux siècles de controverses christologiques et de vie des Églises, d’Orient surtout ; dans le présent volume, les livres I-III partent de 431 pour s’achever vers 518, date de la restauration chalcédonienne. La période est chargée en événements pour le christianisme : le livre I est consacré notamment à Éphèse (431) et au Brigandage d’Éphèse (449), le livre II à Chalcédoine (451) et à sa réception dans les différentes régions de l’Empire, le livre III aux suites du schisme monophysite et aux tentatives impériales pour rétablir l’unité. Mais comme chez Sozomène, et peut-être plus encore, l’histoire civile s’invite largement dans cette histoire religieuse, qui intéresse tous les historiens de l’Antiquité tardive. On y trouvera des récits très vivants d’événements du temps : pestes, tremblements de terre, incendies, guerres… parfois présentés comme des conséquences des divisions chrétiennes et de la colère de Dieu (voir, en II, 13, le récit du grand incendie de Constantinople en 465 qui ravagea pendant 4 jours le centre ville, détruisant de nombreux monuments et maisons). L’histoire politique et militaire n’est pas oubliée non plus, permettant au lecteur de percevoir, au-delà des débats dogmatiques, tout un monde dont les vicissitudes éclairent en partie celles de l’histoire de l’Église.
Bernard Meunier
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Évagre, qui écrit à la toute fin du VIe siècle, se présente comme le continuateur des trois grands historiens du Ve siècle que sont Socrate, Sozomène et Théodoret, eux-mêmes continuateurs d’Eusèbe de Césarée, le père fondateur du genre. évagre commence son Histoire avec le concile d’éphèse (431) sous Théodose II, en passant par le second concile (ou brigandage) d’Éphèse (449) et Chalcédoine (451) sous Marcien, pour parcourir enfin toute l’histoire de la difficile réception de ce dernier concile au Ve et au VIe siècles. Son Histoire en 6 livres (les 3 derniers de plus en plus brefs) est structurée par les règnes des empereurs, mais elle garde une orientation essentiellement religieuse, tout en ne négligeant pas les aspects politiques et militaires des époques traitées. Évagre s’arrête en 594, sous le règne de l’empereur Maurice. Il aime, pour les périodes qu’il a connues, invoquer sa propre information de témoin oculaire, ou des traditions qu’il a recueillies lui-même, en particulier pour la région d’Antioche où il vit. Il est très sensible aux grandes figures de sainteté, comme celle de Syméon le Stylite, et aux récits de miracles. Il utilise des sources diverses : l’histoire profane de Priscus de Panium, l’histoire abrégée de son contemporain Eustathe d’épiphanie, la Chronographie de Jean Malalas, l’histoire de Zacharie le Rhéteur, ou encore celle, païenne, de Zosime.
L’Histoire ecclésiastique d’Évagre est transmise principalement par 4 manuscrits anciens (XIe-XIVe siècles), dont l’un est à l’origine de 5 copies plus récentes (XVe-XVIe siècles).
Livres I-III
Livre I. Débuts de la crise nestorienne. Lettres de Cyrille. Le concile d’éphèse et ses péripéties. Pourparlers de paix après le concile. évêques de Constantinople après Nestorius. Eutychès. Le brigandage d’éphèse. Syméon le Stylite et quelques autres saints. Transfert des restes d’Ignace de Rome à Antioche. Attila. Grand séisme en 447. édifices construits à Antioche. Guerres d’Italie et de Perse sous Théodose. L’impératrice Eudocie à Jérusalem et en Palestine ; monastères construits par elle. Mort de Théodose.
Livre II. Avènement de Marcien. Le concile de Chalcédoine, ses décisions, ses conséquences. événements politiques. Assassinat de Protérius d’Alexandrie, schisme monophysite. Les lettres encycliques de l’empereur Léon et les réponses épiscopales. Successions sur les sièges d’Alexandrie et de Constantinople. Séisme d’Antioche (458). Incendie à Constantinople. Guerres contre les Huns, déluges et inondations. Successions impériales. Long résumé, avec extraits, des actes de Chalcédoine.
Livre III. Faits civils et militaires. Politique religieuse de l’usurpateur Basilisque. Timothée Aelure à Alexandrie, Acace à Constantinople. Retour de Zénon et du chalcédonisme. Poursuite du schisme à Alexandrie. L’Hénotique de Zénon. Rapports entre les grands sièges patriarcaux, chalcédoniens ou monophysites. Le monastère des Acémètes et sa démarche auprès de Rome. Disputes autour de Chalcédoine. événements politiques et troubles induits dans les églises. La politique d’Anastase et l’ajout « crucifié pour nous » dans le Trisagion, troubles et revirement d’Anastase.
Extrait(s)
(II, 9-10, p. 285-291)
L’empereur Léon écrit des lettres encycliques pour s’informer auprès des évêques de l’état romain et des plus distingués dans la vie monastique sur le concile de Chalcédoine et l’ordination de Timothée surnommé Aelure : il leur envoyait aussi les copies des suppliques qui lui avaient été remises par les partisans de Protérius et par ceux de Timothée Aelure. (…)
Voilà pourquoi, le premier, Léon, évêque de la vieille Rome, écrivit une lettre en faveur du concile de Chalcédoine, et il rejeta l’ordination de Timothée comme ayant eu lieu irrégulièrement : cette lettre de Léon, l’autocrator Léon l’envoie à Timothée, évêque d’Alexandrie, le silentiaire Diomède s’acquittant des ordres impériaux. Timothée lui répliqua, blâmant le concile de Chalcédoine et la lettre de Léon. Les transcriptions en sont conservées dans ce qu’on appelle les encycliques, mais je les passe sous silence pour ne pas alourdir le présent ouvrage. Les évêques des autres cités demeurèrent fidèles aux définitions de Chalcédoine et condamnèrent de tous leurs suffrages l’ordination de Timothée.
II, 12. Sur le séisme qui eut lieu à Antioche (458), trois cent quarante-sept ans après celui sous Trajan
La deuxième année du règne de Léon, un extraordinaire tremblement de terre, un séisme vertical se produit à Antioche, précédé par certains événements provoqués par le peuple de la ville, dans un déchaînement dépassant toute sorte de folie au-delà de tout ce qu’on peut imaginer de bestial, fournissant comme un prélude à de tels malheurs. Bref, ce très grave séisme se produit en la cinq cent sixième année de l’ère de la cité, vers la quatrième heure de la nuit au quatorzième jour du mois Gorpiaios que les Romains nomment septembre, à l’aube d’un dimanche, en la onzième année du cycle fiscal. C’est le sixième que rapporte l’histoire, trois cent quarante-sept ans après celui qui eut lieu sous Trajan : celui-là s’était produit la cent cinquante-neuvième année de l’ère de l’autonomie de la cité ; celui-ci, sous Léon, la cinq cent sixième année, comme il a été exposé par les fervents de la recherche. Ce séisme donc abattit presque toutes les maisons de la Ville Neuve, qui était devenue très peuplée et ne comportait nulle partie déserte ou entièrement négligée, mais qui avait été extrêmement embellie par l’émulation des empereurs qui rivalisaient entre eux. Des palais impériaux, le premier et le second bâtiment furent abattus, cependant que les autres demeuraient debout avec le bain voisin, lequel, en vérité, inutilisé auparavant, permit alors à la cité de se baigner malgré la catastrophe, suite nécessaire de ce qui était arrivé aux autres bains. Le séisme fit s’écrouler aussi les portiques devant les palais et proche d’eux le tétrapyle, et, dans l’hippodrome, les tours qui encadrent les portes et certains des portiques proches d’elles. Mais, dans la Vieille Ville, absolument aucune chute ne toucha les portiques ou les maisons, tandis que le séisme secoua et renversa de petites parties des bains de Trajan, de Sévère et d’Hadrien. D’Ostrakinè, faubourg ainsi appelé, il abattit une partie avec aussi les portiques, ayant jeté à bas aussi ce qu’on appelle le Nymphée. Jean le Rhéteur a raconté tout cela dans le détail minutieusement. Il dit donc que remise fut faite à la cité par l’empereur, sur ses impôts, de mille talents d’or, et aux décurions, pour leurs biens perdus dans le fléau, remise de leurs charges, et qu’en outre l’empereur prit soin aussi des monuments publics.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
96
Référence biblique
c. Ps 45 (44), 14-15
Manque l’appel de note dans le texte en grec.
97
l. 14
un manteau brodé tout en or
un manteau brodé tout en orc
157
n. 3, dernière ligne
p. 59-107, p. 59 - 106.
p. 59-107.
344
Référence biblique
a.
b.
345
l. 2 en partant de la fin
Jésus-Christa
Jésus-Christb
346
Référence biblique
a.
c.
347
l. 7
hommea
hommec
373
alinéa 33, titre
Sur , évêque d’Antioche.
Sur Sévère, évêque d’Antioche.
578
l. 22
285
Volumes SC connexes
-
SC 489
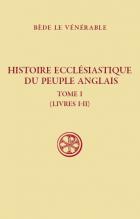
Histoire ecclésiastique du peuple anglais, tome I. Livres I-II
février 2005
De Jules César jusqu'en 731, un bénédictin anglais fournit dans cette œuvre majeure ce qu'il voit comme une histoire du salut.
-
SC 490
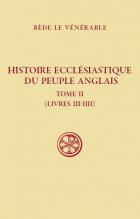
Histoire ecclésiastique du peuple anglais, tome II. Livres III-IV
juin 2005
De Jules César jusqu'en 731, un bénédictin anglais fournit dans cette œuvre majeure ce qu'il voit comme une histoire du salut.
-
SC 491
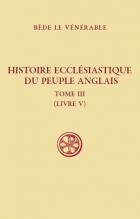
Histoire ecclésiastique du peuple anglais, tome III. Livre V
octobre 2005
De Jules César jusqu'en 731, un bénédictin anglais fournit dans cette œuvre majeure ce qu'il voit comme une histoire du salut.
-
SC 73

Histoire ecclésiastique, tome IV
décembre 1960
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 31

Histoire ecclésiastique, tome I
décembre 1952
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 41

Histoire ecclésiastique, tome II
décembre 1955
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 55

Histoire ecclésiastique, tome III
décembre 1958
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 477

Histoire ecclésiastique, Livre I
décembre 2003
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 493

Histoire ecclésiastique, Livres II-III
juin 2005
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 505

Histoire ecclésiastique, Livres IV-VI
novembre 2006
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 506

Histoire ecclésiastique, Livre VII
février 2007
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 306
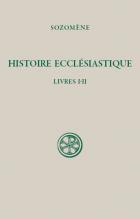
Histoire ecclésiastique, tome I
novembre 1983
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 418
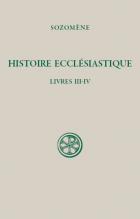
Histoire ecclésiastique, tome II
novembre 1996
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 495
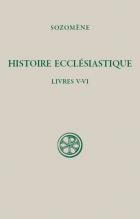
Histoire ecclésiastique, tome III
décembre 2005
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 516

Histoire ecclésiastique, tome IV
avril 2008
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 501

Histoire ecclésiastique, tome I. Livres I-II
mai 2006
De 323 à 428, un siècle d'histoire vu comme une victoire de la foi, par un zélateur de l'Église d'Antioche.
-
SC 530

Histoire ecclésiastique, Tome II. Livres III-V
avril 2009
De 323 à 428, un siècle d'histoire vu comme une victoire de la foi, par un zélateur de l'Église d'Antioche.
Du même auteur
-
SC 566

Histoire ecclésiastique, Livres IV-VI
juin 2014
L'empereur Justinien, la splendeur de Sainte-Sophie, les Perses, les Vandales et les Goths, les intrigues à la cour : de 518 à 590, une histoire haute en couleur.