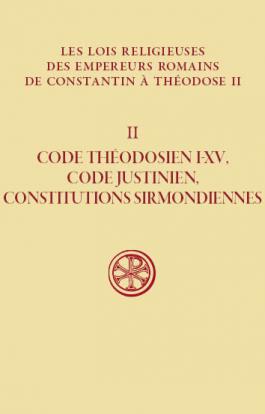-
SC 531
Anonyme
Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438). Volume II
Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennesjanvier 2009Texte latin de T. Mommsen , P. Meyer, P. Krueger. — Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. — Introduction et notes de Roland Delmaire, avec la collaboration d’Olivier Huck, François Richard et Laurent Guichard.
Révision assurée par Marie-Gabrielle Guérard.ISBN : 9782204088206592 pagesDe Constantin en 312 jusqu'à Théodose II en 439, les lois qui régissent l'empire et la chrétienté en ce siècle où tout change.Présentation
Ce volume fait suite à celui du livre XVI du Code Théodosien publié en 2005 (SC 497). Il contient des lois tirées des quinze autres livres ; d'autres, en plus petit nombre, provenant uniquement du Code Justinien ; et enfin, les « Sirmondiennes », petit recueil très ancien de lois religieuses non retenues dans aucun des deux Codes. Toutes ces lois, presque deux cents au total, datant de 312 à 438, ont en commun d'être, au moins par un aspect, des lois religieuses.
Certains de ces textes complètent les rubriques du livre XVI, dans lesquelles ils auraient pu figurer. D'autres ouvrent des aperçus nouveaux et apportent une note historique originale, en évoquant non plus seulement les responsables religieux, les croyances et les cultes, mais encore l'imprégnation chrétienne débutante ou grandissante de différents secteurs de la vie quotidienne, sociale, et administrative, sous la haute autorité d'un pouvoir impérial résolu, autant qu'avisé.
Une introduction, de copieuses annotations, des annexes, diverses mises au point et plusieurs index permettent d'apprécier au mieux ces documents d'une valeur inestimable pour la compréhension de l'Empire romain tardif comme de l'Église des IVe et Ve siècles.Le mot des Sources Chrétiennes
Ce second tome (et dernier) vise à compléter la documentation du premier, publié en 2005, qui donnait l'intégralité du livre XVI du Code, consacré aux religions ; en effet, diverses lois, dispersées ailleurs, concernaient aussi la religion : ce volume rassemble donc, en trois ensembles, d'une part les lois religieuses éparses dans les 15 premiers livres du Code Théodosien ; d'autre part les lois religieuses du Code Justinien qui relèvent de la même période (312-438) mais n'avaient pas trouvé place dans la première compilation ; enfin les « sirmondiennes », collection de lois retrouvée au XVIIe siècle par l'érudit Jacques Sirmond dans un manuscrit lyonnais : on en a longtemps contesté l'authenticité, qui semble aujourd'hui établie. Avec ce second volume, auquel il faut ajouter la publication l'an dernier des actes du colloque sur le Code Théodosien organisé par notre Institut en 2005, la collection offre désormais aux historiens du christianisme et de la société antique un ensemble riche de sources traduites et annotées, qui complète celui des Histoires ecclésiastiques. Parmi de multiples exemples de ce qu'on peut trouver dans ce deuxième tome du Code Théodosien, relevons trois lois qui offrent une vision contrastée des rapports difficiles avec la communauté juive : les mariages mixtes entre juifs et chrétiens sont interdits, assimilés à un adultère (III, 7, 2) ; en revanche, dans le cadre des réquisitions de logements pour les soldats et autres fonctionnaires impériaux en déplacement, il est interdit de réquisitionner une synagogue (VII, 8, 2) ; enfin le sabbat et les jours de fêtes juives doivent être respectés comme les dimanches (VIII, 8, 8). On constate ailleurs que les lois hostiles au célibat (attitude traditionnelle dans la société romaine classique, notamment en matière d'héritage) sont abrogées, pour permettre à cet état de vie d'être adopté plus largement, conformément aux valeurs de la nouvelle religion (VIII, 16, 1).
Bernard Meunier
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Code Justinien (lois sur la religion)
On trouve dans le volume II des Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) 16 lois qui appartiennent à cette période 312-438, mais sont absentes du Code Théodosien et ont été recueillies plus tard dans le Code Justinien compilé en 529 sur l’ordre de l’empereur Justinien, puis réédité en 534 dans une version mise à jour qui est la seule conservée. Sur ces 16 lois, 6 (du livre I) concernent le christianisme, 1 (livre I) le judaïsme, 3 (livre III) les fêtes et jours fériés, et 4 (livres VII et XI) les biens des temples païens.
Lois concernant le christianisme : nombre des decani chargés des funérailles des pauvres à Constantinople ; conditions d’accès des colons à la cléricature ; les dirigeants des corporations doivent être chrétiens ; droit de faire appel au tribunal de l’évêque plutôt qu’au civil s’il y a accord des parties ; ne pas représenter la croix par terre ; les affranchissements peuvent avoir lieu dans les églises devant témoins ; les défenseurs des cités doivent être des chrétiens non hérétiques ; obligation du repos du dimanche.
Lois sur le judaïsme : les juifs doivent se marier selon la loi de l’empire et non la leur, interdiction de la polygamie.
Lois sur le paganisme : interdiction d’aliéner les biens de l’empereur ou des temples, à restituer sans prescription ; gestion des domaines des temples.
Code Théodosien (lois sur la religion) I – XV
Ce livre appartient à un ensemble de deux volumes publiant Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), dont le premier volume (SC 497) donnait le livre XVI du Code Théodosien, entièrement consacré aux lois religieuses de l’empire. Les éditeurs ont voulu donner ici en complément toutes les lois à portée religieuse, éparses dans les 15 premiers livres du Code. Il y en a 166, qui peuvent concerner le christianisme, le judaïsme ou la religion païenne. En ajoutant les « sirmondiennes » et les lois du Code Justinien qui se rapportent en fait au temps du Code Théodosien mais n’y figurent pas, on dispose ainsi de l’ensemble de la législation des empereurs, entre 312 et 438, concernant toutes les religions de l’empire.
On ne peut résumer 166 lois, mais seulement énumérer les domaines concernés. Ce sont les suivants :
1) christianisme : les affranchissements dans les églises, les apostats, l’asile dans les églises, les biens des églises, le célibat, les clercs, les conversions, la liberté d’enseignement, l’entrée dans le clergé, les fêtes et jours fériés, les procédures judiciaires propres au clergé, la justice épiscopale, l’interdiction de marquer quelqu’un au visage, le statut des préposés au labarum, les moines, le rôle social des églises, le serment par le nom de Dieu, la succession des clercs, les vierges et les veuves.
2) judaïsme (12 lois) : les possibilités de faire appel à un arbitrage juif, le sabbat, la circoncision, le mariage, les synagogues victimes de spoliation, les charges curiales, les naviculaires (armateurs transportant le blé vers la capitale).
3) cultes païens : les sacerdoces, le culte impérial, les concilia provinciaux (délégués des cités chargés du culte impérial), les temples et leurs biens, les fêtes, les tombes et les funérailles, la magie et l’astrologie, la vénération des images de l’empereur.
Constitutions sirmondiennes
Il s’agit de 16 lois à thème religieux, tirées de l’ensemble appelées « lois sirmondiennes » du nom de leur éditeur du XVIIe siècle, le jésuite Jacques Sirmond, qui les a éditées en 1631 comme un « Appendix » à son édition du Code Théodosien. Ces sont des lois aussi anciennes que celles du Code Théodosien ; 6 d’entre elles n’ont pas été intégrées du tout dans celui-ci, pour diverses raisons expliquées dans l’introduction qui défend leur authenticité ; les 10 autres y figurent sous une forme différente, et la rédaction transmise par les sirmondiennes pourrait être originale, c’est-à-dire antérieure à leur forme intégrée dans le Code, qui leur faisait toujours subir des retouches.
Les sirmondiennes sont tirées d’un unique manuscrit du VIIe/VIIIe siècle (qui se trouva à Lyon au IXe siècle où il fut annoté par le diacre Florus), conservé actuellement à Berlin. Cette collection devait déjà exister à la fin du VIe siècle en Bourgogne et son origine pourrait être contemporaine du Code Théodosien lui-même.
La juridiction épiscopale est sans appel et le témoignage d’un seul évêque suffit ; les clercs condamnés par des évêques doivent être exilés ; les clercs ne peuvent pas faire appel aux tribunaux civils ; les chrétiens ne peuvent être circoncis par des juifs, et si un juif s’est converti au christianisme, il ne doit pas être inquiété par d’autres juifs ; les gens abandonnés lors d’une famine ne peuvent être réclamés par leurs maîtres après ; privilèges des clercs, limitations des droits des hérétiques et des juifs ; l’amnistie pascale et ses limites ; les clercs déchus sont renvoyés à leur collège professionnel ou à la curie de leur municipalité ; les clercs ne doivent pas cohabiter avec des femmes qui ne sont pas leurs épouses ; privilèges du clergé ; contre les donatistes et autres hérétiques ; droit d’asile dans les églises ; contre des donatistes qui maltraitent des catholiques ; contre ceux qui calomnient un clerc en justice ; les chrétiens doivent contribuer au rachat des captifs.
Extrait(s)
Code Théod. IX, 40, 2 (SC 531, p. 197). Loi du 21 mars 316, de Constantin et Licinius.
L’empereur Constantin Auguste à Eumelius. Si quelqu’un a été condamné à l’école de gladiateurs ou aux mines en raison de la nature des crimes pour lesquels il a été arrêté, qu’absolument rien ne soit écrit sur son visage, alors qu’on peut, par une inscription sur ses mains ou sur ses mollets, faire comprendre le châtiment auquel il a été condamné. En effet, le visage formé à l’image de la beauté céleste (cf. Gn 1, 26) ne doit être marqué en aucune manière.
Code Just. III, 12, 2 (SC 531, p. 417). 3 mars ou mai 321.
L’empereur Constantin Auguste à Helpidius. Que tous les juges, les populations urbaines et les activités de tous les métiers soient en repos le jour vénérable du soleil. Cependant, que ceux qui résident à la campagne se consacrent librement et légalement à la culture des champs, car il arrive souvent que le blé ne puisse être confié aux sillons ou les vignes aux fosses à un jour plus favorable, en sorte que la commodité accordée par la prévoyance céleste ne soit pas perdue à cause de la date.
Sirm. 5 (SC 531, p. 489). 18 mars 419.
C’est par une astuce impudente qu’est intentée une action quand sont réclamés à leur condition ou leur origine ceux que leur maître ou leur patron n’avait pu aider en temps de famine, quand ils étaient poussés à la mort par manque de nourriture. En outre, il est injuste que, si un homme a été conservé à la lumière par les dépenses d’un autre, quelqu’un ose avec espérance le revendiquer comme lui étant attaché à un titre quelconque. (…) S’ils sont réclamés par quelqu’un, nous permettons qu’ils soient rendus à l’autorité de celui qui le réclame seulement après que celui-ci se soit acquitté doublement de la somme versée au titre de leur valeur et de toutes les dépenses engagées.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 497
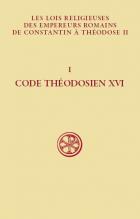
Anonyme
Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) Vol. 1
septembre 2005
De Constantin en 312 jusqu'à Théodose II en 439, les lois qui régissent l'empire et la chrétienté en ce siècle où tout change.
-
SC 31

Histoire ecclésiastique, tome I
décembre 1952
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 41

Histoire ecclésiastique, tome II
décembre 1955
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 55

Histoire ecclésiastique, tome III
décembre 1958
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 73

Histoire ecclésiastique, tome IV
décembre 1960
La première histoire de l'Église, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
-
SC 477

Histoire ecclésiastique, Livre I
décembre 2003
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 493

Histoire ecclésiastique, Livres II-III
juin 2005
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 505

Histoire ecclésiastique, Livres IV-VI
novembre 2006
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 506

Histoire ecclésiastique, Livre VII
février 2007
De 305 à 439, une histoire « des Églises », par un constantinopolitain membre d'une Église dissidente.
-
SC 306
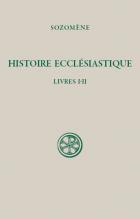
Histoire ecclésiastique, tome I
novembre 1983
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 418
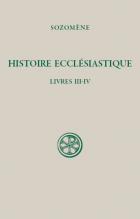
Histoire ecclésiastique, tome II
novembre 1996
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 495
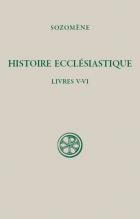
Histoire ecclésiastique, tome III
décembre 2005
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 516

Histoire ecclésiastique, tome IV
avril 2008
De la conversion de l'empereur Constantin en 324 au règne de Théodose II en 439, une nouvelle « histoire ecclésiastique ».
-
SC 501

Histoire ecclésiastique, tome I. Livres I-II
mai 2006
De 323 à 428, un siècle d'histoire vu comme une victoire de la foi, par un zélateur de l'Église d'Antioche.
Du même auteur
-
SC 497
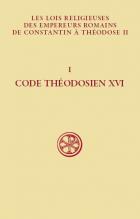
Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) Vol. 1
septembre 2005
De Constantin en 312 jusqu'à Théodose II en 439, les lois qui régissent l'empire et la chrétienté en ce siècle où tout change.