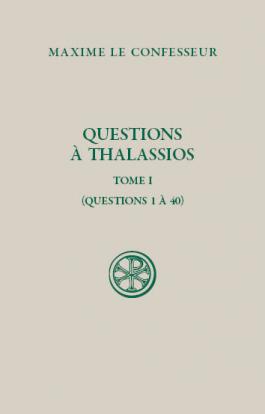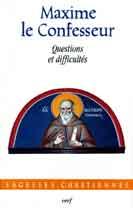-
SC 529
Maxime le Confesseur
Questions à Thalassios. Tome I
décembre 2010Introduction et notes par Jean-Claude Larchet. — Traduction par Françoise Vinel.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.Révision assurée par Bernard Meunier – Smaranda Marculescu.ISBN : 9782204093859425 pagesComment coller l'un des plus grands théologiens de l'Antiquité ? Vers 630, Thalassios aura essayé…Présentation
Les Questions à Thalassios sont l'une des œuvres les plus importantes de Maxime le Confesseur (580-662). Elles ont sans doute été écrites entre 630 et 634, alors que Maxime, fuyant l'invasion des Perses et des Avars, séjournait dans un monastère près de Carthage.
Thalassios, higoumène d'un monastère libyen, avait posé à Maxime soixante-cinq questions sur des passages difficiles de l'Écriture. Dans ses réponses, celui-ci manie avec une grande virtuosité l'exégèse allégorique. Les thèmes les plus divers y sont abordés sans ordre, mais peu à peu se dégage une vision théologique, cosmologique, anthropologique et spirituelle cohérente et profonde. Cette pensée originale, aussi puissante qu'exigeante, a exercé une grande influence dans l'Orient byzantin, notamment sur Jean Damascène, et aussi dans l'Occident latin, grâce à une traduction faite au IXe siècle par Jean Scot Érigène. Elle fascine aujourd'hui encore nombre de théologiens des différentes Églises.Le mot des Sources Chrétiennes
Autre analyste de l’âme, puissant mais difficile, que l’introduction aide à approcher, tandis que la traduction essaie au mieux de rendre clair ce qui ne l’est pas en grec ! Cette œuvre exigeante et d’une grande richesse réunit les réponses de Maxime le Confesseur à des questions qui portent formellement sur l’Écriture, mais en fait sur différents aspects de l’anthropologie chrétienne. Ainsi, au fil des pages, on lira que l’amour de Dieu suppose pour l’âme de renoncer à son affection pour le corps et pour le monde, car le désir du plaisir s’accompagne inévitablement de son contraire qui est la crainte de la douleur ; et dans la crainte nous ne sommes pas libres. C’est là le mauvais amour de soi, celui des passions. Le bon amour de soi intègre la connaissance. Celle-ci pourtant peut aussi bien nourrir notre intelligence que la pervertir : il faut apprendre à connaître le monde à partir de Dieu, du point de vue de Dieu, et non à partir de l’arbre de la connaissance en revendiquant un accès direct à lui. Peut-on connaître quoi que ce soit quand on méconnaît la cause ? Le mal est, profondément, cette ignorance. Lecture intéressante et fine de Genèse 2-3 !
Ailleurs, dans la Qu. 33, à propos de la loi de la chair et de celle de l’esprit, on verra que Maxime ne manque pas d’audace : il va jusqu’à dire que la loi de la chair, activée en fonction des sens, nous lie naturellement à la matière, tandis que la loi de l’esprit, activée en fonction de l’intelligence, nous unit à Dieu sans intermédiaire ! Mais il y a un envers : pour lui, la puissance de l’intelligence humaine est à la mesure de la puissance de la déraison quand nous nous détournons de notre Cause. On le voit, Maxime, dans la lignée des Alexandrins et d’Évagre le Pontique, attache une très grande importance au rôle de l’intelligence humaine, non seulement dans la compréhension de la foi, mais aussi dans la vie spirituelle. Cette voie périlleuse et féconde caractérise toute une famille de pensée au temps des Pères.Bernard Meunier
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Les Questions à Thalassios appartiennent au genre byzantin répandu des « Questions et réponses ». Maxime a composé d’autres œuvres de ce genre, consacrées à l’explication de passages difficiles de Grégoire de Nazianze ou du Pseudo-Denys ; celles-ci sont consacrées à des passages de l’écriture. Thalassios a posé à Maxime 65 questions portant sur des versets ou des thèmes difficiles de l’AT ou du NT. Dans ses réponses, Maxime se livre à une lecture spirituelle de l’écriture (qu’il appelle « sens anagogique »), ce qui fait de ces 65 Questions, de manière éparse mais cohérente, un exposé approfondi de son anthropologie spirituelle. Les Questions, qui peuvent au début représenter une ou deux pages de texte, sont de plus en plus longues pour finir, dans les dernières, par de véritables traités de 25 pages.
L’œuvre a dû être écrite au début des années 630. Elle est dédiée à Thalassios, moine libyen qui avait hébergé Maxime lors de l’exil de ce dernier en Afrique du Nord et était devenu son disciple. Chaque question est suivie de quelques scholies qui en expliquent les passages difficiles. On s’est demandé si les scholies étaient de Maxime lui-même, car elles présentent les caractéristiques de son style ; en tête de l’œuvre, un « prologue aux scholies » semble être aussi de Maxime. Certaines peuvent remonter à lui, d’autres ont été ajoutées peu à peu, tous les manuscrits ne les contiennent pas toutes.
Les Questions à Thalassios sont transmises par 47 manuscrits, dont une quinzaine sont antérieurs au XIIe siècle, répartis en une famille orientale et une famille italo-grecque, auxquelles s’ajoute un ms. de Patmos inclassable (de l’an 1081).
On n’essaiera pas de résumer chacune des 40 questions que contient ce premier volume, questions qui ne font en général que 2 ou 3 pages. L’œuvre commence par deux prologues, l’un, bref, pour annoncer les scholies, qui parle du travail en nous de la raison (logos) qui nous purifie en nous éloignant de la chair ; l’autre, plus long (et déjà accompagné de scholies), qui énonce une série de questions posées par Thalassios et ses moines, avant les questions sur l’écriture proprement dite, et qui portent sur les passions : quelles sont-elles, comment nous viennent-elles, qu’opèrent-elles en nous, etc. Maxime enseigne qu’avec l’oubli de Dieu, cause de tout, surgit dans l’être humain l’irrationalité qu’est le mal, l’amour de soi et du corps, et toutes les passions qui s’engendrent les unes les autres.
La question 1 parle encore des passions : sont-elles mauvaises en soi, ou relativement à leur objet ? Le sage peut s’en servir en vue du bien, comme la providence divine elle-même. L’écriture arrive à partir de la question 2 : comment concilier la création en 6 jours de Gn 1 avec Jn 5, 17 : Mon Père jusqu’à présent est à l’œuvre ? C’est non seulement la sauvegarde de la création jusqu’à sa divinisation, mais c’est aussi son unification dans un unique logos. La Qu. 3 fournit une exégèse spirituelle de certains détails de la Cène lucanienne (l’homme et la cruche d’eau, le maître de maison, la chambre haute), etc. Les versets expliqués dans ces 40 Questions proviennent de l’ensemble de la Bible (surtout Gn et Ex pour l’AT ; Jean, Actes et Paul pour le NT). En fait, c’est plus l’enseignement spirituel de Maxime qui structure l’œuvre, que le choix des versets bibliques, dont le contexte n’est pas étudié, et dont quelques détails sont chaque fois choisis pour servir de support, moyennant une lecture symbolique, à cet enseignement. Le point central de l’œuvre est le Logos, créateur et Rationalité du monde, unifiant les logoi qui se trouvent derrière chaque réalité sensible et qui mènent celui qui les contemple jusqu’au Logos véritable, compris dans l’inconnaissance.
Extrait(s)
(Qu. 10, l. 77-90, SC 529, p. 201)
Quant au sens de ceux qui l’entourent (Ps 88, 8), réfléchissons-y, si vous voulez bien. Celui qui est entouré a des gens qui l’entourent devant, derrière, à droite et à gauche. Ainsi puisque le Seigneur aussi a un entourage, comprenons que ceux de derrière sont ceux qui s’avancent derrière le Seigneur Dieu de manière irréprochable parce qu’ils suivent les commandements selon la vertu pratique ; ceux de gauche sont ceux qui sont parvenus à la contemplation naturelle en esprit, parce qu’ils comprennent selon la piété ses jugements – le livre des Proverbes dit en effet de la sagesse : à sa gauche, richesse et gloire (Pr 3, 16) – ; ceux de droite sont ceux qui ont reçu la connaissance immatérielle des réalités intelligibles, connaissance pure de représentation sensible – à sa droite, dit l’écriture, des années de vie (Pr 3, 16) –, ceux de devant sont ceux qui, à cause de l’ardeur amoureuse débordante de leur désir intellectif pour la beauté divine, ont été jugés dignes de jouir de la vision face à face.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
258
3e l. en partant du bas
du mal qui s’était mêlée à elle
du mal qui s’était mêlé à elle
278
l. 5
il règnera
il régnera
323
§ 2
il n’y personne
il n’y a personne
Volumes SC connexes
-
SC 523

Questions évangéliques
décembre 2008
Des récits de l'enfance à la Résurrection, l'accord des évangiles vu par un exégète du 4e siècle.
Du même auteur
-
SC 569

Questions à Thalassios. Tome III
décembre 2015
Comment coller l'un des plus grands théologiens de l'Antiquité ? Vers 630, Thalassios aura essayé…
-
SC 554

Questions à Thalassios. Tome II
août 2012
Comment coller l'un des plus grands théologiens de l'Antiquité ? Vers 630, Thalassios aura essayé…
-
SC 9

Centuries sur la charité
juin 1945
La profondeur dans la concision : la charité en quatre cents pensées, par un génie du 7e siècle.
-
-
-