-
SC 482
Grégoire le Grand (Pierre de Cava)
Commentaire sur le Premier Livre des Rois, tome VI
(1-116)mars 2004Introduction, texte, traduction et notes par Adalbert de Vogüé.
Révision assurée par Dominique Gonnet.ISBN : 9782204073677263 pagesD'Anne et de Samuel à l'onction de David, une méditation sur les modèles du sacerdoce et de la vie monastique, par un moine italien du 12e siècle.Présentation
Commentant d'abord la faute et le rejet du roi Saül, puis l'élection et l'onction royale du jeune David, ce dernier livre du commentaire « grégorien » voit dans ces deux hommes des figures du sacerdoce chrétien. Saül représente ces évêques faillis qui sont trop nombreux au XIIe siècle, dit Pierre de Cava, selon lequel les péchés de luxure se multiplient dans le haut clergé. David, au contraire, figure le pasteur idéal, qui allie la sévérité envers le péché à la bonté envers les pécheurs.
Samuel, qui réprouve Saül et confère à David l'onction royale, est aussi un modèle d'évêque. Outre les aperçus qu'il donne ainsi sur la vie cléricale de son temps, l'auteur adresse des recommandations à ses frères les moines, invités à pratiquer pleinement la vie commune et l'obéissance à leurs supérieurs. Cependant le dernier mot de ce grand ouvrage, comme le premier, est pour le Christ, qu'on ne se lasse pas de contempler à travers toutes ces figures.
Examining first of all the sin and rejection of King Saul, then the election and royal unction of the young David, this latest volume of ‘Gregorian’ commentary depicts these two men as figures of the Christian priesthood. Saul represents those weak bishops who abounded in the 12th century, according to Pierre de Cava, who claims that the sins of lust proliferated amongst the high clergy. David, on the contrary, embodies the ideal shepherd who allied severity towards sin with compassion for sinners.
Samuel, who reproved Saul and conferred upon David the royal unction, has also the characteristics of a bishop. Apart from the insights he offers into the clerical life of his time, the author addresses some recommendations to his brother monks, suggesting that they participate in their communal existence to the full and show obedience to their superiors. However, the last words in this great work, like the first, are devoted to Christ, whom one never wearies of contemplating through the prism of these figures.Moine de la Pierre-qui-Vire, Adalbert de Vogüé a édité de nombreux volumes des Sources Chrétiennes, en particulier La Règle de saint Benoît (1971-1977).
Le mot des Sources Chrétiennes
Il aura fallu quinze ans au P. Adalbert de Vogüé, moine à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire pour achever, en six tomes, l'édition du long Commentaire sur le Premier livre des Rois de Pierre de Cava. Primitivement attribué à Grégoire le Grand (VIe s.), ce commentaire a été restitué, en cours de publication, à son véritable auteur, Pierre Divinacello, un moine bénédictin du XIIe siècle, abbé de Cava-Venosa dans l'Italie méridionale. La découverte est d'importance et justifie que, parvenu au terme de l'édition, le P. A. de Vogüé rappelle, une fois encore, les raisons qui lui font restituer à Pierre de Cava l'entière paternité du commentaire. Sans doute l'auteur est-il à ce point nourri de l'œuvre de Grégoire le Grand qu'il en vient à le pasticher presque involontairement, mais il appartient pourtant à une autre époque, y compris peut-être dans sa manière de lire l'Écriture.
Le livre VI, qui fait l'objet du sixième et dernier tome de cette publication (SC 482), commente les chapitres 15 et 16 de 1 Samuel – ou 1 Rois selon l'appellation ancienne – c'est-à-dire la victoire de Saül sur les Amalécites, puis son rejet par Dieu et l'onction de David par le prophète Samuel pour succéder à Saül comme roi d'Israël. Le récit biblique fournit certes à Pierre de Cava le cadre de son commentaire, mais la seule histoire qui l'intéresse vraiment est une histoire spirituelle : Agag, le roi d'Amalech, y devient la métaphore des pensées impures et de l'esprit de fornication, contre lesquels il faut mener une guerre sans merci ; Saül y représente le pasteur indigne qui s'abandonne à l'orgueil et ne combat qu'en partie la luxure, puisqu'il épargne Agag ; David, en revanche, fournit le modèle du pasteur chrétien, dont Samuel offre un autre exemple, tout en incarnant aussi l'autorité suprême de l'Église. De la méditation qu'il poursuit sur le rejet de Saül et l'élection divine de David, Pierre de Cava entend tirer un enseignement pour les moines et les clercs de son temps :« Si le récit de l'Histoire sainte nous présente le roi Saül, qui commença bien mais ne persévéra pas dans le bien où il avait débuté, c'est pour que nous voyions en lui ce que nous devons imiter et ce dont nous devons nous garder » (VI, 1, 1).
L'histoire biblique, relue au prisme de l'allégorie, lui sert notamment à dénoncer les manquements à la chasteté du clergé contemporain, à rappeler aux moines le devoir d'obéissance et l'observance de la Règle au sein de la communauté, à définir les critères de choix d'un évêque et les qualités qu'il doit posséder pour exercer sa charge. Amplement développé à l'occasion du récit de l'onction de David (1 S 16), ce dernier point reflète sans aucun doute une préoccupation forte de l'abbé de Cava-Venosa, à une époque où le choix des évêques parmi les moines tend à se généraliser en Italie.
Portrait de l'évêque modèle, David est aussi pour le commentateur une figure du Christ. Parvenu au terme de son commentaire, l'auteur relit une seconde fois le récit de l'onction de David, mais alors dans une perspective christologique. Ainsi le commentaire s'achève comme il avait commencé, avec le Christ « alpha et oméga », signe de sa présence au cœur même de l'interprétation :« À présent, ce livre est arrivé au terme que nous nous étions fixé, et il nous faut l'achever. Mais il nous revient en mémoire que nous avons référé le début du volume à la vie du Rédempteur. Et puisque, selon Jean, notre Rédempteur est à la fois principe et fin, ce sera donner au livre la meilleure des fins que de le terminer par une évocation de notre Rédempteur » (VI, 97, 1).
Jean-Noël Guinot
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Commentaire sur le Premier Livre des Rois, Livre VI
Le dernier volume de la présente édition couvre le sixième et dernier livre du texte, soit les neuvième et dixième sections identifiées par A. de Vogüé. Comme l’auteur l’avait annoncé dans la préface, le commentaire se termine avec l’onction royale de David. L’exégèse de la neuvième section, qui porte sur les prélats ayant chuté, est spirituelle. Celle de la dixième section, sur l’ordination du nouveau pasteur et sa tâche d’annonce du Christ, est spirituelle et allégorique.
La neuvième section est consacrée aux prélats qui ont chuté. En effet, parce qu’il s’est abstenu de tuer le roi Amalec et ses troupeaux, Saül représente aux yeux du commentateur le type du prélat failli, que Samuel reprend et rejette malgré ses excuses. En effet, sa faute est vue comme une désobéissance aux ordres reçus du prophète, et donc de Dieu lui-même. À la lutte contre la luxure, que poursuit Samuel en mettant à mort le roi Amalec, se joint la lutte contre la désobéissance. Dans le commentaire de Pierre de Cava, Samuel représente alors non seulement l’évêque mais aussi l’abbé. La séparation entre Samuel et Saül est lue comme la séparation définitive de l’Église et du pécheur endurci.
La première partie de la dixième section continue et achève le commentaire spirituel de la section précédente. David représente le nouveau pasteur chrétien qui entre en charge. Samuel a reçu l’ordre d’aller à Bethléem, où Dieu s’est choisi un roi, pour remplir sa corne d’huile. Celle-ci représente à la fois la force et les réprimandes qu’un prélat doit parfois adresser, tandis que la douceur de l’huile contrebalance ce qu’il y a de redoutable dans le pouvoir royal. Or Samuel n’est pas coutumier des limites dans les villes de son peuple : cela figure l’attitude du pontife chrétien qui doit se tenir à distance, dans une sorte de retraite permanente. Le prophète doit rechercher, à la lumière de l’Écriture, le nouveau roi dans une « maison » ou une « communauté religieuse » qui lui ait appris la vie parfaite, dans les « pâturages » de la contemplation. Une fois choisi, le nouvel élu doit être instruit des devoirs de sa charge, et avant tout de la conformation au Christ. La grâce de Dieu sur l’élu est le fruit du sacrement que l’ordination que figure l’onction. Elle doit demeurer sur lui pour l’éternité. Le commentaire se terminer par une exégèse typologique. David représente le Christ, « oint », c’est-à-dire annoncé par les prophètes et par Jean Baptiste. Samuel est donc la figure des prêcheurs qui annoncent le Christ et imitent ses souffrances par la mortification de la chair. La finale christologique du commentaire, qui fait écho au début, est riche d’idées sur le ministère de la prédication.
Extrait(s)
(VI, 114, 2-3, p. 245)
Qu’il se lève donc, celui qui reçoit l’ordre d’oindre le roi, qu’il tende sa personne vers les sommets. Qu’il se lève en une haute action, qu’il se lève en une haute contemplation. Qu’il se lève dans la sagesse du discours, qu’il se lève dans la vertu de charité. Celui qu’on oint en prêchant est si grand que c’est à peine si les sublimes parviennent jusqu’à lui. Et peut-être Paul pouvait oindre celui-là, puisqu’il dit : « Notre vie est dans les cieux. » Il pouvait oindre celui-là, parce qu’il s’était élevé jusqu’aux secrets du troisième ciel et qu’il entendait au paradis des paroles cachées. Le Seigneur Jésus doit être prêché de façon sublime par des hommes sublimes. Voilà pourquoi le prophète reçoit l’ordre de se lever, lorsqu’on lui commande d’oindre celui qui le préfigure. C’est une vertu très élevée que celle de la vie parfaite, mais beaucoup atteignent parfaitement à cette perfection.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
255
col. 2, l. 10
15, 2224 107, 5-8
Jn 15, 22-24 107, 5-8
A déplacer p. 254, dans les références de Jean.
Volumes SC connexes
-
SC 71

Homélies sur Josué
décembre 1960
L'Ancien Testament devient « nouveau » lorsqu'on entend prêcher l'Alexandrin !
-
SC 389
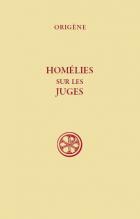
Homélies sur les Juges
avril 1993
L'Ancien Testament devient « nouveau » lorsqu'on entend prêcher l'Alexandrin !
-
SC 328
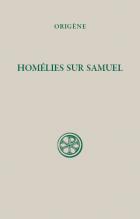
Homélies sur Samuel
mai 1986
L'Ancien Testament devient « nouveau » lorsqu'on entend prêcher l'Alexandrin !
Du même auteur
-
SC 469

Commentaire sur le Premier Livre des Rois, tome V
janvier 2003
D'Anne et de Samuel à l'onction de David, une méditation sur les modèles du sacerdoce et de la vie monastique, par un moine italien du 12e siècle.
-
SC 449

Commentaire sur le Premier Livre des Rois, tome IV
mai 2000
D'Anne et de Samuel à l'onction de David, une méditation sur les modèles du sacerdoce et de la vie monastique, par un moine italien du 12e siècle.
-
SC 432

Commentaire sur le Premier Livre des Rois, tome III
août 1998
D'Anne et de Samuel à l'onction de David, une méditation sur les modèles du sacerdoce et de la vie monastique, par un moine italien du 12e siècle.
-
SC 391

Commentaire sur le Premier Livre des Rois, tome II
juin 1993
D'Anne et de Samuel à l'onction de David, une méditation sur les modèles du sacerdoce et de la vie monastique, par un moine italien du 12e siècle.
-
SC 351

Commentaire sur le Premier Livre des Rois, tome I
mars 1989
D'Anne et de Samuel à l'onction de David, une méditation sur les modèles du sacerdoce et de la vie monastique, par un moine italien du 12e siècle.


