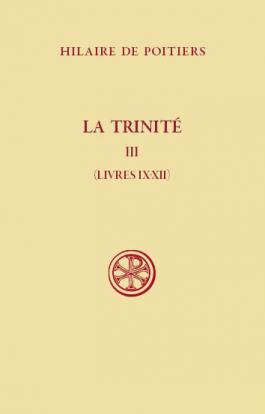-
SC 462
Hilaire de Poitiers
La Trinité, tome III
(Livres IX-XII)octobre 2001Texte latin de P. Smulders (CCL). — Traduction, notes et index par Georges-Matthieu de Durand (†), o.p., Gilles Pelland, s.j. et Charles Morel, s.j.
Révision assurée par Dominique Bertrand – Dominique Gonnet.ISBN : 9782204066884500 pagesUne pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.Présentation
L'édition du traité de La Trinité s'achève avec ce tome troisième, regroupement des livres IX, X, XI et XII du grand ouvrage d'Hilaire de Poitiers. Tous contredisent la thèse arienne de l'infériorité du Fils par rapport au Père, qu'elle soit développée à partir de l'Incarnation, de la Passion, de la résurrection ou de la génération éternelle.
Par la manière dont il aborde le mystère de la passion de l'homme-Dieu, le livre X se place un peu à part des autres. Il offre en outre un repère historique précieux, car Hilaire déclare parler du fond de l'exil, où « se trouvent la vérité et ceux qui la disent ». Or, c'est en 356, après le concile de Béziers et sous l'effet de décisions prises à l'unanimité des participants, que l'évêque de Poitiers avait dû quitter sa Gaule natale pour l'Asie mineure.
Il n'écrit pas pour gémir sur son époque « si pénible ». Au contraire, il exulte de voir que ses propres années d'exil manifestent une prophétie relevée par saint Paul à l'intention de Timothée : à savoir la recherche, dans les derniers temps, de « maîtres à prêcher la créature plutôt que Dieu ». À force de scruter les Écritures en communiant au souffle qui les anime, Hilaire a reconnu de manière tangible l'avènement de ces « derniers temps ».
Dans les derniers livres de son traité Hilaire a mis ses lecteurs à l'écoute du Nouveau Testament, le plus riche en révélation sur la vie trinitaire. Dans le tout dernier, il revient à l'Ancien pour s'opposer fermement à l'interprétation arienne du terme « créer » dans le verset de Prov. 8, 22 : « Le Seigneur m'a créé comme le commencement de ses voies et en vue de ses œuvres », et pour mieux affirmer le Christ, le Fils de Dieu, aussi éternel que son Père, et Dieu lui-même.Le texte d'Hilaire présenté ici s'appuie sur l'édition critique donnée par Peter Smulders dans le Corpus Christianorum en 1980.
La traduction est l'œuvre de Georges-Matthieu de Durand, qui, longtemps professeur à l'université de Montréal, a publié plusieurs volumes dans les Sources Chrétiennes. L'ont relayé dans cette tâche le P. Charles Morel, éditeur dans la même collection des Homélies sur Ézéchiel de Grégoire le Grand, et le P. Gilles Pelland, ancien recteur de l'Institut Pontifical Oriental à Rome.Le mot des Sources Chrétiennes
Contrairement à ce qui avait été annoncé au début de la publication, l'édition du grand traité d'Hilaire de Poitiers, La Trinité, s'achève avec ce tome ΙΙΙ (500 pages) qui contient les Livres IX à ΧΙΙ. Hilaire reprend et poursuit dans ces pages la réfutation de l'arianisme, entreprise dans les livres précédents. Non, de même qu'il n'y a pas de différence de nature entre le Père et le Fils (Livre VIII), le Fils n'est pas inférieur au Père (Livre IX). Les allégations des hérétiques tirées des Écritures sont infondées et vaines : elles ne prennent pas en compte « l'économie divine », le mystère de l'Incarnation, la reconnaissance du Christ Jésus « vrai homme comme il est vrai Dieu ». Hilaire présente à son lecteur le dossier des citations scripturaires alléguées par les ariens pour défendre la thèse de l'infériorité du Fils par rapport au Père, puis, méthodiquement, il réfute leur argumentation. Chaque citation est soumise à un examen critique minutieux, chacune est l'occasion pour Hilaire, tout à la fois, d'une leçon d'exégèse et de théologie. L'un après l'autre, les arguments que les ariens croyaient pouvoir tirer de l'Écriture s'effondrent : le Père n'est pas plus grand que le Fils, le Fils ne possède pas une gloire inférieure à celle du Père, sa connaissance n'est pas moindre que la sienne, car leur unité est véritablement une unité de nature, qui ne saurait se réduire à une simple unité de volontés. La même technique de réfutation est mise en œuvre au Livre Χ pour combattre les arguments que les ariens prétendent tirer des déclarations du Christ au moment de sa Passion et de ses souffrances sur la croix, puis au Livre ΧΙ, de ses déclarations postérieures à sa Résurrection, au moment de son retour vers le Père, enfin au Livre ΧΙΙ, qui sert en sorte de couronnement à tout l'ouvrage et qui est tout entier un commentaire de ce que déclare la Sagesse personnifiée en Proverbes 8, 22-30 « Le Seigneur m'a créée comme le commencement de ses voies... », un verset que les ariens invoquent pour affirmer que le Christ n'a pas été engendré, mais créé par Dieu, que loin d'être Dieu à égalité avec le Père, il n'est qu'une créature. Le Livre ΧΙΙ s'achève par une grande prière (52-57), la troisième et la plus longue de tout le traité, après celle des Livres Ι, 37-38 et 11, 19-21 ; Hilaire y livre sa doctrine sur le Saint-Esprit en professant, en conclusion de tout l'ouvrage, la foi baptismale au Père, au Fils et à l'Esprit.
Comme pour les deux tomes précédents, la traduction du texte d'Hilaire est celle du regretté Père G.-Μ. de Durand, revue par le Père Charles Morel, l'annotation est due au Père Gilles Pelland.Jean-Noël Guinot
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
La Trinité, Livres IX-XII
Les quatre derniers livres IX, X, XI et XII reprennent par le fond et positivement les points les plus résistants de la doctrine.
Livre IX : Riposte à des contre-arguments ariens. Exposé de l’interprétation orthodoxe des passages de l’Écriture sur lesquels les ariens se fondent pour prouver l’infériorité du Fils par rapport au Père.
Le livre X a une importance particulière pour l’histoire de la théologie, car Hilaire y traite de manière originale le problème des souffrances du Christ, c’est-à dire de la divinité dans sa Passion. Une thèse forte est proposée : « Homme, le Christ a souffert, mais sa nature divine l’empêchait de ressentir la douleur pour lui-même, et il la ressentait et la voulait pour nous les hommes. »
Le livre XI continue la réfutation des ariens à propos de l’interprétation de Jn 20, 17 et de 1 Co 15, 21-28 : il pose le point de la divinité du Christ dans la résurrection et la session à la droite du Père.
Le livre XII s’attaque à l’interprétation arienne de Pr 8, 22 (1-34), avant de livrer une étude approfondie de Pr 8, 22-30 (35-51). La conclusion de l’ouvrage prend la forme d’une longue prière (52-57).
Extrait(s)
En quel sens le Père est-il plus grand ? (p. 99-101)
Quand donc est-il dit : Le Père est plus grand que moi ? Évidemment quand lui est donné le nom au-dessus de tout nom. Quand est-il dit au contraire : Moi et le Père nous sommes un ? Assurément, quand toute langue confesse que le Seigneur Jésus est dans la gloire de Dieu le Père. Si donc le Père est plus grand par son autorité de donateur, le Fils en est-il par hasard plus petit par la confession du don ? Ainsi celui qui donne est-il plus grand, mais n’est pas maintenant plus petit celui à qui il est donné d’être un avec le Père. S’il n’est pas donné à Jésus de devoir être confessé dans la gloire de Dieu le Père, il est plus petit que le Père. Mais, s’il lui est donné d’être dans la gloire où est le Père, tu as dans l’autorité du donateur de quoi le faire plus grand et dans la confession de ce qui est donné de quoi les faire un.
Le Père est donc plus grand que le Fils ; plus grand, bien sûr, lui qui donne d’être tel qu’il l’est lui-même, lui qui octroie au Fils, grâce au mystère de la nativité, d’être l’image de l’lnengendré, lui qui engendre à partir de lui-même, dans sa propre forme, celui qu’il rénove à nouveau de la forme de serviteur en la forme de Dieu et qui, né en sa gloire comme Christ-Dieu, se voit donner de nouveau d’être en sa propre gloire, selon la chair, Jésus-Christ, le Dieu qui est mort.IX, 35, 10-30
Une nativité selon la nature n’a pu en effet infliger un changement de nature au Dieu Monogène et celui qui, en vertu d’une vraie nativité divine, a reçu la subsistance d’un Dieu subsistant ne saurait être séparé par la réalité de sa nature de celui qui est le seul vrai Dieu. La nature a sauvegardé les lois qui en font une réalité, de sorte que la réalité de la nature devait entraîner la réalité de la nativité et que le Dieu unique ne pouvait émettre hors de soi un Dieu d’une autre espèce. Ainsi le mystère de Dieu ne consiste-t-il ni dans une solitude ni dans une diversité, car on n’a pas à tenir pour un second Dieu celui qui tient de Dieu sa subsistance, ainsi que toutes les propriétés de sa nature, et il ne demeure pas non plus une monade, celui que, pour avoir engendré vraiment, la foi nous enseigne à proclamer Père.
Par suite, le Dieu engendré n’a point abandonné ce qui fait le propre de sa nature et, par la vertu de sa nature, il est en celui dont il a en lui la nature par la nature de sa nativité. En lui, Dieu n’est pas dégradé ou dégénéré car, si la nativité avait introduit quelque vice, elle aurait infligé un opprobre principalement à la nature par qui la nativité aurait été produite, dès le moment où ce qui serait issu de cette nature aurait cessé d’être ce qui la fait telle. Cela étant, la dégradation n’atteint pas celui qui en vertu de la nativité est établi en une nouvelle substance, mais bien celui qui, engendrant un Fils, incapable de maintenir le niveau de sa nature, aurait engendré quelque chose d’extérieur et d’étranger à soi.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Volumes SC connexes
-
SC 299

Contre Eunome, tome I
octobre 1982
Dieu ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu ? Magistrale réponse du grand Cappadocien.
-
SC 305

Contre Eunome, tome II
octobre 1983
Dieu ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu ? Magistrale réponse du grand Cappadocien.
-
SC 231

Dialogues sur la Trinité, tome I
septembre 1976
Le Fils est-il Dieu ? Et l'Esprit ? Au début des années 420, les acquis de près d'un siècle de controverses.
-
SC 237

Dialogues sur la Trinité, tome II
octobre 1977
Le Fils est-il Dieu ? Et l'Esprit ? Au début des années 420, les acquis de près d'un siècle de controverses.
-
SC 246

Dialogues sur la Trinité, tome III
juin 1978
Le Fils est-il Dieu ? Et l'Esprit ? Au début des années 420, les acquis de près d'un siècle de controverses.
-
SC 386
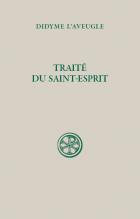
Traité du Saint-Esprit
octobre 1992
Au 4e siècle, l'autre traité grec sur le Saint-Esprit, avec celui de Basile.
-
SC 208

Lettres théologiques
décembre 1974
En quelques petites pages, une leçon de théologie qui anticipa ou inspira bien des conciles.
-
SC 396
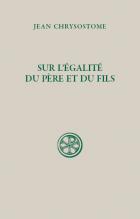
Sur l'égalité du Père et du Fils
janvier 1994
Le credo de Nicée pour les nuls, ou l'éloquence vivante de « Bouche d'or ».
-
SC 68
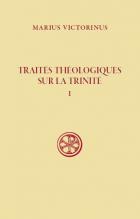
Traités théologiques sur la Trinité, tome I
décembre 1960
Quand un chrétien féru de platonisme défend la foi en la Trinité, à Rome, après 350.
-
SC 69
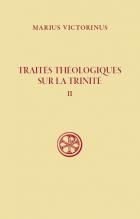
Traités théologiques sur la Trinité, tome II
décembre 1960
Quand un chrétien féru de platonisme défend la foi en la Trinité, à Rome, après 350.
-
SC 252

Traité des principes, tome I. Livres I et II
décembre 1978
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 253
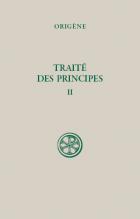
Traité des principes, tome II
décembre 1978
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 268

Traité des principes, tome III
mars 1980
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 269

Traité des principes, tome IV
mars 1980
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 312

Traité des principes, tome V
mai 1984
La foi jusqu'à la spéculation ? Le plus ardu et le plus passionnant des ouvrages de l'Alexandrin.
-
SC 63

La Trinité
décembre 1959
Une puissante et ferme synthèse théologique, par un victorin venu d'Angleterre au 12e siècle.
-
SC 267
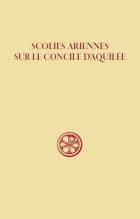
Anonyme
Scolies ariennes sur le concile d'Aquilée
janvier 1980
Les hérétiques ariens condamnés à Aquilée en 381 ? Ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Du même auteur
-
SC 625

Commentaires sur les Psaumes, tome V (Psaumes 119-126)
avril 2022
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 621
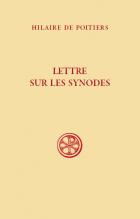
Lettre sur les synodes
janvier 2022
"Consusbstantiel au Père": qu'est-ce que ça veut dire? Hilaire dévoile le "making-of" du credo.
-
SC 605

Commentaires sur les Psaumes, tome IV (Psaumes 67-69 et 91)
décembre 2020
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 603

Commentaires sur les Psaumes. Tome III (Psaumes 62-66)
juin 2019
Le sens des Psaumes 62 à 66 ouvert par Hilaire vers 360 avec une clé divine : le Christ lui-même.
-
SC 565
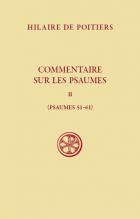
Commentaires sur les Psaumes, tome II (Psaumes 51-61)
juillet 2014
Des cris de souffrance ? Les Psaumes 51 à 61 sont, pour Hilaire, dans la bouche du Ressuscité.
-
SC 515

Commentaires sur les Psaumes, tome I (Psaumes 1-14)
juin 2008
« Heureux l'homme » : un voie spirituelle éclairée au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 448
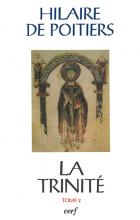
La Trinité, tome II
avril 2000
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 443
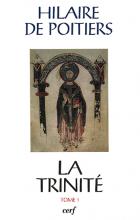
La Trinité, tome I
juin 1999
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 347

Commentaire sur le Psaume 118, tome II
novembre 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 344

Commentaire sur le Psaume 118, tome I
mai 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 334
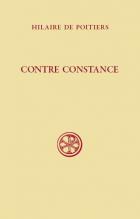
Contre Constance
février 1987
Un empereur veut imposer à l'Église une foi hérétique ? Une charge au vitriol par un évêque persécuté.
-
SC 258
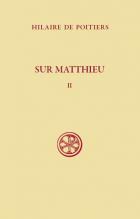
Sur Matthieu, tome II
mai 1979
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 254
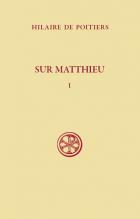
Sur Matthieu, tome I
décembre 1978
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 19 bis
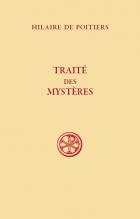
Traité des mystères
décembre 1967
Une clé de lecture de l’Ancien Testament, miroir de figures annonçant le Christ.