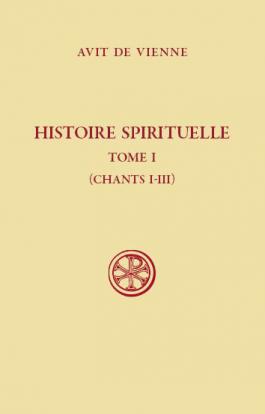-
SC 444
Avit de Vienne
Histoire spirituelle, tome I
(Chants I-III)septembre 1999Introduction, texte critique, traduction et notes par Nicole Hecquet-Noti.
ISBN : 9782204063210334 pagesUne épopée biblique en vers, dont le Christ est le héros, par un évêque et poète latin, au tournant des 5e et 6e siècles.Présentation
Alcimus Ecdicius Avitus, évêque de Vienne entre 490 et 518 est une figure importante de la fin de l'Antiquité tardive. Issu d'une famille de l'aristocratie gallo-romaine, il est un des derniers dépositaires de la culture latine classique dans le royaume burgonde de Gondebaud. Évêque engagé dans la vie politique de son époque comme en témoigne sa correspondance, il a aussi écrit, aux alentours de l'an 500, une épopée biblique « La geste de l'histoire spirituelle » (De spiritalis historiae gestis), en cinq chants, inspirés de la Genèse (chants 1-4) et de l'Exode (chant 5).
Cette épopée est une glorification du Christ à travers la figure des héros de l'Ancien Testament : Adam (chants 1 à 3), Noé (chant 4) et Moïse (chant 5). Écrite dans un style tout à la fois sobre et précieux, elle s'adresse à un public de lettrés, fin connaisseur de la culture classique. Cette geste christique originale, qui associe la poésie épique classique, l'inspiration de la Bible, la connaissance des écrits patristiques et des poètes chrétiens, est l'une des illustrations les plus réussies de l'osmose de la culture antique et de la spiritualité chrétienne.Nicole Hecquet-Noti est chargée d'enseignement à l'Université de Genève. Intéressée par le développement de l'épopée dans l'Antiquité chrétienne, elle consacre actuellement ses recherches à l'édition complète de l'épopée biblique d'Avit de Vienne.
Le mot des Sources Chrétiennes
Revenons en Gaule avec Avit de Vienne et les trois premiers chants de son Histoire spirituelle (SC 444), édités par Nicole Hecquet-Noti, professeur à l'Université de Genève. Nous voici donc sur les bords du Rhône, à la fin du Ve siècle, dans le royaume burgonde, et, pour nous qui sommes à Lyon, presque entre voisins. Avit est, en effet, le frère cadet d'Apollinaire, évêque de Valence, avec qui il entretient une abondante correspondance et à qui il adresse le prologue de son Histoire spirituelle ; il est également apparenté à Sidoine Apollinaire, l'évêque de Clermont, lui aussi poète. Comme ce dernier, marié à la fille de l'éphémère empereur romain d'Occident, Eparchius Avitus (455-456), il appartient à une famille de la grande aristocratie patricienne. Né à Vienne, vers 450, de parents chrétiens et baptisé par l'évêque Mamert, dont son père sera le successeur avant qu'il ne le remplace à son tour, vers 490, sur le siège épiscopal, Avit restera évêque de Vienne jusqu'à sa mort, vers 518. Défenseur de la foi catholique contre l'arianisme, il ne parviendra pas à ramener à l'orthodoxie le roi Gondebaud, dont il fut le conseiller influent, mais obtiendra la conversion de son fils Sigismond. Modestement, à la suite d'Hilaire, il poursuivit, comme évêque et théologien le même combat.
L'Histoire spirituelle nous fait connaître le poète chrétien et le lettré. Son appartenance à l'aristocratie gallo-romaine lui a permis de bénéficier, malgré les troubles de l'époque, d'un solide enseignement où l'apprentissage des techniques oratoires va de paire avec l'étude des auteurs classiques. Aussi sa poésie est- elle, d'une certaine manière, une poésie savante, que le lecteur goûtera d'autant plus qu'il saura reconnaître l'allusion, l'image ou les mots empruntés à Virgile ou à Lucain, à Lucrèce ou à Ovide. Ce jeu de lettrés gagne encore en subtilité par ses nombreuses références à des poètes chrétiens – Dracontius, Juvencus, Prudence, Sidoine Apollinaire –, tout aussi familiers au cercle d'amis pour lesquels Avit compose ses poèmes. Pour nous, qui sommes moins immédiatement sensibles à ces « clins d'œil » entre érudits, ces rapprochements sont signalés en notes, et un index des auteurs anciens, en fin de volume, permet de mesurer l'étendue de la culture profane et chrétienne d'Avit.
L'Histoire spirituelle pourtant ne se réduit pas à un simple divertissement littéraire. L'ambition d'Avit est plus vaste : il veut écrire une épopée chrétienne à la gloire du Christ, une histoire du salut dont les fondements sont posés dès la création du monde. Cette « Geste de l'histoire spirituelle » (De spiritalis historiae gestis), il la conçoit naturellement, mais en réduction, sur le modèle de l'épopée virgilienne. Comme cette dernière, elle n'a en réalité qu'un seul héros : le Christ, dont les personnages de l'Ancien Testament, Adam (chants I-III), Noé (chant IV) et Moïse (chant V) sont les figures. Le récit de la création du monde (I), du péché originel (II) et de la sentence divine (III), puis celui du déluge (IV) et de la sortie d'Égypte (V) doivent se lire selon une interprétation typologique : ce sont là, en figures, les étapes de l'histoire du salut.
Un second volume est prévu pour achever cette publication, particulièrement représentative de la rencontre qui s'est opérée, sur les bords du Rhône aussi, entre la culture antique et la pensée chrétienne.Jean-Noël Guinot
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Le De spiritalis historiae gestis a probablement été composé entre 497 et 500. Avit l’évoque en effet dans sa Lettre 51 adressée à Apollinaris, fils de Sidoine Apollinaire ; cette lettre est datée d’avant 507. Plus précisément, dans le prologue du De gestis, Avit explique avoir regroupé dans un seul corpus quelques chants retrouvés chez un ami, qui ont, en 500, échappé à la prise de Vienne par Clovis. Le poème était donc rédigé à cette date. Enfin, certains parallèles textuels suggèrent qu’Avit connaissait le De laudibus Dei de Dracontius, publié vraisemblablement après 496.
L’œuvre, diffusée du vivant de l’auteur, connaît un vif succès ; dès le vie siècle, elle fait partie d’un canon de poètes épiques bibliques, qui comprend Juvencus, Prudence, Sédulius, Avit et Arator. L’utilisation de ces poètes comme auteurs scolaires durant le Moyen-âge est bien attestée, par la tradition indirecte d’une part, par les catalogues des bibliothèques médiévales, d’autre part. Il ne reste malheureusement guère de trace de cette large diffusion : les premiers manuscrits remontent au début du ixe siècle.
La tradition manuscrite se répartit en deux branches, que distinguent une origine géographique différente et des leçons spécifiques. Parmi les Gallicani, on distingue trois familles, dont les deux premières remontent à un manuscrit attesté, mais perdu. Les Germanici, répartis en deux familles, transmettent pour leur part les six chants d’Avit ensemble ; ils ne contiennent pas le premier prologue Ad Apollinarem ; ils ajoutent à la fin du chant 6 trois vers additionnels (comme R, de la famille des Gallicani) ; leurs leçons sont très différentes de celles des Gallicani.
Outre des Lettres et des Homélies, Avit a laissé une épopée biblique en vers, l’Histoire spirituelle. Sa Lettre 51 la présente comme un divertissement littéraire : libellos… lusi. Mais sa poésie n’a rien de la leuitas d’un Sidoine Apollinaire, dont il prétend pourtant s’inspirer. Dans la voie frayée par Juvencus et Sédulius, Avit reprend un projet abandonné par Paulin de Nole : chanter la gloire du Christ dans une épopée commençanthc avec le récit de la création du monde. Seule une épopée en hexamètres peut remplir ce désir – à condition toutefois de bannir toute licence poétique et de privilégier le message chrétien à l’élégance du style. Le poète se considère comme un pius uates, inspiré par Dieu. Néanmoins, l’objectif de l’œuvre n’est pas d’éducation ou de prosélytisme : il s’agit plutôt d’un divertissement intellectuel, adressé à des lettrés capables d’appréhender différents de niveaux de lecture dans le texte ; Avit reconnaîtra dans le prologue du De uirginate que le public capable d’appréhender un tel poème était restreint.
Le De spiritualis historiae gestis est véritablement une « geste de l’histoire spirituelle » : le poète y narre des hauts-faits, ceux d’Adam (chants I-III), de Noé (chant IV) et de Moïse (chant V), tous trois figures du Christ, seul véritable héros. La typologie est donc la clé de l’interprétation de l’œuvre. Quoique la finalité du poème ne soit pas polémique, Avit profite des passages christologiques pour réfuter l’arianisme en rappelant la nature divine du Christ et pour contrer les (semi-)pélagiens en soulignant l’importance du péché originel et la nécessité de la grâce. Le modèle virgilien est prégnant, à la fois dans l’organisation de l’œuvre et la progression des héros (les trois étapes du De gestis, errements d’Adam, réhabilitation par Noé, épisodes guerriers de Moïse correspondent à la structure de l’Énéide et au cheminement d’Énée). Mais les sources d’inspirations d’Avit sont beaucoup plus larges : il connaît Juvencus, Sédulius et Arator, mais aussi Cyprien Gallus, Hilaire, Marius Victorinus et Dracontius ; il emprunte à Ovide, Stace et Silvius Italicus, ainsi qu’à Cicéron et Pline l’Ancien ; il a lu Augustin, Ambroise, Lactance et Claudien Mamert.
Avit s’appuie sur les techniques d’écritures apprises durant sa jeunesse : un poète doit imiter (imitatio) son modèle, le renouveler (renouatio) et de le dépasser (aemulatio) en le retraitant (retractatio). Une réécriture épique et biblique laisse donc peu de marge de manœuvre. Le poète mélange les tons : louange du Christ, expression des sentiments, style hymnique se complètent. Il mélange les genres : pour amplifier son sujet, il ajoute volontiers des discours, construits selon les principes rhétoriques, qui chargent d’émotion le texte scripturaire ; des excursus agrémentent également la narratio. Certains relèvent de l’ekphrasis (description anatomique de l’être humain et évocation du Paradis dans le chant I). D’autres sont exégétiques, soit qu’ils servent d’exemplum pour soutenir le propos moral de l’auteur (les Marses, la femme de Lot, Lazare et le riche), soit qu’ils aient une valeur symbolique, illustrant les sacramenta, les mystères qui fondent la théologie chrétienne (le sommeil d’Adam et la naissance d’Ève, le symbolisme du bois).
Avit connaît la Vulgate, mais il utilise également des Vieilles latines lorsque le texte correspond mieux à ses intentions poétiques, doctrinales ou stylistiques. Il évite les néologismes venus du grec, mais emploie volontiers, comme les écrivains tardifs, des noms d’agent en -tor de création récente ; de manière générale, son lexique est particulièrement riche. Enfin, la versification d’Avit est parfaitement conforme aux lois de la métrique hexamétrique classique, même si l’effacement progressif de la longueur des syllabes conduit à certaines hésitations sur la longueur de quelques syllabes.
Histoire spirituelle, chants I-III
Le SC 444 contient le prologue du De gestis ainsi que les chants I à III sur Adam et le début de l’histoire du salut : le récit de la création du monde (I) précède celui du péché originel (II) et de la sentence divine (III).
Extrait(s)
Avit de Vienne, Histoire spirituelle I, 144-169 (SC 444, p. 148-151)
Pendant ce temps, le sixième soir ramena le début de la nuit, en chassant le jour par l’alternance du temps : pendant que toutes les créatures qui respirent rejoignent un doux repos, Adam, le corps détendu, s’abandonne aussi au sommeil. Le Père tout-puissant répandit alors dans son cœur un sommeil écrasant et engourdit ses sens d’une pesanteur telle qu’aucune force ne peut réveiller son esprit assoupi : ni le fracas qui viendrait à frapper ses oreilles tranquilles, ni le ciel qui tonnerait à ce moment-là, ébranlé sur son axe, ni même la pression d’une main sur son corps n’aurait brisé son sommeil. C’est alors qu’il soustrait de la masse osseuse d’Adam une des côtes du flanc gauche pour la remplacer par la chair. Se dresse aussitôt un corps à la beauté remarquable, paré pour le mariage ; un visage nouveau, la femme, paraît soudain au jour. Dieu l’unit à son mari par une loi éternelle et, par la jouissance du mariage, compense la perte d’une partie du corps de celui-ci.
Le symbole révélé par ce sommeil se continue par celui de la mort que, délibérément, le Christ incarné a subie. Alors que, prêt à souffrir la passion, il était suspendu en haut de l’arbre élevé de la croix pour y suspendre les fautes du monde, un licteur planta un javelot dans le flanc de la victime crucifiée. Aussitôt, jaillissant de la blessure, une eau ruissela pour promettre aux peuples le bain vivifiant du baptême, et il coula un flot de sang, marque du martyre. Ensuite, durant les deux nuits qu’il resta étendu, l’Église surgit de son flanc et s’unit à lui dans son sommeil.
Le paradis (p. 157 et 159)
Donc, là où commence le monde, par-delà les Indes, là où, dit-on, se rejoignent les confins de la terre et du ciel, sur une hauteur inaccessible à tous les mortels, demeure un bois sacré fermé par une barrière éternelle, depuis que l’auteur du premier crime en fut chassé après sa chute ; après la juste expulsion des coupables de ce séjour bienheureux, cette terre bénie accueille maintenant des serviteurs célestes. Ici, les brumes du solstice ne surviennent jamais selon l’alternance des saisons et les chaleurs de l’été ne reviennent pas après les frimas, comme c’est le cas lorsque le soleil, culminant à l’apogée de sa course, ramène la chaude saison, ou que la gelée blanchit les guérets d’un givre épais. Ici, la clémence du ciel maintient un printemps éternel : pas de vent violent du midi, mais sous un ciel toujours pur, les nuages s’enfuient pour laisser place à un temps constamment serein. La nature du lieu ne réclame pas les pluies qu’elle n’a pas, mais les graines se contentent de la rosée qui leur est offerte. Tout le sol est perpétuellement vert et la face souriante de la terre tiède resplendit ; les collines gardent toujours leur herbe et les arbres leur chevelure : en même temps qu’ils se répandent en une abondante floraison, une soudaine montée de sève gonfle leurs bourgeons.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
16
l. 21
Ehrlers (2 fois)
Ehlers (2 fois)
16
l. 4
19676
19676
42
l. 3
souligné
soulignée
51
l. 4 (titre chap. 4)
narrratives
narratives
53
Titre courant, jusqu’à la p. 73
narrratives
narratives
56
l. 8 en partant de la fin
avait
avaient
123
l. 20
renvoit
renvoie
124
l. 5
la description deux partie
la description en deux parties
173
l. 3 à partir de la fin
la
La
1-34 : La vie des premiers hommes
183
l. 7 titre
loth
Loth
226
Apparat critique
i.G
i. G
288
Apparat critique
coni.Peiper
coni. Peiper
315
l. 2
confessées
confessés
334
l. 1
narrratives
narratives
Volumes SC connexes
-
SC 137

Hymnes sur le Paradis
mars 1968
Du Paradis perdu au Paradis futur, une boussole poétique, par le plus grand écrivain syriaque.
-
SC 437

Centons homériques
septembre 1998
Homère racontant l'histoire du Christ ? Le caprice littéraire d'une impératrice au 5e siècle.
-
SC 78
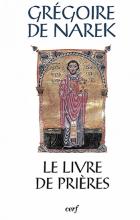
Le Livre de prières
décembre 1961
Le plus grand poète arménien, au 10e siècle, proclamé « Docteur de l'Église » en 2015.
-
SC 149

La Passion du Christ
décembre 1969
Une tragédie chrétienne, inspirée d'Euripide !
-
SC 203

Jésus, Fils unique du Père
décembre 1973
Au 12e siècle, un évêque et poète arménien dialogue avec le Christ.
-
SC 209
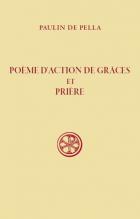
Poème d'action de grâces et Prière
décembre 1974
Une autobiographie poétique en forme d'action de grâces, par un écrivain latin du 5e siècle.
-
SC 99
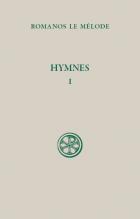
Hymnes, tome I
décembre 1964
Depuis Adam et Ève jusqu'à la Résurrection, les hymnes du grand poète grec du 6e siècle.
-
SC 110
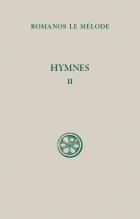
Hymnes, tome II
décembre 1965
Depuis Adam et Ève jusqu'à la Résurrection, les hymnes du grand poète grec du 6e siècle.
-
SC 114
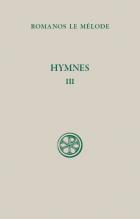
Hymnes, tome III
décembre 1965
Depuis Adam et Ève jusqu'à la Résurrection, les hymnes du grand poète grec du 6e siècle.
-
SC 128
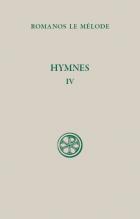
Hymnes, tome IV
décembre 1967
Depuis Adam et Ève jusqu'à la Résurrection, les hymnes du grand poète grec du 6e siècle.
-
SC 283

Hymnes, tome V
août 1981
Depuis Adam et Ève jusqu'à la Résurrection, les hymnes du grand poète grec du 6e siècle.
-
SC 156

Hymnes, tome I
décembre 1969
À Constantinople, vers l'an mil, tout le lyrisme d'un saint qui se sait pécheur.
-
SC 174
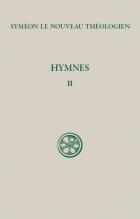
Hymnes, tome II
décembre 1971
À Constantinople, vers l'an mil, tout le lyrisme d'un saint qui se sait pécheur.
-
SC 196
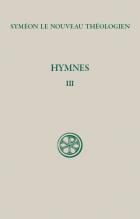
Hymnes, tome III
décembre 1973
À Constantinople, vers l'an mil, tout le lyrisme d'un saint qui se sait pécheur.
Du même auteur
-
SC 546

Éloge consolatoire de la chasteté
décembre 2011
Une épopée biblique en vers, dont le Christ est le héros, par un évêque et poète latin, au tournant des 5e et 6e siècles.
-
SC 492
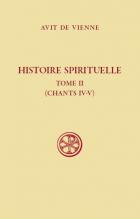
Histoire spirituelle, tome II
avril 2005
Une épopée biblique en vers, dont le Christ est le héros, par un évêque et poète latin, au tournant des 5e et 6e siècles.