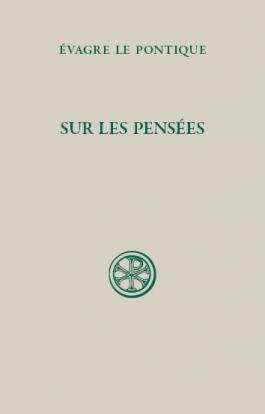-
SC 438
Évagre le Pontique
Sur les pensées
novembre 1998Introduction, texte critique, traduction, notes et index par Paul Géhin, Claire et Antoine Guillaumont.
Ouvrage publié avec le concours de l'Œuvre d'Orient.ISBN : 9782204060813349 pagesL'âme humaine, théâtre de bataille et enjeu d'un intense combat spirituel, éclairé par un maître spirituel à la fin du 4e siècle.Présentation
Le traité Sur les pensées est probablement celui où Évagre montre le mieux son talent pour l’analyse psychologique. Tout en se fondant sur son expérience personnelle dans le milieu monastique égyptien où il vécut à la fin du IVe siècle, Évagre utilise les ressources de sa profonde culture philosophique, principalement aristotélicienne et stoïcienne. Ces « pensées », inspirées par les démons selon la tradition du désert, utilisent les représentations sensorielles qui entretiennent dans l’esprit les obsessions du jour et les images des rêves nocturnes. Cette analyse, très fine, est faite avec une intention thérapeutique. Le moine, déjà engagé dans la vie gnostique et instruit de la façon dont les « pensées » apparaissent, se succèdent, parfois se chassent les unes les autres, saura triompher d’elles et ainsi progresser dans l’impassibilité. Avec l’aide des « pensées » angéliques et le secours du Christ « médecin des âmes », il s’élèvera dans la contemplation jusqu’à la vision de la lumière divine, dans la prière pure.
L’édition de ce traité, fondée sur une étude intégrale de la tradition manuscrite, le donne, pour la première fois, sous sa forme complète. L’attribution à Évagre, jadis contestée, est désormais fermement établie.Paul Géhin, longtemps responsable de la Section grecque de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (Paris), a déjà publié dans la collection Sources Chrétiennes plusieurs œuvres exégétiques d’Évagre (SC 340, 397, 514 et 589).
Antoine Guillaumont (1915-2000), professeur au Collège de France et membre de l’Institut, et son épouse Claire Guillaumont (1916-2005), historiens du christianisme oriental ancien, ont publié plusieurs autres volumes d’Évagre dans la collection (SC 170-171 et 356).Le mot des Sources Chrétiennes
Ce traité Sur les pensées d'Évagre le Pontique s'inscrit dans le prolongement de ses deux autres traités, déjà publiés dans la Collection, le Traité pratique (SC 170 et 171) et Le Gnostique (SC 356), et représente pour ainsi dire une étape ultime dans la progression spirituelle du moine. La brève mais dense introduction doctrinale d'Antoine Guillaumont, Professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Institut, spécialiste reconnu d'Évagre et du monachisme égyptien, retrace les grandes étapes de cet itinéraire spirituel : celui qui, par la « pratique », est parvenu à l'impassibilité, puis a eu accès à la science spirituelle ou « gnose », tend désormais « à s'élever, à travers les différents degrés de la contemplation, jusqu'à la 'prière pure' et la vision de la lumière divine ». Le traité d'Évagre a donc pour sujet les pensées et, pour l'essentiel, les mauvaises pensées qu'inspirent au moine les démons pour freiner sa progression spirituelle et l'empêcher de parvenir à la prière pure. Les attaques démoniaques sont multiples, mais n'ont pas toutes la même emprise sur le gnostique : les démons de la gourmandise ou de la fornication, qui agissent sur la partie concupiscible de l'homme, ne sont plus pour lui les plus redoutables, et, même s'il a encore à lutter plus difficilement contre les tentations qui mettent en branle la partie irascible de son âme, il lui faut principalement mener le combat contre les démons qui harcèlent son intellect, celui de la vaine gloire et de l'orgueil en particulier. Ceux-là surtout cherchent à empêcher ses progrès sur la voie de la contemplation. La finesse des analyses psychologiques d'Évagre et des conseils qu'il donne au moine procède naturellement de son expérience personnelle de la vie monastique, menée aux Kellia, mais s'enracine aussi dans une culture fortement imprégnée de stoïcisme et d'aristotélisme.
Longtemps édité sous le nom de Nil d'Ancyre, le traité Sur les pensées est aujourd'hui définitivement restitué à Évagre. L'étude de l'ensemble de sa tradition manuscrite, effectuée pour la première fois en vue de la présente édition, par Paul Géhin, Chargé de recherche au CNRS et par Claire Guillaumont, apporte une preuve indiscutable de cette authenticité évagrienne, que confirme encore la critique interne. De fait, l'annotation du traité, qui, au même titre que sa traduction, est l'œuvre commune des trois éditeurs, indique de nombreux parallèles avec d'autres écrits du même auteur.
Naturellement, la lecture de cet ouvrage n'est pas réservée aux moines et aux moniales ! Chacun peut y trouver, au-delà de l'intérêt qu'il peut porter à l'histoire du monachisme, à l'étude psychologique (ou psychanalytique) et à l'histoire des mentalités, un instrument de connaissance de soi et un aliment pour sa propre vie spirituelle.Jean-Noël Guinot
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Les « pensées » (logismoi) sont les grandes ennemies du moine, car elles viennent sans cesse le distraire de sa contemplation pour l’entraîner vers le sensible et lui donner des tentations. Ce traité, longtemps attribué à Nil d’Ancyre et aujourd’hui restitué à Évagre avec certitude, s’adresse à ceux qui accèdent à l’impassibilité et à la « gnose » après avoir franchi l’étape de la « pratique » (donc, le même public que le traité du Gnostique, SC 356). Il réfléchit, à partir des longues années d’expérience d’Évagre au désert, sur la nature et l’origine de ces pensées, ainsi que sur les moyens de lutter contre elles. Il le fait au fil des 43 kephalaia qui le constituent, dans un certain désordre apparent qui n’empêche pas sa doctrine d’être très cohérente.
Nous avons, pour une fois, l’intégralité du texte grec du traité, mais sa tradition manuscrite est complexe (81 manuscrits grecs, plus une vingtaine pour les versions syriaque et arabe). On y rencontre plusieurs principes de classement qui ne se recoupent pas complètement : attribution à Évagre ou à Nil, recension longue, courte ou hybride, titre, découpage en chapitres… Certains manuscrits ne donnent que la première partie (kephalaia 1 à 22), d’autres proposent des extraits, d’autres ont diverses lacunes ou répétitions. Les versions orientales épousent en partie cette diversité (le syriaque ne connaissant que la recension courte).
Les pensées qui nous détournent de Dieu nous viennent du monde sensible, soit directement, soit par l’intermédiaire de notre mémoire qui nous en ramène l’image. La progression du gnostique nécessite l’éradication progressive des passions, particulièrement le désir, la colère et l’insouciance ; mais pour celui qui atteint un premier stade d’impassibilité, la vaine gloire est un danger tout spécial. Nous pouvons aussi faire lutter entre elles nos pensées, chassant les mauvaises par les bonnes. Le traité met en lumière les différents démons qui provoquent en nous ces pensées (insensibilité spirituelle, tristesse, fornication…), fait connaître leurs pratiques et leurs ruses habituelles, rappelle qu’il faut les haïr pour acquérir les vertus opposées, donne les moyens de lutter contre eux. Ils peuvent s’attaquer au corps ou directement à l’âme, mais le combat pour les repousser passe toujours par le corps car ce sont d’abord les appétits corporels (gourmandise, sexe) qui créent en nous la faiblesse où les maladies de l’âme écloront. Les démons s’attaquent à nous dans un certain ordre, une passion en entraînant une autre. Sont analysés le rôle des représentations, des rêves, et celui, essentiel, du discernement. à part le premier et le dernier, la succession des 43 chapitres ne semble manifester aucune logique, ce qui rend difficile un résumé ordonné.
Extrait(s)
Pensées 8 (SC 438, p. 177-179) : trois sortes de pensées, angéliques, humaines et démoniaques
Après une longue observation, nous avons appris connaître la différence qu’il y a entre les pensées angéliques, les pensées humaines et celles qui viennent des démons : Celles des anges, pour commencer, scrutent la nature des choses et en poursuivent les raisons spirituelles. Par exemple : dans quel but l’or a été créé, pourquoi il est sablonneux et disséminé dans les profondeurs de la terre et pourquoi il n’est découvert qu’avec beaucoup d’effort et de peine ; et comment, une fois découvert, il est lavé à l’eau, livré au feu, et ainsi remis aux mains des artisans qui font le chandelier de la Tente, le brûle-parfum, les encensoirs, et les coupes dans lesquelles, par la grâce de notre Sauveur, ce n’est plus le roi de Babylone qui boit désormais, mais Cléophas, lequel emporte un cœur brûlant de ces mystères. La pensée démoniaque, elle, ne sait ni ne connaît cela, mais elle suggère sans aucune honte la seule acquisition de l’or sensible et prédit la jouissance et la gloire qui en résulteront. Quant à la pensée humaine, elle ne vise pas plus l’acquisition qu’elle ne scrute le symbolisme de l’or, mais elle introduit seulement dans l’esprit la forme simple de l’or, en dehors de toute passion de cupidité. On tiendra le même discours aussi à propos des autres objets, en s’exerçant mentalement selon cette règle.
Pensées 9 (SC 438, p. 181-183)
Il y a un démon qu’on appelle « vagabond » et qui s’approche des frères surtout aux alentours de l’aurore ; il promène l’intellect de ville en ville, de village en village, de maison en maison ; celui-ci n’y fait soi-disant que de simples rencontres, puis il tombe sur des connaissances, bavarde plus longuement, et voilà qu’il ruine, au contact de ceux qu’il rencontre, son propre état et qu’il s’éloigne ostensiblement de la science de Dieu et de la vertu, oubliant jusqu’à sa profession <monastique>. Il faut donc que l’anachorète observe ce démon : d’où il part et où il aboutit, car ce n’est nullement au hasard ni à l’aventure qu’il accomplit ce long circuit, mais c’est avec l’intention de ruiner l’état de l’anachorète qu’il agit ainsi, pour que l’intellect, enflammé par tout cela et grisé par ces multiples rencontres, tombe aussitôt sur le démon de la fornication, ou sur celui de la colère, ou sur celui de la tristesse, qui plus que tout gâtent la clarté de son éclat.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
42
l. 2 en partant de la fin
S. Ephrem
S. Éphrem
126
l. 7
atteste de l’existence
atteste l’existence
152
Référence biblique
Plutôt Luc, 4, 1-13
Volumes SC connexes
-
SC 400

Vie d'Antoine
octobre 2004
L’acte de naissance de la vie monastique et la source de toutes les aspirations au désert.
-
SC 42 bis
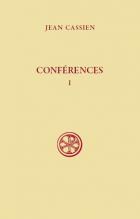
Conférences, tome I
décembre 1966
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 54

Conférences, tome II
décembre 1958
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 64

Conférences, tome III
décembre 1959
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des entretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).
-
SC 109
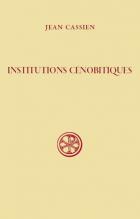
Institutions cénobitiques
décembre 1965
Règles, difficultés, anecdotes et expériences de la vie monastique, au début du 5e siècle.
-
SC 92

Œuvres spirituelles
décembre 1963
Au 6e siècle, toute la sagesse du désert dans la bouche d'un moine de Palestine.
-
SC 387
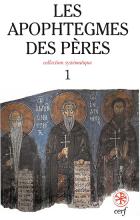
Les Apophtegmes des Pères, tome I
mars 1993
Vie radicale et humour décapant : ces paroles et histoires édifiantes des ermites d’Égypte font fleurir le désert.
Du même auteur
-
SC 615

Scholies aux Psaumes, tome II (Psaumes 71-150)
mai 2021
Les Psaumes lus par le « philosophe du désert », dans la première édition intégrale des Scholies
-
SC 614
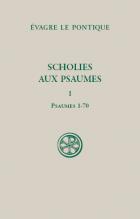
Scholies aux Psaumes, tome I (Psaumes 1-70)
mai 2021
Les Psaumes lus par le « philosophe du désert », dans la première édition intégrale des Scholies
-
SC 591

À Euloge
décembre 2017
Le combat contre les vices, par le « philisophe du désert »
-
SC 589

Chapitres sur la prière
octobre 2017
153 chapitres, autant de « poissons » spirituels à déguster.
-
SC 514

Chapitres des disciples d'Évagre
août 2007
L'ascèse de l'esprit, ou le développement d'un enseignement spirituel, au début du 5e siècle.
-
SC 397

Scholies à l'Ecclésiaste
décembre 1993
Petites notes spirituelles sur la vie en Christ, véritable « Ecclésiaste », par le « philosophe du désert ».
-
SC 356

Le Gnostique
mai 1989
Comment connaître Dieu ? La fine pointe de l'enseignement d'un maître spirituel à la fin du 4e siècle.
-
SC 340

Scholies aux Proverbes
décembre 1987
Petites notes spirituelles sur le commencement de la sagesse, par le « philosophe du désert ».
-
SC 171
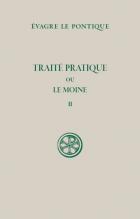
Traité pratique ou Le Moine, tome II
décembre 1971
Acquérir l'impassibilité, première étape vers la connaissance de Dieu, par un maître spirituel à la fin du 4e siècle.
-
SC 170
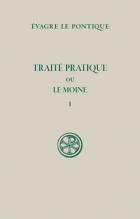
Traité pratique ou Le Moine, tome I
décembre 1971
Acquérir l'impassibilité, première étape vers la connaissance de Dieu, par un maître spirituel à la fin du 4e siècle.