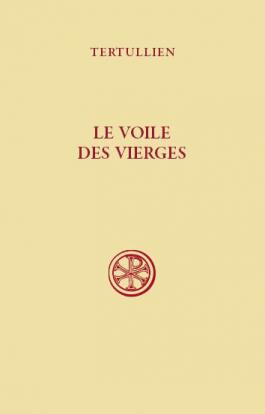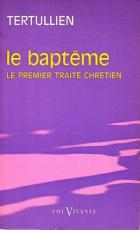-
SC 424
Tertullien
Le Voile des vierges
septembre 1997Introduction et commentaire par Eva Schulz-Flügel adaptés par Paul Mattei. — Texte critique par Eva Schulz-Flügel. — Traduction par Paul Mattei.
ISBN : 9782204057615288 pagesVoilées, les femmes chrétiennes, pendant la liturgie ? Le Carthaginois devenu schismatique expose son avis.
Présentation
Dès l’Antiquité, le De uirginibus uelandis a prêté à contresens. En réalité, il s’agissait pour Tertullien d’obtenir que toutes les vierges, à l’instar des femmes mariées, gardent humblement le voile au cours des liturgies. Par « vierges », il entendait, en plus des filles nubiles, celles, de tout âge, qui avaient par vœu privé (il n’existait pas alors de vœu public) fait profession de virginité.
L’objet paraît mince. Or déjà, quelques années plus tôt, dans le De oratione, l’Africain avait formulé la même exigence. Il y était ensuite revenu dans un traité spécial en grec (perdu). Pourquoi récidiver encore ? C’est que, passé au montanisme, il voyait là une occasion de défendre l’orthodoxie du cercle intransigeant auquel il s’était agrégé ; d’ailleurs, parmi les vierges, à Carthage, le conflit s’aigrissait entre les adeptes du voile et les tenantes de la « liberté », celles-ci alléguant l’usage local.
L’opuscule, du coup, révèle une portée plus vaste. L’auteur s’interroge sur la coutume comme source législative et l’oppose au Christ, « qui est la vérité », norme donnée dès le commencement mais dont l’histoire du salut, par paliers, des patriarches aux prophètes montanistes, affermit l’évidence. Il précise ses idées sur la place des femmes ascètes dans l’Église, témoignant ainsi du développement institutionnel que connaissait alors la virginité consacrée, mais attestant aussi, implicitement, combien ses propres choix éthiques et ecclésiologiques juraient avec ce développement.
Autant que des quiproquos sur l’objet du traité, on se méfiera donc des anachronismes et des jugements hâtifs quant à son esprit. L’actualité a rendu nos contemporains sensibles à toutes évocation du voile religieux – à toute velléité de régenter le costume féminin. Au vrai, Tertullien fut un rigoriste qui ne réservait pas l’austérité aux seules « filles d’Ève » ; il fut plus encore, peut-être, un « charismatique » archaïsant à qui répugnait que le propos de sainteté se trouvât en quelque façon confisqué par un groupe trop clairement identifié dans le corps ecclésial.Eva Schulz-Flügel est actuellement chercheur au Vetus Latina Institut (Beuron). Paul Mattei est Professeur à l’Université Stendhal-Grenoble III ; il a déjà publié à Sources Chrétiennes Le mariage unique (De monogamia) de Tertullien (SC 343).
Le mot des Sources Chrétiennes
L'édition de ce traité est le résultat d'une collaboration franco-allemande. Le texte critique, l'introduction générale et le commentaire sont l'œuvre d'Eva Schulz-Flügel, chercheur au Vetus latina Institut de Beuron, avec la collaboration de Paul Mattei, qui a fourni également la traduction française du texte latin ; on lui doit déjà de Tertullien l'édition du traité Le Mariage unique (SC 343).
Le sujet abordé ici, à partir d'un problème somme toute assez mince – une question vestimentaire –, est celui de savoir si la coutume a ou non valeur normative, si elle doit prévaloir sur la « vérité » qui est l'autre nom du Christ. Tel est en définitive ce qui donne de l'épaisseur à cet opuscule et en fait l'intérêt. Il y eut donc, dans la communauté chrétienne de Carthage, au début du IIIe siècle – le traité paraît postérieur à 213 –, une « affaire du voile » religieux, avec ce qu'un tel sujet comporte de réactions passionnées et de parti pris. Mais gardons-nous de tout anachronisme ! Il s'agissait de savoir si, à l'Église, au cours des liturgies, les « vierges » devaient continuer à paraître tête nue et signaler ainsi à l'assistance leur état, autrement dit si cet état les autorisait à prétendre à des honneurs et à un rang particuliers ou si elles devaient au contraire, comme les femmes mariées, se couvrir humblement la tête. Tertullien milite pour sa part en faveur du port du voile. Ce point de vue lui est sans doute moins dicté par son rigorisme que par son adhésion au montanisme : contre les femmes ascètes, qui veulent imposer à toutes les vierges un comportement qui les distingue des autres femmes et les signalent comme les « servantes exclusives du Christ », Tertullien rappelle que « l'Église est une réalité spirituelle au sein de laquelle rangs et fonctions ne donnent droit à aucun privilège », où la virginité est une grâce et non un mérite ; il prône le retour « aux forces charismatiques et enthousiastes des chrétientés originelles, contre l'évolution qui tendait à établir une Église où l'institution primerait ». Plus tard, en effet, le voile deviendra le signe distinctif des vierges consacrées. À l'époque de Tertullien, cette évolution ne fait que s'amorcer, et la réflexion de l'auteur sur le sujet est de ce fait un témoignage de premier ordre. Signalons encore dans la riche Introduction de ce volume un chapitre consacré à « l'ascèse féminine des origines à Augustin » et un autre à « la coutume du port du voile », dont Tertullien atteste qu'elle est en Arabie bien antérieure à l'Islam...
Jean-Noël Guinot
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
De uirginibus uelandis
Le traité pose d’abord la question du sens à donner à uirgo : s’agit-il de femmes vouées à l’ascétisme ou simplement de jeunes filles et de femmes célibataires ? Il est vrai que, progressivement, le voile deviendra la caractéristique des femmes ascètes, mais, à l’époque de Tertullien, les uirgines Dei désigneraient des femmes continentes dans le cadre familial, sans qu’aient existé des vœux solennels et une consécration. Tertullien procède à l’exégèse de 1 Co 11, 5 s., et s’adresserait de ce fait à toutes les femmes, mariées ou non, afin qu’elles portent le voile. Le voile est celui des matrones romaines, couvrant les cheveux, mais pas le visage. Les femmes juives portaient elles aussi un voile, mais un peu différent. Il était donc l’indice que la femme était mariée, et en même temps révélateur de son statut de subordination par rapport à l’homme. En disparaissant dans les usages, le voile a pu devenir le signe de l’ascétisme.
La question du port du voile par les jeunes filles semble s’appliquer dans le contexte de la prière. En effet, certaines femmes ascètes revendiquaient d’aller tête nue, tandis que d’autres se voilaient. Tertullien demande que, dans la communauté carthaginoise, les femmes ascètes ne bénéficient d’aucun privilège et s’astreignent à porter le voile. Cette question doit être replacée dans le contexte d’un ascétisme qui n’a pas encore de place déterminée au sein de la communauté.
On trouve dans le traité une défense explicite du montanisme, et le débat sur le voile apparaît dans le traité comme un prétexte à cette apologie. La reconnaissance d’un statut particulier des femmes ascètes au sein de l’Église se heurte aux conceptions montanistes. La continence, étant une grâce et non un mérite, ne doit pas se distinguer par un rang particulier au sein de l’Église. Outre l’insistance sur le Paraclet, avec la croyance en l’action continue de l’Esprit, la foi montaniste considère que tous, même laïcs, sont appelés à la sainteté.
Le traité est donc à situer parmi les œuvres tardives, après le De anima et juste avant le De monogamia, à un moment où la scission entre la Grande Église et la Nouvelle Prophétie a déjà eu lieu. Les montanistes croient que la création divine s’est éloignée avec l’homme de l’état originel, de la ueritas. La chute est imputée non au diable, mais à l’homme, qui perd sa similitudo avec Dieu. Dans le rétablissement de la perfection, le Christ est central, puisqu’il est la vérité et l’exemplum fixant les normes de conduite pour les hommes. Le Paraclet, qui vient après le Christ, fait adopter ces normes parmi les chrétiens et conduit à la perfection, visant à la restitution de l’état paradisiaque. L’engagement dans la virginité participe donc, pour Tertullien, de cette eschatologie selon laquelle l’homme se rend digne du salut.
La Grande Église de Carthage lui opposant la consuetudo, Tertullien précise que celle-ci doit pouvoir se réclamer de la traditio et d’une longue durée. Les coutumes contradictoires sont un péril pour l’Église, auquel Tertullien préfère opposer l’interprétation de l’Écriture, à condition que cette interprétation soit la plus véridique possible.
Extrait(s)
XV, 1. « Mais la virginité vraie, totale et sans mélange, ne redoute rien plus qu’elle-même. Elle ne souffre même pas les regards des femmes, et ses propres regards lui sont étrangers. Elle se réfugie sous le voile comme sous un casque, comme derrière un bouclier qui lui défend son bien contre les coups des tentations, contre les traits des scandales, contre les soupçons, les murmures, la jalousie, même contre l’envie. 2. Car il existe quelque chose que craignent même les païens : on l’appelle le mauvais œil, résultat néfaste de l’éloge et de la gloire exagérés. Ce mauvais œil, nous l’expliquons parfois par le diable, car le diable déteste le bien. Parfois, nous l’imputons à Dieu, car Dieu juge l’orgueil, lui qui élève les humbles et abaisse les fiers (cf. Ps 146, 6 ; Lc 1, 52 ; 18, 14). 3. Une vierge à la sainteté assurée redoutera donc, au moins, sous le nom de mauvais œil, d’un côté l’adversaire et de l’autre Dieu, la pâle envie du premier, l’éclat vengeur du second ; et elle se réjouira d’être connue d’elle seule et de Dieu. Mais même si quelqu’un d’autre est au courant, elle sera bien inspirée de barrer la route aux tentations. 4. Qui en effet osera importuner de ses regards un visage fermé, un visage qui n’exprime aucun sentiment, pour ainsi dire un visage en deuil. Toute mauvaise pensée se brisera sur cette sévérité. La vierge qui tait ce qu’elle est nie même désormais être femme. » (p. 177-179)
XVII. 1. (1.) Mais je vous exhorte aussi, vous qui avez choisi la seconde chasteté, qui êtes engagées dans le mariage, ne vous relâchez point, fût-ce un instant, de la règle du voile, ne ruinez pas d’autre façon une discipline qu’il vous est impossible de rejeter, en allant ni couvertes ni découvertes. 2. Car certaines, avec leurs petits bonnets et leurs bandeaux, ne se voilent pas la tête ; elles la ficellent, pour le front bien couvertes, mais pour la tête à proprement parler toutes nues. D’autres sans excès – pour ne pas se charger la tête, je crois – avec leurs petits fichus, et qui n’arrivent pas même aux oreilles, se couvrent le crâne. (2.) Je les plains d’avoir l’ouïe si faible qu’elles ne puissent entendre à travers un tissu. 3. Qu’elles sachent que tout est féminin dans une tête de femme ; que la tête, c’est ce qui s’étend jusqu’aux bords, aux confins du vêtement ; tout ce que les cheveux dénoués peuvent recouvrir, voilà le domaine du voile, de façon qu’il enveloppe aussi la nuque. C’est la nuque en effet qui doit être soumise, elle à cause de qui la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion. Le voile est son joug. 4. Les païennes d’Arabie nous jugeront, qui en plus de la tête se couvrent le visage entier, contentes ainsi de jouir, par le seul œil laissé libre, d’une moitié de lumière, plutôt que de livrer à tous leurs visages entiers : (3.) la femme aime mieux voir qu’être vue. 5. Et c’est pourquoi telle reine romaine les déclare bien malheureuses, au motif qu’elles peuvent mieux éprouver de l’amour qu’en inspirer. Heureuses plutôt, en ceci au moins qu’elles échappent à l’autre bonheur, assurément plus courant, les femmes ayant plus de facilité à inspirer de l’amour qu’à en éprouver. 6. À coup sûr, la réserve que montre la discipline païenne est plus fruste et, pour ainsi dire, plus barbare. Nous, le Seigneur, par des révélations, nous a mesuré jusqu’à la taille du voile.(p. 181-183)
Errata
Page Localisation Texte concerné Correction Remarques 133 l. 2 feuille feuilles 175 l. 14 elle tirent elles tirent 175 l. 15 aux regard aux regards
Volumes SC connexes
-
SC 76

La Vie de recluse. La prière pastorale
décembre 1961
Le questionnement du jeune Jésus au Temple : un modèle à méditer pour ce moine anglais du 12e siècle.
-
SC 119
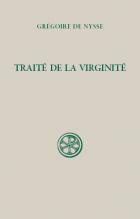
Traité de la Virginité
décembre 1966
Sens et valeur d'une voie privilégiée vers Dieu, vue par un homme marié.
-
SC 125

La Virginité
décembre 1966
Le mariage, c'est bien, la virginité, c'est mieux : Jean Chrysostome s'explique.
-
SC 95

Le Banquet
décembre 1963
Le Banquet de Platon célébrait l'amour ? Celui de Méthode célèbre la virginité !
Du même auteur
-
SC 638
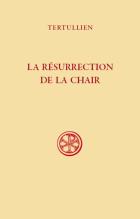
La résurrection de la chair
novembre 2023
«La chair, pivot du salut» : renversant plaidoyer du Carthaginois
-
SC 601
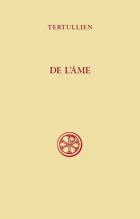
De l'âme
novembre 2019
L'âme, les rêves, le sexe, l'embryon, la mort : Tertullien lance le débat chez les chrétiens (vers 210).
-
SC 513
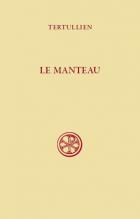
Le Manteau
septembre 2007
Pourquoi porter le manteau du philosophe plutôt que la toge romaine ? Un signe personnel très fort pour le Carthaginois.
-
SC 483
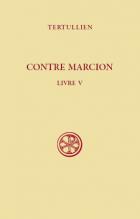
Contre Marcion, tome V
juillet 2004
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 456
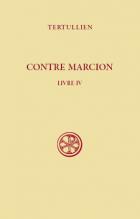
Contre Marcion, tome IV
février 2001
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 439

Contre Hermogène
mars 1999
La matière est-elle éternelle ? Et d'où vient le mal ? Tertullien tord le cou aux idées fausses.
-
SC 399
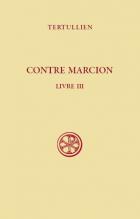
Contre Marcion, tome III
juin 1994
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 395

La Pudicité, tome II
décembre 1993
L'Église peut-elle remettre les péchés ? Le Carthaginois, devenu schismatique, en doute.
-
SC 394

La Pudicité, tome I
décembre 1993
L'Église peut-elle remettre les péchés ? Le Carthaginois, devenu schismatique, en doute.
-
SC 368
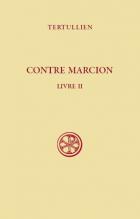
Contre Marcion, tome II
mars 1991
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 365
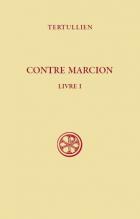
Contre Marcion, tome I
décembre 1990
Un Dieu méchant, dans l'Ancien Testament, opposé à un Dieu bon révélé par Jésus ? Réfutation en règle par le pugnace Carthaginois.
-
SC 343

Le Mariage unique
juin 1988
Doit-on ou peut-on se remarier ? Le Carthaginois répond, selon la mentalité de son temps.
-
SC 332
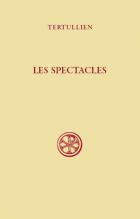
Les Spectacles
octobre 1986
Violence, pornographie, inepties : pour le Carthaginois, les spectacles sont incompatibles avec la vie chrétienne.
-
SC 319
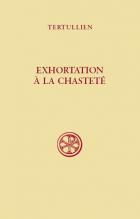
Exhortation à la chasteté
juin 1985
Chasteté et continence : dans un débat pastoral incessant, la position rigoriste du Carthaginois.
-
SC 316
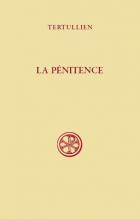
La Pénitence
novembre 1984
Quelle pénitence, avant et après le baptême ? L'éclairage du théologien carthaginois.
-
SC 310
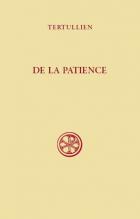
De la patience
février 1984
La patience, un trait proprement divin : la réflexion du grand théologien carthaginois.
-
SC 281
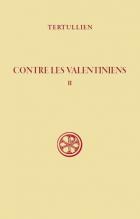
Contre les Valentiniens, tome II
janvier 1981
Des révélations secrètes sur Dieu ? Exposé et réfutation de la « gnose » par le pugnace Carthaginois.
-
SC 280

Contre les Valentiniens, tome I
janvier 1981
Des révélations secrètes sur Dieu ? Exposé et réfutation de la « gnose » par le pugnace Carthaginois.
-
SC 273

À son épouse
janvier 1980
« Deux en une seule chair » : la lettre d’un chrétien d’Afrique à sa femme, et un idéal du mariage.
-
SC 217
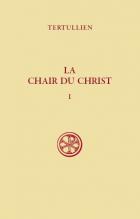
La chair du Christ, tome II
septembre 1976
Pas vraiment incarné, le Christ ? Magistrale réponse du théologien carthaginois.
-
SC 216
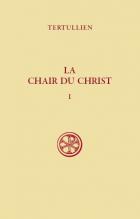
La chair du Christ, tome I
décembre 1975
Pas vraiment incarné, le Christ ? Magistrale réponse du théologien carthaginois.
-
SC 173
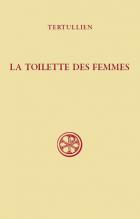
La Toilette des femmes
décembre 1971
La coquetterie a-t-elle sa place dans l'Église ? Une harangue du Carthaginois.
-
SC 46
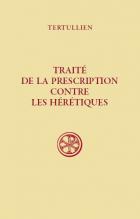
Traité de la prescription contre les hérétiques
juin 1957
Qui a le droit de citer les Écritures ? L'avis du premier théologien latin.
-
SC 35
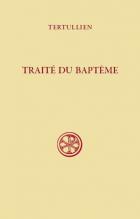
Traité du baptême
décembre 1952
Pas nécessaire, le baptême ? Magistrale réponse du théologien carthaginois.
-