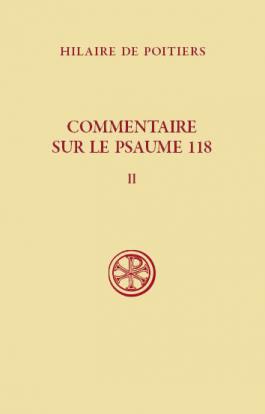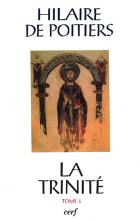-
SC 347
Hilaire de Poitiers
Commentaire sur le Psaume 118, tome II
Lettre 9. Teth – Lettre 22. Taunovembre 1988Texte critique, traduction, notes et index par Marc Milhau.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.ISBN : 9782204030526331 pages« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.Présentation
Ce volume poursuit et achève l’édition du Commentaire d’Hilaire de Poitiers sur le psaume 118. Le tome I offre une introduction à l’œuvre et l’exégèse des huit premières strophes de ce psaume acrostiche, bâti sur l’alphabet hébreu : de Aleph à Heth. Le tome II contient les strophes 9 à 22 – Teth à Tau –, et les index l’index scripturaire habituel, et un index analytique qui rendra de grands services.
Le commentaire de la neuvième strophe, qui ouvre le volume, débute ainsi :« Déjà, dans l'argument du psaume, nous avons rappelé qu'il ne contenait rien d'autre qu'un enseignement de vie pour l'homme, destiné à nous former, comme des tout-petits, par les lettres mêmes de l'alphabet, à la connaissance de Dieu. »
Il n'est pas de meilleure manière de recommander non seulement le texte biblique, mais la méditation que l'évêque de Poitiers en propose.
Le mot des Sources Chrétiennes
Hilaire de Poitiers a commenté, après son retour d'exil, le Psautier, du moins en partie. Il avait mis à profit son séjour forcé en Orient pour améliorer sa compétence exégétique ; il y avait fréquenté la Septante et travaillé Origène. Il s'attache avec prédilection au psaume 118, « psaume très long et de beaucoup le plus riche de tous ». Il nous donne ainsi le premier commentaire exhaustif en latin de ces 176 versets répartis selon les 22 lettres de l'alphabet hébreu.
Marc Milhau, agrégé des Lettres, a établi et traduit le texte, l'introduisant et t'annotant de façon précise, avec une brièveté de bon aloi. Le tome I (n° 344) correspondait aux 8 premières strophes, d'Aleph à Heth. Ce tome II contient le commentaire des 14 dernières strophes (Teth à Tau) et les index usuels.Dominique Bertrand
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Hilaire rédigea ses Commentaires sur les Psaumes à la fin de sa vie, entre 364 et 367. Alors que des commentaires du psautier existaient déjà en grec, l’œuvre d’Hilaire est, avec celle d’Eusèbe de Verceil (dont cette partie de l’œuvre est perdue), la première entreprise de ce genre en latin. Le Commentaire sur le Psaume 118 est le plus développé des cinquante-huit commentaires d’Hilaire qui nous sont parvenus.
La présente édition repose sur dix manuscrits, dont les plus anciens, Vérone, Bibl. Cap. XIII (11) et Lyon, Bm 452, à compléter avec Paris, BnF, nouv. acq. lat. 1593, remontent au ve siècle. Bien qu’indépendants l’un de l’autre, ils ont été copiés sur un ancêtre commun. Deux manuscrits du ixe siècle ont moins de points communs entre eux que les manuscrits du ve siècle, mais ils dépendent aussi probablement d’un ancêtre commun. Certains des manuscrits plus tardifs (xie-xiiie siècles) dépendent des manuscrits antérieurs ; d’autres rapportent des leçons anciennes et indépendantes, spécialement Charleville, Bm 239, qui n’avait pas été utilisé par les éditeurs précédents.
Pour ce qui est de la tradition indirecte, le texte est cité par Augustin, Cassiodore et Hincmar, ainsi que dans quelques homéliaires.
La structure alphabétique du psaume commande celle du commentaire, réparti en vingt-deux sections selon le nombre des lettres de l’alphabet hébreu (Hilaire ne les désigne jamais autrement que par leur numéro d’ordre). L’ensemble est précédé d’un exorde général. Cette structure est probablement inspirée d’Origène, dont Hilaire reprend également le sens général donné au psaume : seule une vie morale irréprochable peut permettre à l’homme d’atteindre la perfection et lui donner accès à une connaissance parfaite.
Le commentaire des huit versets placés sous chacune des vingt-deux lettres est ordinairement précédé d’un préambule, plus ou moins long selon les cas. Celui-ci introduit des considérations générales qui orientent ensuite le commentaire de la strophe. Hilaire introduit le plus souvent les versets qu’il commente, cherchant à établir un enchaînement entre les versets : pour lui, ordo et ratio sont liés, car « un raisonnement parfait respecte un ordre » (6, 3). De fait, pour Hilaire, le texte biblique est parfait. Cette perfection s’étend d’abord aux mots, dont le commentateur étudie la valeur (uirtus) et la propriété (proprietas), cherchant le sens le mieux approprié, ainsi qu’aux propositions et à leur ordre. Il met aussi en lumière les difficultés de l’expression, avant de les résoudre en utilisant des éléments tirés d’un savoir profane ou religieux, en recourant au texte grec pour éclairer tel mot latin difficile ou, le plus souvent, en citant d’autres versets de l’Écriture, spécialement du Nouveau Testament. En effet, les psaumes doivent, selon lui, être lus à la lumière de l’Évangile ; il est donc possible de dépasser une interprétation littérale pour les appliquer non plus à David, mais au Christ ou à Paul. Enfin, Hilaire tire de chaque commentaire une instruction pour le lecteur, qu’il cherche à former. Cette instruction réside principalement dans la nature humaine, présentée à partir des œuvres classiques et des épîtres pauliniennes, ainsi que dans la description de l’homme parfait (perfectus uir) que le lecteur est appelé à devenir, abandonnant le vieil homme pour revêtir l’homme nouveau. Dans la formation de cet homme parfait, la connaissance de la vérité (cognitio ueritatis) joue un rôle central.
Les scolies origéniennes au Psaume 118 permettent de préciser le rapport du Poitevin à l’Alexandrin. Hilaire doit à Origène sa méthode de commentaire, ainsi que le sens général du Psaume. Mais, pour les versets où elle est possible, une étude comparative montre qu’Hilaire a fait une lecture sélective de son prédécesseur : il a notamment omis les éléments les plus spéculatifs, les allusions à la philosophie grecque, les passages polémiques ainsi que les distinctions et classifications qui abondent dans le commentaire d’Origène. Mais il fit, le premier, connaître à l’Occident une pensée qui devait encore inspirer (l’on pense spécialement, dans le monde latin, à Ambroise).
Extrait(s)
Hilaire de Poitiers, Commentaire sur le Psaume 118, 20, 1 (SC 347, p. 266-268)
Tout au long du psaume, le prophète nous a proposé beaucoup de grands exemples de la foi qu’il confesse, par lesquels il s’est lui-même donné aux autres comme un modèle de foi, d’action, d’intelligence, d’ignorance, d’espérance et de prière, réalisant pleinement l’homme de l’Évangile par une observance parfaite de la Loi. Bien qu’il fasse, atteste et espère tout ce qui a plu à la volonté de Dieu ou fut proposé à l’espérance humaine, il n’oublie pourtant pas quelle sorte d’observance constitue l’essentiel et la somme de tous les commandements, et il sait ce que son Seigneur demandait à ceux-là mêmes à qui devaient être remises les « clés des cieux », les apôtres. En effet, comme leurs avis et leurs désirs les divisaient et qu’ils s’arrogeaient, chacun pour soi, dans une compétition humaine la première place, chacun voulant ou revendiquant la supériorité sur tous les autres, le Seigneur, montrant où il fallait chercher la récompense donnée par cet avantage et ce titre, dit : Que celui qui veut être le plus grand parmi vous se fasse le plus petit de tous ; car tout homme qui s’abaissera sera élevé et qui s’élèvera sera abaissé (Lc 22, 26 ; Mt 23, 12). Par là, il nous a appris que tous les titres et les récompenses que donne la foi étaient contenus dans l’« humilité ». Aussi est-il très utile pour ceux qui obéissent aux préceptes divins de briser, d’écraser et de réprimer en eux toute la vanité de la prétention et de l’impudence humaines et de se maintenir dans les limites de la retenue que demande l’« humilité », en se rappelant à la fois la magnificence et la miséricorde de Dieu.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
299
§ 3, l. 8
d’un
d’en
331
l. 15
Kaph
Koph
Volumes SC connexes
-
SC 189

Anonyme
La Chaîne palestinienne sur le Psaume 118, tome I
décembre 1972
La plus riche des moissons pour le plus long des Psaumes : un florilège grec qui donne accès à bien des sources perdues.
-
SC 190

Anonyme
La Chaîne palestinienne sur le Psaume 118, tome II. Catalogue des fragments
décembre 1972
La plus riche des moissons pour le plus long des Psaumes : un florilège grec qui donne accès à bien des sources perdues.
Du même auteur
-
SC 625

Commentaires sur les Psaumes, tome V (Psaumes 119-126)
avril 2022
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 621
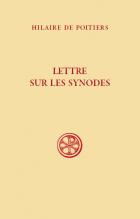
Lettre sur les synodes
janvier 2022
"Consusbstantiel au Père": qu'est-ce que ça veut dire? Hilaire dévoile le "making-of" du credo.
-
SC 605

Commentaires sur les Psaumes, tome IV (Psaumes 67-69 et 91)
décembre 2020
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 603

Commentaires sur les Psaumes. Tome III (Psaumes 62-66)
juin 2019
Le sens des Psaumes 62 à 66 ouvert par Hilaire vers 360 avec une clé divine : le Christ lui-même.
-
SC 565
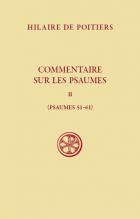
Commentaires sur les Psaumes, tome II (Psaumes 51-61)
juillet 2014
Des cris de souffrance ? Les Psaumes 51 à 61 sont, pour Hilaire, dans la bouche du Ressuscité.
-
SC 515

Commentaires sur les Psaumes, tome I (Psaumes 1-14)
juin 2008
« Heureux l'homme » : un voie spirituelle éclairée au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 462
La Trinité, tome III
octobre 2001
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 448
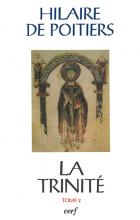
La Trinité, tome II
avril 2000
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 443
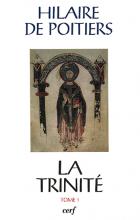
La Trinité, tome I
juin 1999
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 344

Commentaire sur le Psaume 118, tome I
mai 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 334
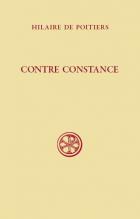
Contre Constance
février 1987
Un empereur veut imposer à l'Église une foi hérétique ? Une charge au vitriol par un évêque persécuté.
-
SC 258
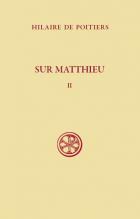
Sur Matthieu, tome II
mai 1979
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 254
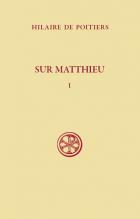
Sur Matthieu, tome I
décembre 1978
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 19 bis
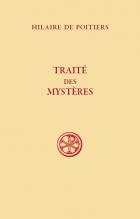
Traité des mystères
décembre 1967
Une clé de lecture de l’Ancien Testament, miroir de figures annonçant le Christ.