-
SC 335
Lactance
Épitomé des Institutions divines
juillet 1987Introduction, texte critique, traduction, notes et index par Michel Perrin.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres.ISBN : 9782204028134299 pagesL'abrégé de la grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.Présentation
Une fois prouvée l’authenticité de cet ouvrage, il devient fort instructif de voir un auteur de l’Antiquité résumer une de ses œuvres antérieures. De fait, L’Épitomé est un abrégé en soixante-huit paragraphes des sept livres des Institutions divines (en cours de publication aux Sources Chrétiennes).
Outre cette concision, est intéressant ce qui l'a rendue possible. Lactance – qui fut jugé digne d'être choisi comme précepteur pour l'un des fils de Constantin – est de tout lui-même un pédagogue. Dans cette ligne, il va donner en ce résumé toute sa mesure. Il lui faut ne rien omettre d'essentiel, et ici ou là améliorer son exposé. Il lui faut profiter du mouvement des idées en ces années où les chrétiens passent de la persécution au droit d'être publiquement eux-mêmes, au milieu d'un paganisme qui demeure prépondérant dans la culture comme dans la société.
En ce livre, qui est sans doute sa dernière œuvre, le converti Lactance parfait jusqu'au bout son art et sa robuste philanthropie au service de la foi.Michel Perrin est professeur de Lettres et civilisation latines à l'Université de Picardie. Il a déjà édité dans la collection, du même Lactance, L'ouvrage du Dieu créateur.
Le mot des Sources Chrétiennes
L'Épitomé des Institutions divines (n° 335), est édité par Michel Perrin, professeur à Amiens, Université de Picardie, à qui nous devons déjà L'Ouvrage du Dieu créateur du même Lactance, SC 213-214.
En soixante-huit paragraphes, Lactance – car il n'y a pas finalement à lui refuser la paternité de cette œuvre – résume ses Institutions divines, cette Somme en sept livres dont deux sont déjà parus aux Sources Chrétiennes (SC 326, Livre I, et SC 204-205, Livre V). Il vaut la peine de découvrir comment l'auteur a mené son travail. En fait, il ne s'est nullement contenté de tailler et de réduire. En vue de toujours mieux convaincre les Païens que le christianisme commence à intriguer sinon à attirer, Lactance s'est exercé à une véritable synthèse de sa propre doctrine.Dominique Bertrand
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Épitomé des Institutions divines
L’authenticité de l’Épitomé a été discutée, mais les arguments avancés par P. Monat ne suffisent pas à ébranler la thèse de S. Brandt. Celui-ci remarquait que Jérôme classe l’Épitomé parmi les œuvres de Lactance ; que le prologue témoigne en faveur de l’authenticité ; que le style de l’œuvre ne pouvait être invoqué contre l’authenticité ; enfin, que le contenu de l’Épitomé en faisait une œuvre neuve, avec une liberté qu’un faussaire ne se serait probablement pas permis.
L’Épitomé est donc bien un abrégé (et non un résumé) des Institution divines, composé par Lactance lui-même vers 320, une dizaine d’années après l’achèvement de son œuvre maîtresse.
Elle a été transmise dans trois manuscrits très anciens : Bononiensis 701 (Italie du Nord, ve siècle) ; Taurinensis I B.II.27 (vie-viie siècle), Parisinus 1662 (troisième quart du ixe siècle). Il arrive qu’un manuscrit ait la bonne leçon contre les deux autres : la préférence ne peut donc être donnée systématiquement à aucun d’eux. Le peu de fautes communes interdit de dresser un stemma. L’édition, refaite, aboutit à peu de chose près à l’édition de S. Brandt (CSEL 27), mais elle est souvent plus proche de T que l’édition précédente.
La préface expose le projet de l’auteur : résumer en un seul livre les Institutions divines. La structure de l’Épitomé correspond donc à celle de l’œuvre d’origine. Le livre I traite de la fausse religion, le II, de l’origine de l’erreur, le III, de la fausse sagesse des philosophes, le IV, de la vraie sagesse et religion, le V, de la justice, le VI, du vrai culte, le VII, de la vie bienheureuse. Le tout forme 1/8 de l’original, avec des disparités de longueur d’un livre à l’autre, probablement parce que Lactance a progressivement mis au point sa méthode d’abrègement.
Si des différences ont été notées entre les épitomés païens et chrétiens, les uns et les autres sont malgré tout très proches. Ils sont le produit de la concurrence littéraire – l’auteur s’abrège pour ne pas l’être par un autre. L’idéal recherché, la brièveté, peut entraîner des maladresses ou des erreurs. Quand l’original et l’abrégé sont du même auteur, le second est fréquemment une amélioration du premier (suppressions, condensations, regroupements, ajout de précisions). Le travail de Lactance en est un exemple : le style large et périodique des Institutions laisse place à un style bref et sec ; les argumenta et les exempla ont disparu ; la composition, la forme de l’exposé et le traitement des sources sont modifiés ; des citations d’auteurs profanes et de l’Écriture, ainsi que d’autres passages, ont été ajoutés pour préciser les points jugés importants ou elliptiques. Néanmoins, d’une œuvre à l’autre, il n’y a pas de mutation réelle dans la pensée de Lactance, plutôt un progrès et un approfondissement.
Extrait(s)
Lactance, Épitomé des Institutions divines, Préface (SC 335, p. 54-57)
Quoique les livres des Institutions divines, que nous avions jadis rédigés pour éclairer la vérité et la religion, édifient et forment l’esprit de leurs lecteurs sans que la prolixité engendre le dégoût ni que l’abondance leur pèse, tu n’en désires pas moins, Pentadius mon frère, un abrégé, sans doute pour que je te dédie un ouvrage, et que ton nom soit célébré dans notre œuvre, quelle qu’en soit la valeur. Je vais accéder à ta requête, même s’il paraît difficile de resserrer en un seul ouvrage une matière développée en sept gros volumes. Car l’ensemble est à la fois moins complet, puisqu’il a fallu concentrer une matière si abondante en un espace étroit, et moins clair par suite de sa brièveté même ; d’autant qu’on y laisse nécessairement de côté des arguments très nombreux et des exemples – dans lesquels se trouvent des éclaircissements qui emportent l’adhésion –, car leur abondance est telle qu’à eux seuls ils pourraient constituer un livre. Et si on les enlève, qu’est-ce qui pourra paraître vrai et évident ? Mais je m’efforcerai, autant que la matière le permet, d’élaguer les longueurs et de resserrer les développements, sans que pour autant la matière paraisse faire défaut à l’abondance, ni la clarté à l’intelligence, dans cette œuvre qui doit tirer la vérité au grand jour.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
19
§ 7 l. 1, du bas
stoiciens
stoïciens
42
l. 27
19, Vienne
19, 2 Vienne
57
§ 1 l. 3, du bas
est
soit
95
n. 3
Γπομνμήματα
Ὑπομνμήματα
189
§ 48 l. 2
leur dieux
leurs dieux
211
§ 6 l. 19
L’origine
Mais l’origine
227
n. 1
ou l’on peut
où l’on peut
Du même auteur
-
SC 509

Institutions divines, Livre VI
octobre 2007
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 377
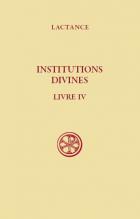
Institutions divines, Livre IV
mars 1992
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 337
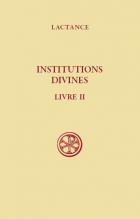
Institutions divines, Livre II
septembre 1987
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 326

Institutions divines, Livre I
janvier 1986
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 289
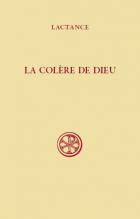
La Colère de Dieu
février 1982
Comment Dieu, impassible, peut-il être en colère ? Un véritable paradoxe, démêlé par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 214
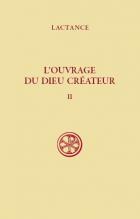
L'Ouvrage du Dieu créateur, tome II
décembre 1974
Dieu créa l'homme, et après ? Sa Providence l'abandonne-t-elle dans les persécutions ? Par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 213
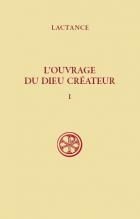
L'Ouvrage du Dieu créateur, tome I
décembre 1974
Dieu créa l'homme, et après ? Sa Providence l'abandonne-t-elle dans les persécutions ? Par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 205
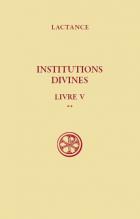
Institutions divines, Livre V, tome II
décembre 1973
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 204

Institutions divines, Livre V, tome I
décembre 1973
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC SC 39.1
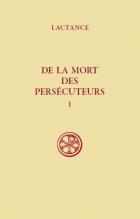
De la mort des persécuteurs, tome I
décembre 1954
Un pamphlet qui revient sur une époque dramatique, au début du 4e
-
SC SC 39.2
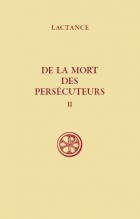
De la mort des persécuteurs, tome II
décembre 1954
Un pamphlet qui revient sur une époque dramatique, au début du 4e


