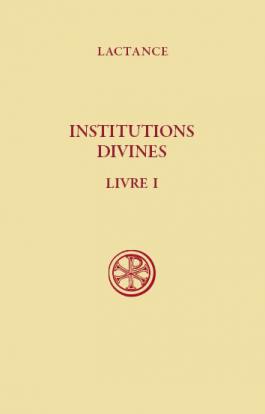-
SC 326
Lactance
Institutions divines, Livre I
janvier 1986Introduction, texte critique, traduction et notes par Pierre Monat.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres.ISBN : 9782204025362271 pagesIndisponible chez notre éditeurUne grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.Présentation
Appelé par Dioclétien à Nicomédie pour y enseigner la rhétorique, Lactance se vit confier, quelques années plus tard, la tâche de former aux belles lettres le fils de Constantin, Crispus. Témoin indigné des dernières persécutions, qu’il dénonça avec violence, il vit naître la paix de l’Église et fut de ceux qui contribuèrent à l’établir dans les esprits. C’est bien cette volonté et cette visée intellectuelle qu’il manifeste en choisissant pour sa grande œuvre le titre d’Institutions divines, aux connotations à la fois pédagogiques, rhétoriques et juridiques. Les trois premiers livres de cet ensemble, qui en compte sept, sont consacrés à la discussion des positions païennes.
Dans le livre I, Lactance s’en prend aux croyances et aux cultes païens, apportant à ce procès des dossiers qui constituent une riche documentation sur le sujet. Si la tonalité est souvent polémique, la visée demeure pédagogique : Lactance ne se contente pas de dénoncer l’erreur que constitue le polythéisme, il en analyse les causes pour la corriger. Il tente surtout de montrer à ses interlocuteurs quelle part de vérité se trouve derrière leurs erreurs, et combien leurs autorités, oracles et poètes, sont, sans le savoir, témoins et instruments de la Révélation.Pierre Monat, professeur de latin à l'université de Franche-Comté, a publié une étude sur Lactance et la Bible, ainsi que le livre V des Institutions divines. Il prépare actuellement l'édition des livres II et IV de ce même ouvrage.
Le mot des Sources Chrétiennes
Ce grand ouvrage en sept livres de Lactance, auteur latin tout à fait contemporain de la fin des persécutions et des débuts de la paix constantinienne, est une critique minutieuse du paganisme destinée à faire ressortir la vérité et la beauté morale de la doctrine de la foi.
Une équipe d'universitaires français a entrepris de mener à bien l'édition complète de cette œuvre importante et, parmi elle, nous devons à M. Pierre Monat, professeur à l'Université de Franche-Comté, après le livre V (SC 204-205), ce livre I qui traite de « la fausse religion » des païens.Dominique Bertrand
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Institutions divines Livre I (la fausse religion)
Comme les six autres livres de l’ouvrage, la datation précise du livre I des Institutions n’est pas certaine. Contrairement à l’éditrice du livre VI (SC 509), l’éditeur du présent volume date le texte des années 313-315.
La tradition manuscrite de Lactance est fort riche : jusqu’au XIIIe siècle, vingt-cinq manuscrits ont été recensés, parmi lesquels une vingtaine nous sont parvenus ; pour les XIVe et XVe siècles, on dénombre quelques cent-cinquante manuscrits des Institutions divines. L’édition critique du volume propose un texte révisé de l’édition Brandt du CSEL (CSEL 19 et 27, 1890-1893), basé sur une collation de deux codices antiquiores que Brandt n’avait pas utilisés. En outre, les Institutions posent des problèmes d’ecdotique, puisque certains manuscrits contiennent de longs passages que d’autres ignorent. Il s’agit de deux dédicaces à Constantin et de deux passages d’inspiration dualiste nettement marquée. La version longue faisant partie de la tradition du texte lactancien, les éditeurs ont choisi de la faire apparaître en pleine page, en la signalant à l’attention par des caractères différents. L’apparat critique, volontairement abrégé, fait ressortir les désaccords de l’éditeur avec le texte de Brandt.
Dans le vaste projet apologétique de Lactance, le « Cicéron chrétien » du début du ive siècle, les trois premiers livres sont consacrés au combat contre la fausse religion, le paganisme, et la fausse sagesse, la philosophie. Cependant, ces livres ne sont pas exempts de souci pédagogique. Lactance conserve en effet en permanence le souci de montrer que le polythéisme n’est qu’une déformation du monothéisme primitif. Bien qu’il existe selon lui un certain nombre de concordances entre le christianisme et divers aspects du paganisme, le livre I de ses Institutions est marqué par l’affirmation que le polythéisme constitue une grave erreur que le seul raisonnement suffit à faire rejeter. Les croyances païennes ne sont qu’horreur et absurdité et nul homme sensé ne saurait leur apporter sa caution. Enfin, l’antiquitas sur laquelle le paganisme cherche à fonder son autorité doit être rejetée : qu’est-ce qu’une antiquité qui ne remonte qu’à quelques générations avant la guerre de Troie ?
Lactance s’attache tout d’abord à démontrer l’unicité divine, puis les attaques contre le polythéisme prennent un tour systématique – contre le panthéon romain et ceux de ses dieux qui ne sont que des hommes divinisés, contre l’interprétation allégorique des mythes proposée par les Stoïciens, contre les erreurs des poètes et des artistes – avant de conclure sur l’absurdité de la uetustas du paganisme, ce dernier développement n’étant pas très fourni. Le polémiste cherche avant tout à engager un dialogue avec ses adversaires et à amener le païen égaré à prendre lui-même en main sa propre conversion. Sans contenir d’exposé systématique sur la nature divine, le livre I propose dès lors la recherche d’un consensus sur un certain nombre d’attributs de la divinité, accessibles en dehors de toute révélation.
Extrait(s)
(IX, 4-6, p. 99)
Je voudrais qu’il y eût ajouté quelques mots sur le goût du plaisir et du luxe, la cupidité, l’insolence, pour donner la dernière touche à la vertu de celui [Hercule] qu’il trouvait semblable à Dieu. Car on ne doit pas voir plus de force en celui qui triomphe d’un lion qu’en celui qui triomphe de la colère, fauve violent enfermé en lui-même, ou en celui qui abat les oiseaux les plus rapaces, qu’en celui qui réprime les désirs les plus passionnés ; en celui qui vainc une belliqueuse amazone, qu’en celui qui vainc son amour du plaisir, ennemi de la pudeur et de l’honneur ; en celui qui a sorti le fumier d’une étable, qu’en celui qui a fait sortir les vices de son cœur : ces maux, en effet, parce qu’ils sont bien installés en chacun de nous, sont plus dangereux que ceux dont on pouvait éviter les coups ou se méfier.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Du même auteur
-
SC 509

Institutions divines, Livre VI
octobre 2007
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 377
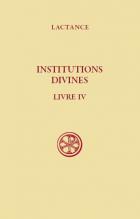
Institutions divines, Livre IV
mars 1992
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 337
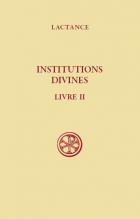
Institutions divines, Livre II
septembre 1987
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 335
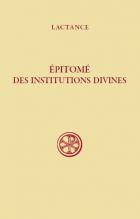
Épitomé des Institutions divines
juillet 1987
L'abrégé de la grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 289
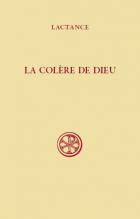
La Colère de Dieu
février 1982
Comment Dieu, impassible, peut-il être en colère ? Un véritable paradoxe, démêlé par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 214
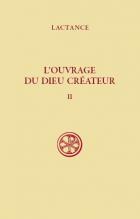
L'Ouvrage du Dieu créateur, tome II
décembre 1974
Dieu créa l'homme, et après ? Sa Providence l'abandonne-t-elle dans les persécutions ? Par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 213
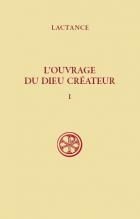
L'Ouvrage du Dieu créateur, tome I
décembre 1974
Dieu créa l'homme, et après ? Sa Providence l'abandonne-t-elle dans les persécutions ? Par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 205
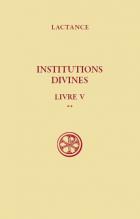
Institutions divines, Livre V, tome II
décembre 1973
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC 204

Institutions divines, Livre V, tome I
décembre 1973
Une grande apologie du christianisme, par le « Cicéron chrétien » au début du 4e siècle.
-
SC SC 39.1
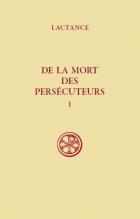
De la mort des persécuteurs, tome I
décembre 1954
Un pamphlet qui revient sur une époque dramatique, au début du 4e
-
SC SC 39.2
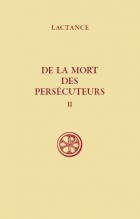
De la mort des persécuteurs, tome II
décembre 1954
Un pamphlet qui revient sur une époque dramatique, au début du 4e