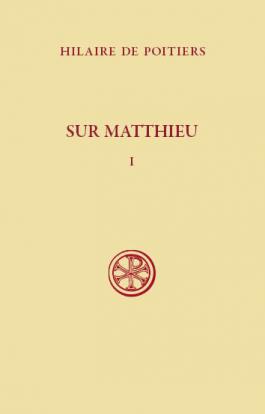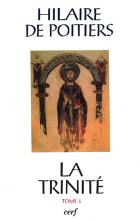-
SC 254
Hilaire de Poitiers
Sur Matthieu, tome I
Chap. 1-13décembre 1978Introduction, texte critique, traduction et notes par Jean Doignon.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres.ISBN : 9782204013529305 pagesSans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.Présentation
Étant donné l’importance d’Hilaire de Poitiers dans l’élaboration d’une pensée chrétienne en Occident, cet ouvrage se recommande à plus d’un titre à l’attention des spécialistes de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge latin, ainsi qu’à celle des historiens des faits religieux.
Il offre d’abord la première édition critique d’un texte exégétique du milieu du IVe siècle, qui est le premier commentaire latin complet conservé jusqu’à nous d’un des quatre évangiles. Pour l’éditer avec toute l’acribie nécessaire, Jean Doignon a réuni les collations de quinze manuscrits principaux dispersés dans diverses bibliothèques d’Europe, manuscrits dont un grand nombre avaient échappé à l’attention des éditeurs antérieurs (le dernier de ceux-ci vivait à la fin du dix-septième siècle).
Le texte, muni d’un double apparat (critique et scripturaire), est accompagné d’une traduction française – la première dans notre langue – et de notes, qui voudraient aider à la recherche des sources et de la documentation d’Hilaire.
Une introduction nourrie traite de l’élaboration du commentaire (sa genèse, sa survie, son « soubassement culturel »), présente ensuite l’analyse littéraire et doctrinale de l’œuvre et envisage enfin les problèmes critiques du texte latin (classement des manuscrits, stemma codicum) et les faits linguistiques qui caractérisent ce latin tardif et commandent plus d’une fois l’expression de la pensée.Le mot des Sources Chrétiennes
Hilaire aurait rédigé son Commentaire pendant les premières années de son épiscopat, avant son exil en Orient (356), car il paraît ignorer l’un des articles fondamentaux du Credo de Nicée, relatif à la génération éternelle du Verbe. Aucun indice d’oralité ne permet de penser que ce commentaire procède d’une prédication antérieure ; il semble plutôt avoir été destiné à la lecture devant un auditoire restreint, peut-être les membres du presbyterium.
L’édition SC est fondée sur neuf manuscrits principaux, postérieurs au IXe siècle, complétée par les collations de six autres manuscrits pour les passages difficiles. Un grand nombre de ces manuscrits avaient échappé à l’attention des éditeurs antérieurs (le dernier de ceux-ci vivait à la fin du dix-septième siècle). Des accidents dans la tradition antérieure au plus ancien manuscrit permettent de les classer en deux familles. Le titre retenu (In Mattheum) est le plus probable, et le Prologue est perdu – les extraits que Cassien prétend en citer sont plutôt des reconstitutions de la pensée d’Hilaire sur l’Incarnation à partir d’autres œuvres du Poitevin.
Jean Doignon offre ici la première traduction française intégrale de l’œuvre.
Le Commentaire d’Hilaire est le plus ancien commentaire latin de l’Évangile de Matthieu à nous être parvenu au complet. En effet, celui de Victorin de Poetovio, mentionné par Jérôme, semblerait relever plutôt du genre des scolies ou des « morceaux choisis » que de celui du commentaire suivi. Quant à celui de Fortunatien d’Aquilée aux quatre évangiles, une copie incomplète en a été retrouvée à Cologne en 2012.
Divisé en trente-trois chapitres, le commentaire d’Hilaire propose une lecture continue de l’Évangile de Matthieu, que les versets soient cités ou seulement paraphrasés avant d’être commentés. Il ne s’agit pas de scholies désarticulées : Hilaire est attentif à l’enchaînement des idées et de la narration évangélique, et les liaisons entre les faits deviennent autant d’articulations logiques qui fondent l’explication. Les principes d’exégèse sont expliqués par l’auteur : les faits narrés dans l’Évangile sont réels, mais ont une raison « typique » qui en fait des images de l’avenir. Le soubassement culturel sur lequel Hilaire fonde ses explications est assez vaste : outre l’Écriture, Tertullien et Cyprien, on y trouve Cicéron et des ouvrages techniques de Quintilien, de Pline l’Ancien ou d’Aulu-Gelle – le Poitevin ne connaît pas encore Origène. Hilaire accorde autant d’importance aux paroles du Christ, qui enseignent le salut, qu’à ses actes, qui l’accomplissent. Le commentaire est assez peu perméable aux réalités ambiantes : les realia proviennent des lectures d’Hilaire (Tertullien, Cyprien notamment), et les informations relatives aux hérésies n’indiquent aucune lutte active contre une faction particulière. Enfin, les particularités de langue sont celles de son époque.
Hilaire a plusieurs fois réutilisé son commentaire dans des œuvres plus tardives ; Jérôme l’a lu pour écrire son propre commentaire (sans doute aussi Zénon de Vérone), mais rien ne prouve qu’Ambroise et Augustin l’aient utilisé ; en revanche il est connu de Vincent de Lérins (Commonitorium) et de Salvien de Marseille.
Œuvre(s) contenue(s) dans ce volume
Capitula I-XIII
Le SC 254 comprend les chapitres 1 à 13 du Commentaire, qui couvrent Mt 1, 1 à 13, 49.
Extrait(s)
Sur Matthieu 5, 13 (sur Mt 6, 34), SC 254, p. 165-167
13. Ne soyez donc pas inquiets du lendemain. Demain sera inquiet de lui-même. Sa méchanceté lui suffit. On juge généralement le jour comme le laps de temps pendant lequel la lumière du soleil nous éclaire et que l'intervalle de la nuit tombante interrompt en s'intercalant, de façon qu'un jour succède à un jour. D'autre part, dans le lendemain est contenue l'idée du temps à venir. Ainsi, c'est de l'avenir que Dieu nous a défendu d'être inquiets. Et la relâche des soucis par indifférence est le fait non de la négligence, mais de la foi. Pourquoi, en effet, serions-nous inquiets du lendemain, puisque le jour de demain est inquiet de lui-même ? Ainsi le jour inquiet personnellement à notre place dissipe notre tourment. Mais l'inquiétude, à ce que je crois, est un sentiment propre à l'homme, car elle est provoquée par le tourment du souci, de la crainte ou de la douleur. Le jour, d'autre part, est un laps de temps, et seul ce qui dispose de prévoyance est sujet à l'inquiétude. On supposera donc que le jour est un être vivant capable de prendre garde, de prévoir, de se soucier, auquel sa méchanceté propre suffise sans qu'elle doive être portée à son comble par le péché survenu en sus. Mais la nature des choses n'admet pas que soit attribuée au jour une disposition d'esprit. Donc, dans le fait que le jour est inquiet de lui-même, que sa méchanceté lui suffit, qu'il nous est interdit d'être inquiets du lendemain, il y a tout le contenu représenté par la signification des mots célestes. Nous avons ainsi ordre de ne pas douter des biens à venir, parce que la méchanceté de notre vie est assez grande et les péchés des jours où nous vivons suffisent pour faire que la préoccupation et l'effort de notre vie soient entièrement consacrés à purifier et à racheter ces péchés, afin d'éviter qu'en perdant confiance dans les biens à venir, nous ne nous rendions en outre coupables d'une impiété inexpiable, tandis que, si le souci de nous- mêmes n'existe plus, ce qui doit venir a dans sa fonction de se préoccuper de lui-même et le progrès de la gloire éternelle, procuré par la bonté de Dieu, nous est ménagé, alors que nous ne nous en préoccupons plus.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
267
§ 12 l. 22
révélera
révèlera
295
§ 24 l. 5
mère, donnant
mère, et que quiconque faisait la volonté du Père était son frère, sa sœur et sa mère, donnant
Du même auteur
-
SC 625

Commentaires sur les Psaumes, tome V (Psaumes 119-126)
avril 2022
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 621
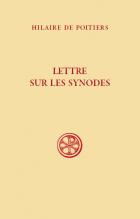
Lettre sur les synodes
janvier 2022
"Consusbstantiel au Père": qu'est-ce que ça veut dire? Hilaire dévoile le "making-of" du credo.
-
SC 605

Commentaires sur les Psaumes, tome IV (Psaumes 67-69 et 91)
décembre 2020
Les psaumes ouvrant leur sens avec une clé: le Christ
-
SC 603

Commentaires sur les Psaumes. Tome III (Psaumes 62-66)
juin 2019
Le sens des Psaumes 62 à 66 ouvert par Hilaire vers 360 avec une clé divine : le Christ lui-même.
-
SC 565
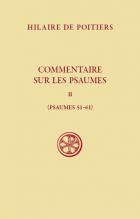
Commentaires sur les Psaumes, tome II (Psaumes 51-61)
juillet 2014
Des cris de souffrance ? Les Psaumes 51 à 61 sont, pour Hilaire, dans la bouche du Ressuscité.
-
SC 515

Commentaires sur les Psaumes, tome I (Psaumes 1-14)
juin 2008
« Heureux l'homme » : un voie spirituelle éclairée au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 462
La Trinité, tome III
octobre 2001
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 448
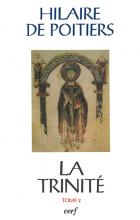
La Trinité, tome II
avril 2000
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 443
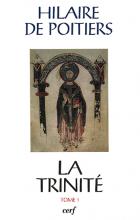
La Trinité, tome I
juin 1999
Une pensée originale, des pistes restées vierges après lui : Hilaire, théologien et pionnier.
-
SC 347

Commentaire sur le Psaume 118, tome II
novembre 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 344

Commentaire sur le Psaume 118, tome I
mai 1988
« L'alphabet » de la prière, déchiffré au 4e siècle par le premier grand exégète latin.
-
SC 334
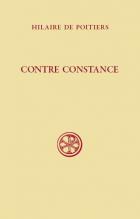
Contre Constance
février 1987
Un empereur veut imposer à l'Église une foi hérétique ? Une charge au vitriol par un évêque persécuté.
-
SC 258
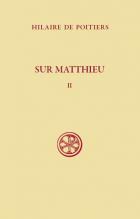
Sur Matthieu, tome II
mai 1979
Sans doute le premier commentaire latin du Premier évangile.
-
SC 19 bis
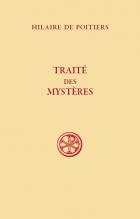
Traité des mystères
décembre 1967
Une clé de lecture de l’Ancien Testament, miroir de figures annonçant le Christ.