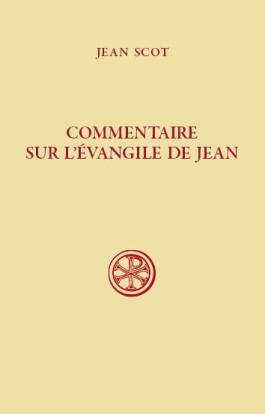-
SC 180
Jean Scot
Commentaire sur l'Évangile de Jean
décembre 1972Introduction, texte critique, traduction, notes et index par Édouard Jeauneau.
Réimpression de la première édition revue et corrigée (1999)ISBN : 9782204063296478 pagesLe plus divin des évangiles, par un Irlandais à la cour de Charles le Chauve (9e s.).Présentation
Moins fameux que le Periphyseon, le Commentaire sur l’Évangile de Jean de Jean Scot (IXe siècle) est cependant d’un grand intérêt pour l’histoire de l’exégèse biblique au Moyen Âge. Son originalité tient au fait que, à la différence des autres commentateurs latins de cet évangile, l’auteur ne se contente pas d’exploiter les Tractatus d’Augustin, mais a recours aussi à quelques Pères grecs (Grégoire de Nysse, Denys l'Aréopagite et Maxime le Confesseur), que personne pratiquement, en Occident, n’avait lus avant lui.
De ce commentaire nous possédons un seul manuscrit, mais infiniment précieux, puisqu’il est l’exemplaire de travail de l’auteur. Conservé à Laon depuis le IXe siècle, ce manuscrit semble n’avoir jamais été recopié. En tout cas, il est sûr qu’il a été peu lu. Au XIIe siècle, cependant, il se trouva un lecteur qui sut l'apprécier, le compilateur de la Glose Ordinaire sur l'Évangile selon saint Jean. Ce compilateur, très probablement Anselme de Laon († 1117), y puisa largement pour composer le réseau de gloses, tant marginales qu'interlinéaires, qu'il tissait autour du texte sacré. Ainsi grâce à la Glose Ordinaire, ce « pain quotidien des théologiens du Moyen Âge » comme on l'a appelée, le Commentaire sur l’Évangile de Jean fut accessible, dans une mesure fragmentaire certes, mais non négligeable, aux théologiens latins, entre autres à saint Thomas d’Aquin.Édouard Jeauneau, directeur de recherche honoraire au CNRS et professeur émérite de l’Institut pontifical d’Études médiévales de Toronto, a également publié de Jean Scot l’Homélie sur le Prologue de Jean (SC 151). Il a entrepris une nouvelle édition du Periphyseon, dont les cinq livres ont paru dans le Corpus Christianorum (CCCM 161-165).
Extrait(s)
(p. 101-103)
XXI [Jn, 1, 13-14 a]
Et le Verbe s’est fait chair. C’est comme s’il disait : Ne sois pas surpris de ce que la chair, c’est-à-dire l’homme mortel, puisse par grâce devenir enfant de Dieu, alors qu’il est bien plus miraculeux que le Verbe se soit fait chair. Car si le supérieur est descendu jusqu’à l’inférieur, quoi d’étonnant à ce que, sous l’action de la grâce du supérieur, l’inférieur s’élève jusqu’au supérieur ? Et cela, d’autant plus que le Verbe s’est fait chair précisément pour que l'homme devint enfant de Dieu. Le Verbe est descendu dans l’homme afin que, par lui, l'homme s’élevât à Dieu. Cette phrase de l’évangile peut se convertir simplement. Car, de même que nous disons : « Le Verbe s'est fait chair », même nous pouvons dire : « Et la chair s’est faite Verbe ».
Et il a habité parmi nous, c’est-à-dire : Il a vécu au milieu nous, les hommes. Le Verbe a habité parmi nous, c’est-à-dire qu'il a possédé notre nature.Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
Du même auteur
-
SC 151
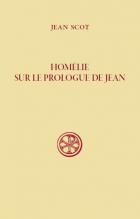
Homélie sur le Prologue de Jean
septembre 1969
Toute une théologie en quelques versets, par un Irlandais à la cour de Charles le Chauve (9e s.).