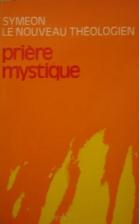-
SC 129
Syméon le Nouveau Théologien
Traités théologiques et éthiques, tome II
Éthiques 4-15décembre 1967Introduction, texte critique, traduction et notes par Jean Darrouzès, a.a.
Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.ISBN : 9782204038829521 pagesPoint de bonne théologie sans une vie de charité : 18 discours d'un père spirituel à Constantinople, vers l'an mil.Présentation
En novembre 1966 paraissait le tome I de ces Traités théologiques et éthiques. Le tome II achève cette publication. On y trouvera des développements sur les questions spirituelles les plus importantes. Citons par exemple : de la perfection chrétienne : impassibilité (apatheia) et péché, prééminence de la charité, contemplation ; de la connaissance, de la vision et de la présence, de la possession consciente de l’Esprit ; de l’union de Dieu avec l’âme, de l’union du corps avec l’âme et de l’union des trois ; des maladies de l’âme ; de l’affranchissement des passions et de l’acquisition des vertus ; de la naissance de l’amour de Dieu en l’Homme ; que la véritable connaissance spirituelle est un effet de la grâce en nous ; du jour du Jugement ; du renoncement et du ministère pastoral ; du prix du temps ; du symbolisme des rites ; de la communion ; de la solitude.
Plusieurs index complètent ces deux volumes : textes de l’Écriture, auteurs cités, noms propres, et surtout l’index analytique d’un certain nombre de mots grecs (presque mille) intéressant la théologie mystique et, en particulier, les modalités de la connaissance.La publication maintenant prochaine des Hymnes du même Syméon et celle de quelques menus textes achèveront bientôt cette édition complète des œuvres du grand théologien et spirituel byzantin.
Errata
Page
Localisation
Texte concerné
Correction
Remarques
373
l. 9 ab imo
mes biens-aimés
bien-aimés
373
l. 2 ab imo
mes enfants
enfants
Du même auteur
-
SC 51 bis

Chapitres théologiques, gnostiques et pratiques
décembre 1980
Les éclats d'une vie spirituelle pensée comme une expérience mystique, à Constantinople en l'an mil.
-
SC 196
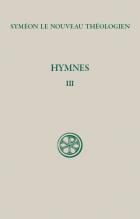
Hymnes, tome III
décembre 1973
À Constantinople, vers l'an mil, tout le lyrisme d'un saint qui se sait pécheur.
-
SC 174
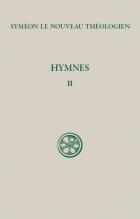
Hymnes, tome II
décembre 1971
À Constantinople, vers l'an mil, tout le lyrisme d'un saint qui se sait pécheur.
-
SC 156

Hymnes, tome I
décembre 1969
À Constantinople, vers l'an mil, tout le lyrisme d'un saint qui se sait pécheur.
-
SC 122
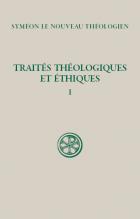
Traités théologiques et éthiques, tome I
novembre 1966
Point de bonne théologie sans une vie de charité : 18 discours d'un père spirituel à Constantinople, vers l'an mil.
-
SC 113

Catéchèses, tome III
décembre 1965
À Constantinople, vers l'an mil, les moines de Saint-Mamas écoutent leur père spirituel.
-
SC 104

Catéchèses, tome II
décembre 1964
À Constantinople, vers l'an mil, les moines de Saint-Mamas écoutent leur père spirituel.
-
SC 96

Catéchèses, tome I
décembre 1963
À Constantinople, vers l'an mil, les moines de Saint-Mamas écoutent leur père spirituel.
-